Article extrait du Plein droit n° 64, avril 2005
« Étrangers devant l’école »
Un os sur le chemin de l’école
Épiphane Boukra et Mélanie Le Verger
Membre du Gisti ; Membre du Gisti
A très peu d’exceptions près, tout commence par un examen osseux. Médecins, procureurs de la République et nombre d’associations s’arrangent avec sa marge d’incertitude scientifiquement établie d’une à deux année(s). A ce point que les os d’un jeune Afghan nommé Sherzad ont été jugés, en mai 2003, et dans le même hôpital parisien, successivement et à deux semaines d’intervalle, appartenir à un majeur à la suite d’un contrôle d’identité, puis à un mineur à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile [1]. La juge des enfants a éprouvé ensuite les plus grandes difficultés à obtenir la communication des résultats de la dernière expertise en date…
Qu’importe : « L’examen osseux concernant X se disant…, âgé de seize ans [par exemple] conclut à un âge osseux supérieur à dix-huit ans ». Fort de cette conclusion des parquets, aussi juridiquement affirmative qu’elle est objectivement sujette à caution, le mineur étranger isolé se voit alors le plus souvent remis, sur le champ, à cette rue dont il croyait s’être sorti. Bien des associations, des aides sociales à l’enfance (ASE) [2], des juges des enfants – pour peu qu’ils aient été saisis – peuvent se laver les mains et pousser un ouf de soulagement : ils n’ont pas concouru à l’« appel d’air » qui taraude les âmes, y compris bonnes. Quant à la carrière scolaire du mineur, elle a évidemment ainsi avorté. Roulez jeunesse !
Il existe toutefois quelques rescapés : les vraiment très jeunes contre lesquels un examen médical plus complaisant encore reste à inventer, et les adolescents, à condition qu’ils soient aidés à contester leur ossification opportuniste. Si ces derniers réussissent ainsi à produire des documents d’identité établissant leur âge civil et à combattre sur leur base les décisions prises à leur encontre, ils peuvent prétendre à une prise en charge et à une éventuelle scolarisation.
Orientation au petit bonheur
Ahmed [3] est né en juin 1988 dans le centre de l’Afghanistan. C’est en octobre 2003 qu’il arrive en France après une dizaine de mois de voyage. Diverses organisations l’aident à solliciter rapidement l’asile. Évidemment, l’examen osseux qu’il subit plus rapidement encore – à la curieuse mais quasi systématique initiative d’une association spécialisée dans l’appui aux enfants étrangers isolés –, conclut à sa majorité. Comme il produit des documents d’identité qui établissent son âge réel, il est néanmoins pris en charge par l’ASE après intervention d’une autre association auprès du tribunal pour enfants.
Dans le collège où on l’inscrit, il saute, en quelques semaines d’évaluation, de la classe de sixième à la troisième. En trois mois d’études, il est devenu capable d’écrire de longs textes en français. Mais, en fin d’année scolaire, il exprime le souhait de quitter la famille d’accueil qui lui a été désignée. L’ASE le loge dans un hôtel à la veille de la rentrée. Il se démène pour qu’on ne l’y oublie pas. Il voudrait une formation en mécanique. Il l’attend avec impatience jusqu’à la mi-novembre, date à laquelle il a la surprise de se voir embarquer dans des études d’horticulture qu’il refuse. Comme beaucoup de jeunes issus de pays du tiers-monde, Ahmed rêve à tort ou à raison d’une vie plutôt urbaine et d’un métier qui lui paraisse moderne. Au début de 2005, mais seulement grâce à la pression d’une association, l’ASE lui propose l’entrée dans une filière « communication ». La perspective de toucher à des ordinateurs le séduit, tout comme sa sortie d’un placard dont il craignait de n’échapper, comme d’autres, qu’à ses dix-huit ans pour retourner à la rue si, d’ici là, il n’avait pas obtenu l’asile. Mais que de temps perdu !
L’agriculture comme repoussoir ?
Jamal et Jawed ont dix-sept ans quand il arrivent en France au début d’avril 2003 en provenance du Kurdistan irakien. Il faut d’abord remuer ciel et terre pour intéresser l’ASE à leur sort. Dans l’attente d’un projet éducatif construit, l’éducateur désigné refuse de les inscrire à des cours de français. Par défaut, ce sont des militants qui trouvent une classe. L’année scolaire est largement entamée, mais au moins ils se familiarisent avec la langue.
Jawed fait rapidement beaucoup de progrès.
Jamal éprouve davantage de difficultés, sans doute parce qu’il est hanté par le souvenir de la guerre, de son enrôlement forcé dans l’armée irakienne à l’âge de quatorze ans, de son emprisonnement. L’ASE ne veut pas entendre parler, du moins à ce stade, d’un soutien psychologique. Pourtant, il s’accroche et réfléchit à un projet professionnel : il a toujours rêvé de devenir mécanicien. Le sort et l’ASE en décident autrement : il apprendra l’agriculture malgré ses protestations et celles de ses soutiens qui mettent en avant les risques de fuite. Aussitôt arrivé dans le centre de formation, en région parisienne, le voilà assis sur un tracteur dans une ambiance qu’il dira « militaire », où il ne fera pas de vieux os : il disparaît sans laisser de traces ni donner de nouvelles. Au soulagement de qui ?
Pendant ce temps, Jawed reste isolé dans un hôtel, sans aucune prise en charge de la part de l’ASE parfaitement satisfaite que des associations veillent à un hébergement de substitution. Début juillet, après plus d’un mois et demi d’isolement et de délaissement, son éducatrice lui propose une famille d’accueil en Midi-Pyrénées, qu’il accepte et au sein de laquelle il reste deux mois avant d’être placé dans un « lieu de vie » installé dans la même ville moyenne des contreforts de la montagne.
Jawed y accepte une formation de boulanger. Pendant huit mois, ses éducateurs sont enthousiastes et ses professeurs de français élogieux. Leur élève trouve même un stage chez un artisan. L’éducatrice de l’ASE – réellement attachée à la réussite de son protégé – s’apprête à signer avec lui un contrat jeune majeur.
Mais la rencontre d’une jeune française pousse Jawed à déroger aux règles du lieu de vie. L’ASE met alors fin à sa prise en charge avec une célérité qu’on aurait appréciée en début de parcours. Que va maintenant devenir Jawed si l’asile ne lui est pas reconnu ?
Que de temps perdu !
Ali arrive d’Afghanistan au printemps 2003. Il sollicite immédiatement l’asile. Alerté par la préfecture, le parquet ordonne une expertise osseuse qui conclut immanquablement à sa majorité. Parce que des associations saisissent néanmoins le tribunal pour enfants, une juge ordonne une mesure provisoire de placement « aux fins d’éducation en milieu ouvert renforcé » de six mois. L’organisme auquel est confié Ali ne fait rien, sauf lui trouver un lit dans un foyer de banlieue. Les associations qui l’aident ne désarmant pas, Ali finit par recevoir sa carte d’identité afghane. Il a dix-sept ans. La juge des enfants le confie alors à l’ASE qui ne bouge pas et attend pendant deux mois que le gamin se rende dans ses locaux. Elle fait alors appel de la décision et place son « protégé » dans un hôtel. Une fois encore, c’est à des associations qu’il revient de trouver pour Ali un cours de français pour lui éviter de perdre son temps. L’ASE perd en appel.
Il y a neuf mois qu’Ali se trouve en France quand il est envoyé dans une famille d’accueil du Sud-Ouest. Il téléphone sans cesse à ses amis parisiens : la dame qui doit s’occuper de son avenir serait, selon lui, alcoolique [4]. Il faut encore beaucoup d’efforts de persuasion pour obtenir un changement de famille. Ali éprouve immédiatement de l’affection pour la suivante. Un an après son arrivée en France, il commence enfin, dans l’enthousiasme, une formation professionnelle en électricité qui le passionne. Mais il meurt accidentellement.
Miettes scolaires
Hossein est pakistanais. Il arrive en France en mars 2003. Ses os sont plus durs qu’il ne sied à un mineur.
Passons sur ses placements provisoires, les hôtels et foyers sans école (sauf les cours de français où l’inscrivent des associations militantes). Quand l’heure de l’ASE arrive, une année environ est déjà passée. Des tests scolaires concluent à son inaptitude à suivre un enseignement normal. La voie de garage, c’est-à-dire d’attente de sa majorité sans guère de formation, se profile à l’horizon. Il faut que les associations qui l’ont découvert à la rue recherchent elles-mêmes un établissement scolaire adéquat disposé à l’inscrire, puis exercent des pressions énormes pour obtenir qu’il entre, en septembre 2004, dans une classe d’accueil pour « non-scolarisés antérieurement » (NSA). Hossein y obtient aussitôt des résultats d’excellence. Il y aurait fort à dire sur l’enseignement dont il bénéficie. Il y aurait moult questions à poser sur les programmes et le contrôle qu’exercent ou n’exercent pas les autorités académiques sur les classes d’accueil. Pourquoi Hossein étudie-t-il si peu les mathématiques ? Pourquoi les matières d’éveil, comme les sciences de la nature – fondamentales pour des gamins qui n’ont jamais eu accès à une explication du monde –, sont-elles si rares dans sa formation ? Pourquoi, d’une académie à l’autre, les programmes de ces classes n’ont-ils guère de ressemblance ? Autant d’interrogations qui laissent à penser que, sur le plan de la politique nationale, on laisse libre cours au bricolage, et que les mineurs étrangers doivent savoir se contenter de miettes scolaires.
L’école comme les frontières
Six jeunes parmi beaucoup d’autres, dont les parcours sont aussi chaotiques. Et combien d’autres jeunes qui n’ont jamais goûté à la moindre scolarisation parce que nul n’a souhaité les voir dans les rues où ils ont vainement attendu une prise en charge ? Combien d’autres encore, remisés dans des foyers ou des familles inadaptés qui s’évaporent dans la nature, tels ces gosses de Sangatte à propos desquels le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer constatait du temps de l’existence du camp, sans davantage s’en inquiéter, les disparitions en masse des structures d’accueil où il avait placé les rares qui lui avaient été signalés ?
On pourrait aussi se féliciter de réussites. Elles ne pèsent guère dans le bilan d’ensemble. De toute évidence, la peur des migrations, la hantise de l’« appel d’air » frappent de plein fouet les mineurs étrangers isolés. Qu’ils aient pu faire, en s’exilant, le rêve d’un accès à la modernité dans lequel l’école et la formation professionnelle ont évidemment une place centrale suffit, dans une culture de la fermeture des frontières, à induire un réflexe de fermeture de l’école, avec cette conviction que la négligence des gosses arrivés sur le territoire ôtera de la tête de leurs copains l’idée de tenter l’aventure. Dans ce contexte de dissuasion préventive, la décentralisation de l’aide sociale à l’enfance n’a rien arrangé. Existe-t-il un conseil général qui n’appréhende pas l’éducation de ces gamins comme une charge exorbitante sur son budget ? La convention internationale des droits de l’enfant pèse de peu de poids face à une pareille phobie. ;
Notes
[1] Il serait intéressant de créer le plus souvent possible les conditions de ces doubles expertises. Dans le cas de Sherzad, on lui avait donné la consigne de ne rien dire à la préfecture de l’existence d’un premier examen osseux. Cette recette, qui a donc fait merveille, pourrait être utilement ré-utilisée...
[2] ASE au pluriel parce qu’elles sont départementales, sous la responsabilité des présidents des conseils généraux.
[3] Dans le souci de préserver les mineurs dont il est question, aucun des prénoms utilisés pour les nommer ne correspond à la réalité.
[4] Si l’on en croit les témoignage de mineurs, l’alcoolisme frapperait un nombre non négligeable de familles d’accueil.

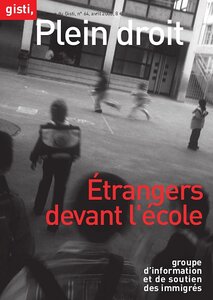
![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)










Partager cette page ?