Article extrait du Plein droit n° 41-42, avril 1999
« ... inégaux en dignité et en droits »
Les ZEP, effets pervers de l’action positive
Gérard Chauveau
Chargé de recherche à l’Institut national de la recherche pédagogique (INRP)
Jusqu’au début des années 1980, la « sélection » ou la « ségrégation » scolaire dans l’école de base (école primaire + collège) s’opérait principalement à l’intérieur des collèges où coexistaient les filières « nobles » conduisant à l’enseignement long et les filières de « relégation ». Le collège s’était ouvert à tous, vers 1965-1970, mais un quart des élèves y entrait en réalité par la « petite porte » : celle du cycle transition-pratique-CPPN, des sixièmes allégées ou des SES. La quasi-totalité de ces « vrais-faux collégiens » était de milieu socio-économique défavorisé.
Pendant la décennie quatre-vingt, la division sociale-scolaire devient de plus en plus spatiale ou géographique. On a, d’un côté, les établissements « top niveau » des beaux quartiers et, de l’autre, les « sous écoles » réservées aux pauvres et aux immigrés. Des établissements scolaires qui recevaient un public socialement mixte ont à présent un recrutement entièrement « défavorisé », voire « immigré ». La fuite d’une partie des parents d’élèves et d’une partie des personnels de l’éducation nationale accentue cette évolution vers un apartheid scolaire de fait..
Plus précisément, les collèges des années quatre-vingt connaissent un double mouvement ou une double mutation.
« Côté jardin », ils réalisent le collège unique : les filières et les procédures d’orientation ou de réorientation diminuent très sensiblement ; le taux d’accès en troisième pour les élèves entrés en sixième passe à 93 % en 1989 contre 74 % en 1985, 70 % en 1980 et 64 % en 1973. « Côté cour », ils vivent la reproduction, sous une forme nouvelle, des mécanismes de sélection-ségrégation : les mesures d’assouplissement de la carte scolaire (la désectorisation) se multiplient à partir de 1985 ; la séparation entre « bon » collège et « mauvais » collège (ou collège « difficile ») se généralise chez les parents et chez les enseignants ; pour les uns et les autres, choisir « le bon établissement » devient une préoccupation importante.
Il y a bel et bien une déficience du service public d’enseignement – ou une médiocre qualité de certains établissements scolaires – dans nombre de « banlieues » ou de « zones sensibles ». Et autour de l’école, les constats sont parfois plus sévères. Au lieu de bénéficier d’équipements et de services publics de qualité, ces territoires tendent à devenir des « chasses gardées » pour les spécialistes de la misère : éducateurs spécialisés, clubs de prévention, bureaux d’aide sociale.
C’est dans ce contexte que les ZEP, créées en 1982, se mettent en place. Les textes officiels déclarent qu’il s’agit de lutter « contre l’échec scolaire et les inégalités sociales », de favoriser « la démocratisation de la formation scolaire ». (circulaire du 1-7-1981). Pour ce faire, on affirme vouloir mieux traiter, voire traiter en priorité, les lieux qui subissent à la fois « l’inadaptation de l’appareil scolaire » et la « conjonction des difficultés ».
« Donner plus à ceux qui ont moins »
Des moyens supplémentaires (matériels, financiers, humains) et des mesures particulières sont annoncés « dans les zones et dans les milieux sociaux où le taux d’échec scolaire est plus élevé ». C’est l’introduction dans le système scolaire de l’idée de discrimination positive qui s’exprime de deux façons : « à situations inégalitaires, solutions inégalitaires » ou « donner plus à ceux qui ont moins ».
On introduit aussi les notions d’espace éducatif et de projet de zone (ou programme d’éducation prioritaire). On fait appel à la mobilisation et aux initiatives des enseignants et de leurs « partenaires » : parents, collectivités locales, associations, équipements éducatifs et culturels, professionnels de l’enfance et de la jeunesse (circulaires du 28-12-1981 et 28-12-1982). On estime que l’intervention scolaire et éducative doit porter sur tout un territoire, modifier les relations entre l’école et le milieu local (le quartier).
On pense enfin que les actions ZEP et les projets de zone doivent se combiner avec d’autres opérations ou d’autres politiques locales, notamment celle du développement social des quartiers.
Les textes officiels prévoient que la mise en œuvre de ces orientations « sur le terrain » soit assurée par un dispositif local qui comporte trois éléments fondamentaux : des moyens spécifiques, un programme d’éducation prioritaire (le projet de zone), l’articulation avec le dispositif local de la politique de la ville (plan local de développement social, puis contrat de ville). Chaque ZEP doit être « pilotée » par une équipe d’animation (ou groupe de pilotage) ; celle-ci comprend en particulier un duo d’animateurs : le responsable de la ZEP (inspecteur de l’éducation nationale ou principal de collège) et le coordonnateur (un enseignant).
Pour de nombreux décideurs et observateurs, la politique ZEP apparaît alors comme la première tentative, dans l’histoire de l’enseignement en France, d’associer une réforme scolaire et des dynamiques locales de changement social. Ils espèrent que le dispositif ZEP – moyens supplémentaires + projet de zone + coordination avec les opérations de développement social urbain – stimulera et structurera une dynamique éducative locale (ou une mobilisation collective), elle-même génératrice de « réussite pour tous » dans un grand nombre de zones d’éducation prioritaire.
Mais une partie non négligeable des acteurs locaux – enseignants, chefs d’établissement, élus, parents d’élèves – ont plutôt tendance à refuser le classement en ZEP. Ils redoutent les assimilations du type ZEP = élèves en difficulté ou en échec, ZEP = écoles en difficulté ou en échec, ZEP = écoles de « la zone » ou de « seconde zone ». Ils craignent que la désignation publique et officielle des quartiers et des établissements ZEP comme lieux « sensibles, défavorisés, en difficulté, difficiles, à problèmes, à risques » renforce la stigmatisation et la marginalisation informelles dont ils sont victimes. Elle accentuerait leur « dégradation » (dans les deux sens du mot).
Ces réactions contraires s’expliquent par la dualité des concepts de base de la politique ZEP. C’est d’abord l’idée même de zone qui est à double sens. La zone prioritaire est pensée comme une cible de l’Etat central qui décide d’y renforcer ses services et ses prestations ; mais elle est aussi un recours pour ce même Etat central qui compte sur les ressources, les initiatives et les mobilisations locales pour réussir sa politique. Elle est considérée simultanément ou en alternance, comme un danger car elle concentre les troubles et les handicaps sociaux ou urbains et comme une richesse puisqu’elle possède des potentialités et des compétences variées.
L’ambiguïté de la « philosophie ZEP »
C’est la source des divergences de regard porté sur le milieu local par les pouvoirs publics et les différents acteurs. Tantôt l’accent est mis sur les aspects négatifs, y compris de manière brutale ou outrée : c’est « la zone », « la galère », « la misère », « l’enfer ». Tantôt, on met en avant, non sans un certain angélisme, les élans, les efforts, les énergies et les expériences. Pour obtenir ou justifier les moyens ZEP, les acteurs locaux sont enclins à noircir le tableau, à exagérer les faiblesses et les difficultés du « milieu ». S’ils veulent souligner la faisabilité de leur projet de zone, ils ont tendance à valoriser les atouts du « local ».
On retrouve la même oscillation ou la même ambivalence dans la présentation des ZEP (les réseaux scolaires et éducatifs locaux). Dans les documents et les discours officiels, ce sont souvent des « zones de difficultés scolaires et sociales », mais on en fait aussi des « laboratoires » ou des « locomotives » de la rénovation de l’ensemble de l’institution scolaire. Et lorsqu’on évoque les ZEP en tant que « zones de difficultés », on peut désigner en réalité trois phénomènes distincts : les difficultés de fonctionnement (ou les dysfonctionnements) du système scolaire local, les difficultés environnementales (les problèmes sociaux et urbains) ou les difficultés de la relation école-quartier.
Deuxièmement, il y a bien des manières d’entendre la formule – générale et généreuse – « donner plus à ceux qui ont moins ». Elle soulève toute une série d’interrogations.
Ceux qui ont moins… de quoi ? Moins de ressources matérielles et financières ? Ou moins de soutien, moins de soin, moins d’éducation dans leur milieu socio-familial ? Ou moins de goût et d’intérêt pour apprendre à l’école ? Ou moins de capacités langagières, instrumentales, cognitives ? Ou moins d’enseignement efficace ? Moins de « bons » établissements et de « bons » enseignants ? Bref, la question est de savoir si les élèves des zones prioritaires, et plus généralement les enfants des milieux « très populaires », sont des handicapés socio-culturels ou des mal enseignés.
Donner plus… de quoi ? Donner plus de socialisation (apprendre à vivre ensemble) ? Ou plus d’instruction (apprendre et comprendre le monde) ? S’agit-il de privilégier le péri-scolaire et la périphérie des processus d’enseignement/apprentissage : actions et animations socio-éducatives, sanitaires, physiques et sportives, culturelles… ? Ou de se centrer sur la transmission-acquisition des connaissances et des apprentissages scolaires ?
Donner plus « de la même chose » : plus de cours, plus d’enseignement traditionnel ? Ou plus « d’autre chose » : plus d’innovation pédagogique, plus d’aide personnalisée, plus de stimulation, plus de plaisir d’apprendre, plus de sens à l’école et aux savoirs ?
Donner plus de quantitatif : postes, crédits, heures d’enseignement, allégement des effectifs ? Ou plus de qualitatif : dynamisme, mobilisation, énergie, engagement, volonté de réussir et de faire réussir l’ensemble des élèves ?
Donner combien en plus ? Peut-on se limiter à « un petit plus » Ou faut-il apporter « un gros plus » ? A partir de quel seuil, le plus peut-il avoir des effets positifs réels sur l’enseignement et les acquisitions scolaires.
Et troisièmement, c’est le but ou la nature profonde de la politique ZEP qui semble équivoque. La loi d’orientation sur l’éducation de 1989 indique : « Amener 80 % d’une classe d’âge au niveau du baccalauréat (niveau IV) ne doit pas dispenser de donner une formation et une qualification satisfaisantes aux 20 % d’élèves qui ne pourront atteindre ce niveau. La définition des zones d’éducation prioritaires a répondu à la volonté de prévenir les situations d’échec en apportant à des populations scolaires issues des catégories sociales défavorisées un soin pédagogique particulier ». Cet extrait peut être interprété de deux façons : soit les ZEP permettent de se rapprocher des « 80 % au niveau bac. » dans les quartiers populaires ; soit elles se limitent à gérer « les 20 % restants ».
Comment décrire le fond ou l’esprit de la politique des ZEP depuis son lancement entre 1981 et 1983. Présentée comme « une solution », elle apparaît aussi – ou peut-être d’abord ? – à l’analyste comme « un problème ». Ce sont les notions de base (celles de zone prioritaire, de discrimination positive, de renforcement de l’action éducative) et c’est le sens même de cette politique (sa signification, sa finalité) qui font problème ou qui sont des problèmes à résoudre… en 1999 comme en 1981.
Quel bilan ?
Dix ou quinze ans plus tard, ce qui frappe l’évaluateur c’est la grande diversité des interprétations, des applications, des situations et des résultats ; c’est le « double visage » du phénomène ZEP. On trouve aussi bien des ZEP effectives où se développent de réelles dynamiques locales que des ZEP fictives où l’on s’est limité à une application formelle des directives gouvernementales.
En moyenne, le bilan est globalement décevant. Pour ce qui est de l’effet social, on constate que la « fracture sociale » qui traverse l’école s’est accentuée dans les années quatre-vingt-dix (voir par ex. le rapport Toulemonde, fév. 1998). Les écarts se sont creusés entre les collèges protégés de l’arrivée des « nouveaux publics » (élèves défavorisés, élèves faibles) et ceux qui les accueillent massivement. Dans les quartiers populaires, on a de plus en plus d’écoles et de collèges qui sont fuis par plus d’un tiers de la population du secteur ; on a de plus en plus d’écoles ou de collèges qui accueillent au moins 90 % d’élèves issus de l’immigration.
Dans la plupart des cas, la ghettoïsation d’une partie des écoles « de banlieue » va de pair avec l’instabilité et la fragilité des personnels de l’éducation nationale. Dans certains collèges, 50 % des professeurs changent chaque année et 70 % au moins demandent leur mutation ; tous les deux ou trois ans, l’équipe de direction est entièrement nouvelle ; et, à chaque rentrée, on a beaucoup de mal à pourvoir tous les postes d’enseignement ou d’administration. Aujourd’hui, un collège de type ZEP sur cinq est un collège « d’exil » ou de « la relégation », c’est-à-dire un collège victime d’une double ségrégation : au niveau du public scolaire et au niveau de l’encadrement et des prestations pédagogiques.
Quant à l’effet cognitif, on estime qu’une ZEP sur trois a obtenu une amélioration sensible des résultats scolaires tandis que dans d’autres aucune progression n’est visible (voir par ex. le rapport Moisan, Simon, sept. 1997). On relève de fortes disparités entre ZEP et au sein d’une même ZEP tant sur le plan des performances des élèves que sur celui du fonctionnement pédagogique des classes et des établissements scolaires. Par exemple, à situation sociale comparable, la proportion d’enfants lecteurs à la fin du cours préparatoire et le taux de réussite au brevet des collèges peuvent varier de 20 % à 80 %
Quelle relance ?
Les assises nationales ZEP (Rouen 4-5 juin 1998) sont loin d’avoir dissipé les ambiguïtés ou les imprécisions de la politique d’éducation prioritaire. Le 5 juin, Ségolène Royal déclare que « le recentrage sur les apprentissages et les savoirs est la question centrale ». Mais le Comité interministériel des villes du 30 juin donne comme objectif premier à la relance des ZEP « la prévention de la violence » et il ne mentionne pas la question des apprentissages et de la réussite scolaires. Il y a en réalité – et de façon quasi officielle – deux conceptions opposées de la relance des ZEP.
La première conception propose une sorte d’accompagnement social de l’échec scolaire et de la ségrégation. Pratiquement, elle aboutit à institutionnaliser l’idée d’une école à deux vitesses en organisant la mise en place d’une filière bis – ou d’un deuxième réseau – du système scolaire dans les zones urbaines dites défavorisées. Cette filière-bis d’écoles « au rabais » serait réservée aux pauvres et aux immigrés. Elle délaisserait les deux missions essentielles de « l’école pour tous » : la transmission/acquisition des savoirs et la démocratisation de la réussite scolaire. Elle remplacerait la logique scolaire et pédagogique par des logiques sociales. Ou bien on aménagerait – on adoucirait – les phénomènes de ségrégation scolaire et les dysfonctionnement du service public d’enseignement en apportant des « compensations » : quelques clubs ou ateliers pour les élèves, quelques primes pour les maîtres, quelques emplois jeunes pour les deux. Ou bien on se focaliserait sur l’insécurité et la violence et on privilégierait les actions de prévention et de pacification sociales.
La seconde conception essaie de construire l’école populaire de la réussite ; elle veut transformer les ZEP en zones d’activités intellectuelles. Elle s’efforce d’offrir aux enfants et aux adolescents des « banlieues » plus de dynamique intellectuelle et culturelle, plus d’occasions d’apprendre et de comprendre, plus de situations de recherche, plus d’aides au travail personnel, plus d’entraide scolaire, plus de méthode de travail… Et elle souligne avec force les deux priorités – les deux urgences – de la politique des ZEP (et des réseaux d’éducation prioritaire) : la mixité sociale et ethnique, la qualité des ressources humaines et de l’encadrement et des prestations pédagogiques dans l’ensemble des établissements scolaires.
Le premier enjeu pour « les ZEP de l’an 2000 » est de savoir quelle philosophie de l’éducation prioritaire l’emportera, dans les ministères et sur le terrain.
Notes bibliographiques :
|

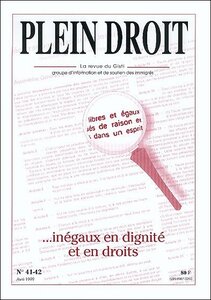
![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)










Partager cette page ?