Article extrait du Plein droit n° 32, juillet 1996
« Sans frontières ? »
Rencontre avec des militants immigrés
Propos recueillis par Marie-Ange d’Adler
Journaliste
« Une étrangère peut réussir »
« Une femme, une étrangère à la tête du deuxième syndicat de la fédération des services CFDT ! » Elena Stanciu jubile. Son élection, le 13 octobre 1995, au poste de secrétaire générale du syndicat hôtellerie, tourisme, restauration Ile-de-France l’a surprise et comblée. Une date pour elle, « je me réalise dans la vie syndicale », et pour « tous les immigrés et exilés qui voient qu’une étrangère peut réussir ».
Elena avait dix-huit ans lorsqu’elle a débarqué au Bourget en novembre 1968. Roumaine, fraîchement mariée à un Français, assurée d’obtenir rapidement la nationalité française, elle découvre un Paris qui lui avait été minutieusement décrit par sa grand-mère, « une femme cultivée, qui avait voyagé et qui m’a toujours dit que je devrais faire mieux que les autres ! » Elle a la soif d’apprendre et la volonté de conquérir cette France qu’elle a choisie. Elena apprend le français en trois semaines, lit tout ce qui lui tombe sous la main, étudie la psychologie à Vincennes. Elle se passionne pour la lutte des femmes, fait un passage éclair au MLF, « pourquoi vouloir rester entre femmes ? », et milite pour la liberté de l’avortement. Le militantisme lui est naturel et le syndicalisme évident. Elena rejoint des associations de quartier et adhère à la CFDT. En 1982, elle est embauchée dans une entreprise de tourisme social. Projet social, milieu de gauche, socialistes au pouvoir… Mais le trajet de cette femme venue d’ailleurs reste un parcours d’obstacles.
La discrimination, Elena connaît. Elle n’oubliera pas le jour où elle a été écartée des contacts avec les clients au motif que « dans le contexte actuel, l’accent d’Elena passera mal ». Elena hait son accent qui signale son origine, souffre des remarques qui lui font constamment sentir qu’elle « n’est pas d’ici », prend peur quand Le Pen commence à occuper le terrain médiatique, et continue son chemin avec obstination.
En 1990, grâce à un collègue, elle « entre par la grande porte » au bureau du syndicat, puis en 1992 au bureau de la fédération des services. Elle est déçue par l’absence de débats d’idées et le consensus de confort. D’où sa joie lorsqu’elle est élue secrétaire générale : « À ce poste, on peut faire quelque chose dans un champ sinistré, où l’emploi précaire est de règle, l’embauche au noir fréquente, le mi-temps souvent imposé, les contrats d’apprentissage fréquemment bidon ». Vexante, une lettre du Parquet de Paris lui enjoignant de fournir une fiche d’état civil (« avec un nom étranger, il faut prouver ses droits à la vie syndicale »). Irritantes, les remarques incrédules de ceux qui lui demandent comment elle a fait pour arriver là (« Comme si ma capacité de travail n’existait pas ! »). Mais Elena ne démord pas de son projet : ramener la démocratie dans son syndicat. « Si nous ne sommes pas à l’écoute de ces travailleurs de cultures et de religions différentes, dont beaucoup s’expriment difficilement, nous n’aurons plus d’adhérents. Que ferons-nous alors de nos idées ? » interroge-t-elle.
« Quand un Africain me dit : tu es ma sœur, je le comprends » ajoute Elena. « Je vis la même histoire d’amour pour un pays dont je cherche à me faire aimer ». Gens du Maghreb ou d’Afrique noire, Espagnols, Portugais, Polonais, Roumains, Grecs… des dizaines de nationalités cohabitent dans ce secteur d’activité. Au bureau du syndicat, trente personnes siègent : quatorze Français « de souche », quinze naturalisés et un Norvégien qui a refusé de changer de nationalité.
« Le syndicat ne fait pas assez pour nous »
Appelons-les Hélène et Elizabeth. Leurs vrais noms, vous ne le saurez pas. Quand on est employée de maison, peut-on s’afficher syndicaliste ? Hélène et Elizabeth, donc, sont arrivées il y a neuf et huit ans de l’Île Maurice. « La boulangerie, la carte orange et l’adresse du syndicat : voilà ce dont j’avais besoin pour vivre en France » dit Hélène.
À neuf ans, Hélène avait déjà le balai dans les mains et faisait des ménages quand elle n’était pas à l’école. Une école qu’elle quitte à douze ans pour travailler comme employée de maison. À dix-huit ans, avec des copines, elle crée le premier syndicat des employées de maison sur l’île. En 1968, l’Île Maurice est devenue une république indépendante et quelques années plus tard Hélène milite dans des partis de gauche : « c’est là que j’ai tout appris ». Quand elle vient à Paris en 1987, c’est pour y voir des neveux fraîchement émigrés, mais aussi pour connaître cette nation qui, à l’époque coloniale, avait amené ses ancêtres d’Afrique en esclavage. Le visa de tourisme expire et un matin Hélène se réveille clandestine. Avec d’autres Mauriciens, avec des Philippins, elle participe à un groupe de sans-papiers soutenus pas la CFDT et obtient sa régularisation. Mariée depuis deux ans à un Français, elle a adopté la nationalité française « pour avoir le droit de vote et parce que je pouvais bénéficier de la double nationalité ».
Pendant quatre ans, Hélène a siégé à la commission nationale du syndicat des employées de maison. Elle a démissionné après avoir subi les propos racistes d’une « camarade ». Elizabeth l’a remplacée « pour que les immigrées soient représentées ». Mauriciennes, Philippines, Capverdiennes ou Srilankaises, parfois Portugaises ou Espagnoles, les immigrées sont majoritaires parmi les employées de maison en région parisienne. Mais pas toujours bien vues des Françaises. « À l’Île Maurice, je me sentais valorisée par le travail syndical, ici on est constamment sur la défensive » remarque Elizabeth qui a travaillé en usine avant de venir en France lorsqu’elle s’est retrouvée seule avec un enfant. Salaires conventionnels au tarif du SMIC, absence de mutuelle, formation professionnelle inexistante… il y a de quoi faire pour le syndicat des employées de maison. Encore faudrait-il avoir les moyens d’agir. « Il n’y a même pas de bureau d’accueil dans le 16e arrondissement ! » s’insurge Hélène. Selon elle, les centrales syndicales ne s’intéressent guère à une profession atomisée, où l’investissement n’est pas « rentable » en termes de cotisations et d’image.
Naissance d’un syndicat
Des surprises, Georges Zamora en a eues dès qu’il a commencé à travailler en France. En 1981, étudiant, chilien, il quitte son pays où il a participé aux premières manifestations anti-Pinochet. Français par sa mère, il peut résider en France et trouve du travail dans le bâtiment : peintre en extérieur. C’est là que les étonnements commencent : « On travaillait sans ceinture de sécurité ; je voyais des salariés étrangers qui n’avaient pas été payés depuis plusieurs mois… Après six semaines sur le chantier, j’ai provoqué un arrêt de travail et obtenu des négociations avec le patron… ». L’entreprise fait faillite et Georges trouve un nouvel emploi : déblaiement des gravats après réfection. Après trois mois, il a un accident du travail et se découvre sans sécurité sociale parce que le patron n’a pas payé les cotisations. En 1983, le voilà dans une entreprise de nettoyage qui emploie une vingtaine de salariés. Georges adhère à la CFDT, lutte pour le paiement des heures supplémentaires, pour le remboursement de la carte orange, pour l’accès au restaurant d’entreprise. À la fin de l’année, il est délégué central de l’entreprise de nettoyage, colporte son expérience sur une quarantaine de chantiers, obtient la nomination de délégués sur une vingtaine.
En 1986, Georges participe à la création du syndicat des nettoyeurs de la région parisienne CFDT, le SSNPE. Nouveau syndicat pour une profession en mutation. Le nettoyage est devenu une activité de sous-traitance : plusieurs milliers de sociétés se partagent le marché en Ile-de-France où quelque cent mille nettoyeurs travaillent sur des chantiers très divers : ateliers, hôtels, hôpitaux, cinémas, etc., relevant eux-mêmes de syndicats différents. Les nettoyeurs ont besoin d’une représentation spécifique. Très vite, Georges Zamora assure bénévolement des permanences au SSNPE. En 1992, il démissionne de son travail pour devenir permanent à la CFDT…, et se retrouve licencié trois ans plus tard. « C’était la mort du syndicat ! » se souvient Georges. Réembauché par son ancien employeur, il est détaché auprès du syndicat et réintègre son poste. Le combat est incessant dans un secteur où les chantiers changent souvent de main, renégociés à moindre prix avec une charge de travail accrue. Temps partiels, employeurs multiples, horaires éclatés, délégués licenciés, élections contestées, grèves surprises… Beaucoup de travail pour les permanents et peu de moyens : « Ici, on doit tout faire pour des adhérents qui appartiennent à quatre-vingt nationalités et dont beaucoup ne savent ni lire ni écrire ; il faut les aider à téléphoner, leur expliquer une lettre, rédiger une réponse, la faire taper, les accompagner dans une démarche… ». Deux autres permanents, l’un Marocain, l’autre Malien, ont rejoint Georges en 1995. Ils ont difficilement obtenu quelques heures de secrétariat. « Les syndicats professionnels sont cloisonnés, ceux qui sont riches ne donnent pas facilement à ceux qui sont pauvres alors qu’il faudrait mettre les moyens en commun » regrette Georges, « mais notre syndicat n’est pas en mesure d’entrer dans le jeu interne des luttes de pouvoir ».
Pour son syndicat, Georges Zamora, secrétaire général ne manque pourtant pas d’ambitions. « Beaucoup de ceux qui viennent nous voir ont des problèmes de papiers ou de logement ; nous les aidons mais ce travail devrait être pris en charge par une autre structure dotée de plus de moyens ». En 1989, le syndicat des nettoyeurs de la région parisienne a participé à la campagne de soutien aux demandeurs d’asile déboutés ; il a accompagné certains d’entre eux dans les démarches pour tenter la régularisation, pour éviter le licenciement. Pour Georges Zamora, « le soutien aux travailleurs immigrés qui perdent leur titre de séjour fait partie du travail syndical ».
« Lutter pour l’emploi des jeunes issus de l’immigration »
Faty Keba n’était pas venu en France pour y rester. Lorsqu’en 1973, il a quitté la Casamance pour Paris, c’était avec l’idée d’acquérir un diplôme et de rentrer au pays. À l’époque, un Sénégalais qui avait passeport et billet d’avion entrait en France sans autre formalité. « On changeait de continent, mais on était chez nous » résume-t-il. Chez nous… Faty Keba ne connaissait personne à Paris et il se souvient encore de son arrivée dans un foyer de travailleurs immigrés : « Ces lits superposés dans des petites chambres…j’ai failli repartir pour le Sénégal ». Mais il se fait un ami, trouve immédiatement du travail et un petit logement. Un mois passe, un an. « Repartir sans diplôme et sans argent ? C’est impossible, alors on reste » explique Faty. En 1974, il est embauché chez Renault, à l’usine de Flins. L’industrie automobile recrute encore beaucoup de travailleurs immigrés et Flins compte 22 000 salariés.
Le travail est dur. Il faut une femme à la maison pour tenir le coup. Faty se marie en Casamance et sa femme le rejoint dans le cadre de la nouvelle politique de regroupement familial. Les enfants naissent. En 1990, Faty Keba acquiert la nationalité française. Son fils aîné a alors treize ans. Quelques années plus tôt, lorsqu’il a emmené ses enfants passer trois mois au pays, Faty a compris qu’ils ne feraient pas leur vie au Sénégal.
C’est à partir de ce moment qu’il s’implique résolument dans la vie collective, à l’usine comme dans la cité. « Les Noirs ont trop longtemps vécu ici repliés sur eux-mêmes » dit-il aujourd’hui. « Nous devons aller vers les autres, comprendre comment vivent les gens du pays d’accueil, nous faire connaître d’eux. C’est nécessaire pour nous, pour nos enfants. » Faty a connu les années où l’OS était le plus souvent un travailleur immigré qui parlait mal le français et répétait le même geste huit heures par jour sans même savoir quelle pièce il fabriquait. Il a vécu la constitution de cités-ghettos d’où les Français partaient au fur et à mesure qu’Africains et Maghrébins y arrivaient. « À quoi ont pensé les hommes politiques ? » interroge-t-il.
Faty Keba avait adhéré à la CGT dès son arrivée à Flins. Sans bien savoir ce qu’est un syndicat. Mais c’est en 1991 qu’il devient militant à la suite d’un conflit dans son atelier. Chez Renault, les nouvelles techniques de production exigent moins d’ouvriers et plus de qualification. Faty est sélectionné pour une formation de six mois dans un stage où sont mêlés Africains, Maghrébins et Français. « On s’entendait très bien, tout le monde rigolait et buvait le thé ensemble » se souvient-il. Mais au retour à l’atelier, c’est une autre affaire. « Le chef d’équipe a voulu nous séparer : les plus performants en bout de chaîne, à la finition des blocs, les autres en début de chaîne, là où il faut souder et charger » raconte Faty. « J’ai vu que tous les Français de souche étaient à la finition, et qu’il n’y avait que des Africains et des Maghrébins de l’autre côté. J’ai refusé ». Faty arrête le travail, ses camarades le soutiennent, les syndicats s’en mêlent. « J’ai demandé à être nommé délégué syndical pour mener moi-même ce combat ». Les ouvriers obtiennent finalement de tourner sur les postes de travail.
Faty est maintenant délégué du personnel pour l’usine de Flins. Parmi ses soucis prioritaires : l’emploi des jeunes. « La CGT doit lutter pour l’emploi des jeunes sans discrimination » dit-il. Autour de lui, il voit embaucher des jeunes, mais très peu sont issus de l’immigration. « Si peu qu’on ne les voit pas ! ».
L’avenir des jeunes se prépare dans la cité. C’est aussi en 1991 que Faty Keba a participé à la fondation de l’Association culturelle éducative de la communauté africaine de Mantes-la-jolie et créé un lieu de soutien scolaire dans la cité du Val-Fourré. Une quarantaine d’élèves y viennent après la classe travailler sous la houlette de plusieurs enseignants. Pendant les vacances scolaires, le centre est ouvert toute la journée et Faty y passe la matinée ou l’après-midi, avant ou après l’usine. Travailleur, syndicaliste, éducateur aussi.
« C’est par la formation syndicale que nous ferons reculer le vote le Pen »
La grève de l’usine Pfizer de Massy, Samuel Bitanga s’en souvient comme d’une fête. Deux mois et demi de conflit pour obtenir une augmentation de salaire pour un ouvrier portugais qui n’en avait jamais eu en vingt-six ans de travail. Le drapeau rouge flottait sur l’usine occupée. Les municipalités socialistes de Massy-Palaiseau et communiste d’Antony ravitaillaient les grévistes. Un prêtre-ouvrier avait pris la tête du comité de grève. C’était la fin des années 1970, l’époque de l’union de la gauche et des grandes espérances. Les grévistes ont eu gain de cause. Samuel Bitanga était secrétaire du syndicat CGT de l’usine. Il a été licencié l’année suivante.
Samuel Bitanga est arrivé en France en 1966 pour apprendre le métier de brasseur qu’il voulait exercer au Cameroun. Trente ans plus tard, il est délégué central du syndicat CGT de l’entreprise Roche, membre de la commission exécutive de la fédération de la chimie et du collectif national immigration.
Arrivant du Cameroun à 21 ans, Samuel découvre la CGT dans la première entreprise, transformation de matières plastiques, qui l’emploie : « À travail égal, salaire égal, m’a dit un camarade en voyant que je gagnais moins que les ouvriers français : ça m’a marqué » se souvient-il. Il entre la même année au bureau du syndicat de l’entreprise. Mais il n’a pas perdu de vue son projet professionnel. D’où un détour de plusieurs années par le monde de la brasserie. Après un stage à Valenciennes et des études à l’École supérieure de chimie et de biochimie appliquées de Nancy, il est embauché à Paris. Les brasseries sont des entreprises familiales ;
Samuel est apprécié par un patron très présent auprès des ouvriers. Cette belle harmonie est rompue par un conflit et Samuel change brusquement d’orientation. Après une formation de chimie organique, il est embauché dans l’industrie pharmaceutique et retrouve la CGT.
« Quand on vient d’un pays colonisé, on réagit vite à toutes les formes d’exploitation » dit-il pour expliquer son engagement syndical. Samuel a toujours réagi vite et il a appris sans relâche. Pas seulement dans tous les stages proposés par la CGT, mais en s’inscrivant à une université populaire créée par le parti communiste. Il y choisit « la section philo pour dépasser la formation strictement syndicale ».
Le racisme ? « Il n’y en avait pas quand je suis arrivé en 1966, j’avais alors des amis français hors du syndicat » se souvient-il. « Aujourd’hui, c’est par la formation syndicale des ouvriers que nous ferons reculer le racisme. Pour que les travailleurs sachent où sont les vrais problèmes, pour qu’ils comprennent que les immigrés ne créent pas le chômage et que Le Pen ne défend pas les ouvriers français contre les ouvriers immigrés mais qu’il défend le capital ».
« Tous les travailleurs, français et immigrés, subissent la logique patronale et le risque du chômage, ils doivent donc mener le même combat » ajoute Bitanga. Il lutte contre les licenciements et pour le développement de la formation nécessaire aux nouvelles techniques.
Naturalisé ? Non. Samuel Bitanga est resté camerounais. « Avec ma peau noire, je ne peux pas être tout à fait français, quels que soient mes papiers » explique-t-il. « Le jour où la solidarité sera telle que la couleur de peau n’aura plus d’importance, ce jour-là on pourra choisir sa nationalité… ».
« Il n’y a pas assez d’immigrés dans les instances confédérales »
Alaya Zaghloula vivait depuis onze ans en France quand il a été élu à la commission exécutive de la CGT. Onze années de marche forcée à travers toutes les étapes de l’engagement syndical jusqu’à un mandat confédéral renouvelé trois fois. « Cette élection a été le choc de ma vie », dit aujourd’hui cet homme qui évoque ses « racines » dans les mines de phosphates du sud tunisien.
À dix-huit ans, c’est par conviction qu’Alaya Zaghloula, électricien, a choisi la mine (« Je voulais partager la condition des travailleurs ») et c’est à Metlaoui, en bordure du désert, qu’il a découvert le syndicalisme révolutionnaire (« D’anciens mineurs CGT, de l’époque coloniale, me parlaient de la IIIe Internationale… »). Il passe sept années au fond de la mine, connaît la douleur des accidents et des morts, mais aussi la richesse d’une vie où « on se connaissait tous et on partageait tout ». Alaya prend une part active à l’action syndicale (« Je me sentais le devoir de les aider, moi qui avais eu une enfance favorisée ») sans assumer de responsabilité. « Originaire de Sousse, je ne pouvais être élu ni par les Bédouins de Metlaoui, ni par les travailleurs venus de Lybie, d’Algérie ou du Maroc ». En 1973, il quitte la Tunisie où il « étouffe politiquement et culturellement » et émigre en France.
C’est l’époque où le gouvernement français durcit les conditions d’entrée des étrangers. À peine arrivé à Paris, Zaghloula rejoint des immigrés sans papiers en grève de la faim. Puis il participe à la création du Mouvement des Travailleurs Arabes. Embauché dans une entreprise de travaux publics de l’Essonne, il adhère à la CGT : « J’ai revendiqué mes timbres, je ne voulais pas me cacher » explique-t-il. Quelques mois plus tard, le voilà délégué du personnel, puis délégué syndical et secrétaire du comité d’entreprise dans une société qui compte plus d’ouvriers venus du Limousin que de travailleurs immigrés.
Zaghloula est entré en syndicalisme comme on entre en religion. Talonné par « la peur de ne pas être à la hauteur », il s’instruit sans relâche. En 1976, il est élu secrétaire général de l’Union syndicale de la construction de l’Essonne. « Un secteur d’activité où beaucoup d’ouvriers ne maîtrisent pas l’écrit, où les lieux de travail sont éclatés et où on compte le plus de patrons pourris » constate Zaghloula. Très vite, il entre à la commission exécutive, puis au bureau de l’union départementale. Puis en 1983, il devient permanent de la CGT et représente la fédération de la construction au collectif national immigration. En 1984, il est élu à la commission exécutive confédérale. Il s’en retire en 1995 « pour laisser la place à d’autres ».
Les travailleurs immigrés sont rares dans les instances confédérales : trois sur quatre-vingt six membres de la commission exécutive « C’est trop peu, nous devrions être plus nombreux pour peser d’un plus grand poids sur les orientations » reconnaît Zaghloula. Pourquoi ce petit nombre ? « Les syndicats et les unions départementales ne présentent pas de candidats immigrés » explique-t-il. Réticences, blocages, racisme parfois, tout cela existe à la CGT comme ailleurs. Le vote Front national de certains militants a été au cœur des débats de la 8e conférence sur l’immigration. « Ceux qui votent Le Pen se trompent de colère » dit Zaghloula, « il ne faut pas les exclure, mais discuter avec eux, écouter leurs arguments, répondre, convaincre ». Sa plus grande peur ? « Le communautarisme, c’est-à-dire le repli sur soi de chaque groupe, dont l’intégrisme musulman est une forme dure. Il faut lutter contre ce communautarisme que tous les gouvernements encouragent pour se débarrasser des problèmes les plus difficiles ».

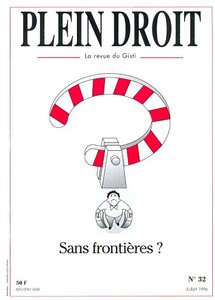
![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)










Partager cette page ?