Article extrait du Plein droit n° 29-30, novembre 1995
« Cinquante ans de législation sur les étrangers »
Qu’affluent les bras aux manches retroussées !
Vincent Viet
Chercheur à l’Institut d’histoire du temps présent (IHTP). Il travaille actuellement sur l’histoire des structures administratives de la politique d’immigration dans le cadre d’une convention d’études conclue entre l’IHTP, la DPM, le FAS et la MIRE
C’est au sein du « Haut Comité consultatif de la population et de la famille », institué par décret du 12 avril 1945 et directement rattaché à la présidence du Gouvernement provisoire de la République française (GPRF), que fut refondue la politique de l’immigration française. Celle-ci ressortissait, avant-guerre, à une politique de la main-d’œuvre qui se préoccupait au premier chef de satisfaire, en fonction de la conjoncture économique, les besoins en travailleurs de l’industrie et de l’agriculture.
En subordonnant l’immigration à une politique de repopulation, non dépourvue d’ambiguïté, les neuf membres du Haut Comité ont voulu, sans renoncer à la vocation traditionnelle de la politique migratoire, apporter des solutions à des problèmes structurels qui tenaillaient la société française depuis la fin du XIXe siècle. Les structures administratives porteront la trace de cette fusion forcée entre le conjoncturel et le structurel, dont le précipité sera la nouvelle politique de l’immigration.
Les travaux du Haut Comité ont, de fait, cristallisé la volonté politique de relancer la natalité française par l’utilisation du puissant levier que constituait l’invention de la toute nouvelle sécurité sociale. Cette volonté se renforçait du souci d’enrayer un déclin démographique (baisse de la natalité et vieillissement de la population), dont la gravité était fort bien connue de la classe politique et des milieux spécialisés (démographes et géographes) depuis... les années 1880. Or l’action des organismes officiels ou privés de l’entre-deux-guerres n’avait pas été relayée par une action publique à la hauteur du mal déploré. Pas moins de deux guerres auront été nécessaires pour convertir une prise de conscience très ancienne en volonté politique.
Approche ethnique
Comment donc concilier l’intérêt privé des entreprises avec l’intérêt général d’une nation qui s’étiole ? Comment conjurer la dénatalité française autrement qu’en recourant à une immigration qui, si elle la compense partiellement, en « altère » l’identité nationale ou ce que certains appelaient l’« ethnie française » ? Comment concilier les besoins en main-d’œuvre qui ne peuvent attendre avec la nécessité de peser sur les structures sociales ?
À tout le moins pouvait-on contourner ces dilemmes en n’admettant sur le territoire que des travailleurs étrangers dont les « caractères » se rapprochaient de ceux qui étaient, en vertu d’un « racialisme » [1] ambiant – qu’il ne faut pas confondre avec le racisme –, prêtés à une « ethnie » française que l’on voulait préserver. À l’évidence, la prégnance du malthusianisme français conspirait à faire douter du principe d’« omnipotence » de la société d’accueil [2], et à induire une approche ethnique de l’immigration dans la crainte de voir se dissoudre les « caractères naturels » de la population nationale.
Existait-il d’autres solutions ? S’il paraissait raisonnable d’escompter de l’immigration qu’elle vînt combler une partie du déficit de population ou étoffer la population active, rien, en revanche, ne permettait d’affirmer qu’une politique résolument nataliste amplifierait durablement la timide reprise des naissances, amorcée depuis l’hiver 1941-1942 : une politique de l’immigration est un pis-aller ou une concession que la politique nataliste, doutant de sa persuasion, sacrifie sur l’autel national de la repopulation ; elle est aussi un arrangement que la politique de main-d’œuvre consent à souscrire dans le cadre d’une conjoncture qui ne pénalise pas l’emploi national ; elle est enfin l’expression nationale d’un malthusianisme qui la redoute tout en l’instrumentalisant à l’insu des migrants eux-mêmes.
De l’État régulateur à l’État instituteur
La politique de l’immigration qui se met en place en 1945 porte en tout cas la marque du climat optimiste de l’époque. La « nationalisation » de cette politique, qui impliquait la suppression des sociétés privées d’immigration de l’entre-deux-guerres, eût sans doute été impossible si un mouvement « technocratique », éperonné sous Vichy, ne s’était épanoui au contact d’une Résistance prompte à dénoncer les « féodalités industrielles », avide de modernité et dévouée à l’instauration d’un État non plus régulateur mais ostensiblement instituteur.
Si cette politique est ainsi devenue une « affaire d’État », au moment même où s’ouvrait le chantier des nationalisations ou celui non moins symbolique de la sécurité sociale, c’est donc aussi en vertu d’un courant moderniste qui consacrait la prééminence de la haute fonction publique sur les élites traditionnelles de l’entre-deux-guerres, trop hâtivement taxées d’archaïsme. « Nous étions, a pu notamment écrire Simon Nora avec le recul du temps, le petit nombre qui savions mieux que les autres ce qui était bon pour le pays – et ce n’était pas complètement faux. Nous étions les plus beaux, les plus intelligents, les plus honnêtes et les détenteurs de la légitimité. Il faut reconnaître que, pendant trente ou quarante ans, le sentiment que j’exprime là, de façon un peu ironique, a nourri la couche technocratique » [3]. « Légitimité », voilà bien le maître mot de ce nouvel élitisme capacitaire, dont l’État planificateur, sûr de son monopole de l’expertise, serait comme la figure emblématique. À la certitude d’être en mesure de modeler en profondeur les structures de la société française s’est superposée la dénonciation sommaire d’un malthusianisme économique, qui devait conduire les pouvoirs publics à surestimer, dans l’immédiat, les capacités de redressement de l’économie française : qu’affluent des bras aux manches retroussées et celle-ci ne tarderait pas à renaître de ses cendres !
C’est donc à un État instituteur et planificateur, bien plus qu’au futur pouvoir politique, qu’incombera la tâche de conduire la nouvelle politique de l’immigration. Cette donnée constitutive, liée à l’activité du GPRF, explique, pour une part, l’étonnant silence politique dans lequel se développera l’immigration des années 1950 et 1960 : le crédit indéniable dont jouissaient alors la haute fonction publique et une administration lavée de ses récentes compromissions, a permis au pouvoir politique de déléguer un domaine qu’il savait par expérience sensible.
Priorité à la main-d’œuvre
Soit, mais la mise en œuvre d’une politique ne saurait se passer d’objectifs et de modalités d’exécution. Point question de souscrire aux prétentions, jugées exorbitantes [4], des démographes conduits par l’éphémère secrétaire général à la famille et à la population, Alfred Sauvy : « On agira, précise le ministère du travail, avec le souci constant de maintenir l’équilibre du marché du travail qui risque pendant longtemps encore d’être soumis à des fluctuations importantes du chômage en raison des difficultés de la reprise économique ». Restriction d’une haute importance, puisqu’elle revenait ni plus ni moins à briser le parallélisme inscrit dans la conception même de la nouvelle politique de l’immigration, en subordonnant le peuplement à la satisfaction des besoins conjoncturels en main-d’œuvre. D’ambivalente cette politique risquait fort de devenir conditionnelle : la profonde contradiction entre le structurel et le conjoncturel était en fait loin d’être levée ; elle se répercutera sur l’organisation administrative de l’immigration.
Les contingences avaient donc rattrapé les principes, fixant les obligations de la nouvelle politique. Celle-ci devra, en tout état de cause, tenir compte des déficits en main-d’œuvre des diverses branches industrielles, dont les besoins immédiats et à venir seront évalués ; apprécier qualitativement les éléments étrangers qu’il convient d’introduire sur le territoire ; mettre en œuvre un programme d’implantation et d’assimilation à leur intention. Un tel cahier des charges impliquait la définition préalable d’un programme d’équipement en main-d’œuvre et d’un plan de peuplement. Son exécution requérait, de surcroît, une combinaison administrative qui fût en mesure d’apporter simultanément satisfaction à des besoins conjoncturels et à des besoins structurels ; une combinaison qui permît de concilier le repeuplement (la politique de la natalité s’identifiant par contre-coup à une politique de la famille) avec les exigences capricieuses du marché de l’emploi. C’est donc fort logiquement que la politique de l’immigration va tenter de stabiliser son centre de gravité entre une politique de la main-d’œuvre et une politique de la (re)population [5], entre le ministère du travail et de la sécurité sociale, d’une part, et le ministère de la santé publique et de la population, d’autre part.
Sans être de sa compétence exclusive, la politique de la main-d’œuvre relevait pour l’essentiel du ministère du travail et de la sécurité sociale, doté depuis septembre 1944 d’une « Direction du travail » et d’une « Direction de la main-d’œuvre ». L’immigration ressortissait à la « sous-direction de la main-d’œuvre étrangère ».
À l’inverse de la politique de la main-d’œuvre, dont la sensibilité à la conjoncture apparaissait très vive, la politique de la population se déployait dans le long terme.
Les problèmes qu’elle abordait étaient du ressort exclusif du ministre de la santé publique et de la population, chargé, aux termes du décret du 24 décembre 1945, d’établir, « en ce qui concerne l’immigration, le plan démographique, notamment en coordonnant, compte tenu des besoins de main-d’œuvre [...], l’action des départements ministériels qui contrôlent l’admission et le séjour des étrangers, et en fixant le nombre maximum d’étrangers à admettre par département et par nationalité, de faciliter leur établissement familial ». Il disposait à cet effet d’un organe de réflexion : le Haut Comité de la population ; d’un organe d’information scientifique : l’Institut national d’études démographiques (INED), chargé d’établir chaque année « le bilan démographique » ; et d’un organe – en principe du moins – de décision : le « Comité interministériel de la population et de la famille ».
Une politique nataliste introuvable
Compte tenu des attributions du nouveau ministère, le Haut Comité de la population perdait son caractère originel d’organe de « synthèse décisionnelle » pour devenir une chambre de réflexion, habilitée à « fixer la nature des éléments étrangers - travailleurs et familles - dont l’introduction en France paraissait désirable au regard des conditions démographiques tant générales que locales ». L’exécution de la politique du peuplement tombait, en effet, entre les mains d’une « Direction générale de la population ».
En son sein, la « sous-direction du peuplement », appuyée sur deux bureaux aux dénominations éloquentes – « orientation de l’immigration » et « peuplement » – réfléchira une nouvelle frontière sociale qui présente cette particularité d’être interne – entre Français et étrangers récemment installés – et endogène – les naturalisations, acquisitions de la nationalité française, mariages ou unions provoquant son déplacement –, tout en étant externe – entre nationaux et étrangers autorisés à immigrer – et exogène – entre nationaux et les concentrations humaines qui sont susceptibles de se tourner vers l’immigration.
L’institution d’un ministère de la population coiffant cet ensemble a paradoxalement porté ombrage au Haut Comité, dont le secrétariat aurait pu, dans une configuration moins classique, s’appuyer sur le Comité interministériel de la population et de la famille à l’effet de relayer auprès des directions concernées la politique de la population.
Quant au transfert des « naturalisations » du ministère de la justice au ministère de la santé publique et de la population, en novembre 1945, il semble avoir répondu au souci de disposer, dans le cadre de la nouvelle politique de la population, de l’important levier que constituaient les quelque 200 000 dossiers en souffrance depuis 1939. Il n’est pas exclu qu’il se soit, en outre, opéré aux dépens du ministère de la justice qui manifestait quelque réticence à observer les consignes du secrétaire général du Haut Comité de la population, Georges Mauco [6].
Des objectifs divergents
Le traitement échelonné de ces dossiers n’avait pas en effet reçu, malgré la constitution d’une « Commission interministérielle des naturalisations » une issue conforme aux critères « ethnique, professionnel et géographique » que Georges Mauco avait arrêtés dès avril 1945, sans attendre la fin des travaux du Haut Comité. Le géographe devait d’ailleurs, dans une série de notes, se plaindre auprès du secrétaire général du GPRF, Louis Joxe, de l’absence de coordination entre le Haut Comité et la Commission, celle-ci procédant à la naturalisation « d’un grand nombre de méditerranéens et d’Arméniens ou d’étrangers exerçant des professions non directement productives et habitant pour la plupart dans les villes ». De ce point de vue, le nouveau code de la nationalité, institué par l’ordonnance du 19 octobre 1945, dont les dispositions, quoique libérales, sont en retrait par rapport à celles contenues dans la précédente loi du 10 août 1927, constitue un compromis entre les conceptions restrictives et racialistes de Georges Mauco et une tradition républicaine qui entendait, depuis 1889, mettre une politique libérale de la naturalisation au service d’une introuvable politique nataliste.
Entre deux axes symétriques, celui de la main-d’œuvre et celui de la population, la politique de l’immigration devait éprouver quelque difficulté à s’affirmer positivement, tant les préoccupations des deux principaux ministères étaient divergentes et même contradictoires. D’un côté, en effet, le ministère du travail entendait conserver la maîtrise des flux migratoires en préservant les intérêts de la main-d’œuvre nationale ; de l’autre, le ministère de la santé publique et de la population revendiquait un droit de regard sur la nature et l’importance de ces flux afin de les canaliser et de les fixer dans les départements et les régions accusant d’importants déficits de population. Or la carte industrielle était loin de recouvrir celle du ou des « déserts français » (pour reprendre l’expression célèbre de J.-F. Gravier). Au surplus, la restauration des secteurs clefs de l’industrie lourde et de l’énergie, géographiquement circonscrits, réclamait de fortes concentrations de travailleurs étrangers, qui s’opposaient à leur répartition sur le territoire.
Malgré cette contradiction fondamentale, la division des tâches entre les deux ministères semblait écarter tout risque de confusion ou d’empiétement : le ministère du travail établissait, avec l’aide d’une Commission nationale de la main-d’œuvre, les déficits de main-d’œuvre constatés dans chaque profession ; le ministère de la santé publique et de la population, appuyé sur le Haut Comité de la population, fixait la nature des éléments étrangers – travailleurs et familles – dont l’introduction en France paraissait désirable au regard des conditions démographiques tant générales que locales.
Dans la mesure où le ministère de la santé publique et de la population détenait les principaux leviers de commande et de coordination, sa prééminence sur le ministère du travail dans les questions migratoires apparaissait, en première analyse, incontestable. Elle n’était en réalité que relative, car la Direction générale de la population devait composer avec les directives d’un Haut Comité rattaché à la présidence du Conseil, alors que la Direction de la main-d’œuvre disposait, elle, d’une large autonomie décisionnelle. En outre, le ministère de la santé publique et de la population devait tenir compte des propositions du ministère du travail en ce qui concernait la main-d’œuvre pour établir le « plan annuel d’immigration », dont la charge lui avait été confiée par le décret du 24 décembre 1945 [7].
L’ONI au cœur des contradictions
Le contrôle du ministère du travail sur la politique de l’immigration se trouvait d’ailleurs nettement confirmé par la tutelle qu’il exerçait directement sur l’instrument d’exécution de la politique migratoire : l’« Office national d’immigration », institué par l’ordonnance du 2 novembre 1945 et organisé par le décret du 26 mars 1946. La création de cet organisme officiel, jouissant de la personnalité morale, marquait d’une manière éclatante la nouvelle emprise de l’État sur des tâches jusque-là confiées, sous son contrôle indirect, à des sociétés privées d’immigration. L’ONI était en effet, à titre exclusif, « chargé du recrutement pour la France et de l’introduction en France des immigrants étrangers, quelle que soit leur activité professionnelle ou leur qualité ». Il inscrivait donc son action à l’intersection des préoccupations quantitatives et qualitatives du ministère du travail et du ministère de la santé publique et de la population.
Son conseil d’administration, appelé à délibérer sur les conditions de réalisation des opérations d’immigration collective, comprenait un président choisi parmi les hauts fonctionnaires en activité ou en retraite, un premier vice-président représentant le ministre de la population et deux vice-présidents respectivement proposés par les ministres du travail et de la population [8] ; il comprenait, en outre, douze représentants des ministères intéressés (travail, population, affaires étrangères, intérieur, économie nationale, finances, production industrielle, agriculture, travaux publics, France d’outre-mer, reconstruction) ; quatre représentants des travailleurs et quatre représentants des employeurs ; enfin, deux personnes qualifiées par leur compétence particulière.
La représentation syndicale, qui sera supprimée par le décret du 20 septembre 1948, était destinée à responsabiliser les organisations ouvrières françaises en matière d’immigration et à les associer à la défense des intérêts des travailleurs immigrés. Par délégation du ministère du travail, l’ONI assume la responsabilité du recrutement et de l’examen des aptitudes professionnelles des travailleurs ; par délégation du ministère de la santé publique et de la population, il est tenu de procéder à l’examen médical indispensable à l’entrée des étrangers sur le territoire.
Le statut de l’Office est cependant bancal, puisqu’il « fonctionne auprès » du premier et qu’« il reçoit » du second « des directives de politique générale concernant les opérations d’immigration à réaliser » [9]. D’un côté donc, un droit de tutelle au sens plein ; de l’autre, le droit de donner des directives. L’ONI concentre ainsi, dans son fonctionnement, toutes les ambiguïtés d’une politique qui subordonne la repopulation harmonieuse du territoire à la satisfaction des besoins immédiats en main-d’œuvre.
On constate ainsi que la nouvelle politique de la population n’a pas dissimulé sa prétention à asservir une politique de l’immigration, sommée de répondre simultanément à des problèmes de structures et à des problèmes conjoncturels. Elle s’est greffée sur une politique de la main-d’œuvre qui avait, sous Vichy, démontré sa redoutable efficacité, sans parvenir concrètement à s’articuler sur son aînée : la politique du travail. Cette greffe endogène a trouvé sa raison d’être dans la certitude que la société française était ou serait incapable d’assurer, à elle seule, son redressement démographique. Elle dispensait d’attendre les effets aléatoires d’une politique nataliste, sans offrir l’assurance que l’« identité nationale » serait sauvegardée. Si cette opération s’est produite en 1945, c’est au fond parce que le pays doutait de son identité, le régime de Vichy ayant polarisé un véritable divorce entre la légalité et la légitimité. La France avait sans doute gagné la guerre, mais le souvenir de la débâcle de 1940 et des divisions intestines qui l’avaient précédée, était bien trop prégnant pour que l’identité du pays n’en fût pas affectée. Moment historique donc, qui voyait surgir, à côté de l’emploi, un nouveau « front », celui de la population : l’immigration était devenue partie prenante de l’identité nationale.
Des goûts et des couleurs...
En 1937, Georges Mauco donnait, dans le cadre de la Société des nations, une conférence sur l’assimilation des étrangers en France. Il s’appuyait notamment sur un « mini-sondage » réalisé dans une grande entreprise de construction d’automobiles (17 000 salariés dont environ 5 000 étrangers) auprès d’une dizaine de chefs de service (1) auxquels il avait été demandé de noter sur 10 leurs ouvriers étrangers, en fonction de différents critères. Ce grand spécialiste de l’immigration, inamovible haut fonctionnaire dès 1938, maintenu en fonction par de Gaulle et par ses successeurs jusqu’en 1970 (lire l’encadré biographique dans l’article de P. Weil « Naturalisations : le bon grain plutôt que l’ivraie ») a tiré de cette « enquête » le tableau ci-dessous (extrait de Mémoire sur l’assimilation des étrangers en France, avril 1937, Société des nations, repris par Patrick Weil dans La France et ses étrangers, Calmann-Lévy, Paris, 1991).
Valeur des ouvriers étrangers d’après leur nationalité
| Nationalités classées par ordre de valeur | Nombre d’étrangers | Aspect physique | Régularité au travail | Production à la journée | Production aux pièces | Mentalité, discipline | Est-on satisfait de cette main-d’oeuvre ? | Facilité de compréhension de la langue française | Classement moyen | |
| Total de points | Note générale | |||||||||
| Belges et Luxembourgeois | 297 | 10 | 8,1 | 8,1 | 10 | 6,8 | 10 | 10 | 63 | 9 |
| Suisses | 109 | 10 | 7,5 | 8,1 | 9,2 | 8,1 | 8,5 | 8,1 | 59,5 | 8,5 |
| Italiens | 427 | 7,5 | 7,5 | 6,2 | 7,8 | 5,3 | 8,5 | 8,7 | 51,5 | 7,3 |
| Tchèques et Yougoslaves | 162 | 8,1 | 6,2 | 6,8 | 7,1 | 6,2 | 8,5 | 4,3 | 47,2 | 6,7 |
| Russes | 994 | 8,7 | 7,5 | 4,3 | 7,8 | 6,8 | 8,5 | 3,1 | 46,7 | 6,6 |
| Espagnols et Portugais | 296 | 5,7 | 7,5 | 4,2 | 6,6 | 5,7 | 9,1 | 7,1 | 45,9 | 6,5 |
| Polonais | 295 | 8,7 | 6,8 | 6,2 | 8,5 | 6,5 | 5 | 3,1 | 44,8 | 6,4 |
| Arméniens | 411 | 6,2 | 6,8 | 2,8 | 6,6 | 7,8 | 8 | 5,6 | 43,8 | 6,3 |
| Chinois | 212 | 4,3 | 7,1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2,1 | 42,5 | 6,1 |
| Grecs | 141 | 5,6 | 5 | 3,7 | 5,8 | 6,4 | 5,7 | 4,3 | 36,5 | 5,2 |
| Arabes | 1730 | 1,2 | 4,3 | 1,2 | 3,2 | 2,8 | 4,2 | 3,7 | 20,6 | 2,9 |
| Total | 5 074 | |||||||||
Notes
[1] Sur ce concept de « racialisme », voir P.-A. Taguieff, Les fins de l’anti-racisme, La Découverte, 1995, p. 134.
[2] Emmanuel Todd, Le destin des immigrés. Assimilation et ségrégation dans les démocraties occidentales, Seuil, 1994.
[3] Simon NORA, « Servir l’État », Le Débat, n ̊ 40, 1986, p. 102.
[4] Alfred Sauvy distinguait la « capacité d’absorption de main-d’œuvre » de la « capacité d’absorption démographique du territoire national ». Selon la première hypothèse, l’immigration pouvait concerner 1 450 000 adultes ; selon la seconde, 5 490 000, le modèle de référence étant la Grande-Bretagne ou les Pays-Bas.
[5] L’aspect international de l’immigration restant entre les mains du ministère des affaires étrangères (« Direction des conventions administratives »), l’aspect sécurité incombant au ministère de l’intérieur (« Direction des étrangers »).
[6] Sur les prises de position et le rôle de Georges Mauco, voir, dans ce numéro : « Naturalisations : le bon grain plutôt que l’ivraie ».
[7] Plan qui, à notre connaissance, n’a jamais vu le jour.
[8] Par décret du 26 mars 1946, Pierre Tissier, conseiller d’État, et Racamond, secrétaire général de la CGT, sont nommés respectivement président et premier vice-président du conseil d’administration de l’ONI.
[9] Décret du 26 mars 1946.

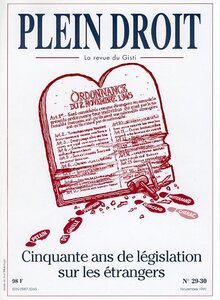
![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)










Partager cette page ?