|
|
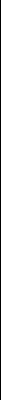
|
Plein Droit
n° 15-16, novembre 1991
« Immigrés :
le grand chantier de la “dés-intégration” »
Une très exceptionnelle régularisation
Retour au sommaire
On a trompé les déboutés du
droit d'asile. Les circulaires des 23 juillet, 14 août
et 25 septembre 1991 ne changent rien à leur sort. Un an
et demi durant, ils auront en vain utilisé tous les moyens de
persuasion possibles : malgré les promesses — il
est vrai partiellement orales — du gouvernement, ils restent,
dans leur immense majorité, condamnés à la clandestinité
ou au retour forcé dans leurs pays d'origine.
Voir aussi l'encadré « Un
tour dans les circulaires »
Au terme de sept grèves de la faim impliquant près de
200 déboutés, en avril et en mai derniers,
à Bordeaux, Fameck (près de Metz), Mulhouse, Paris, Saint-Dizier,
Strasbourg et Val-de-Reuil (près d'Evreux), le ministre des Affaires
sociales et de l'Intégration, Jean-Louis Bianco, avait pourtant
promis, le 24 mai, de revoir la situation de ceux qui « se
sont insérés socialement, familialement et professionnellement
et ont un emploi durable ». Quelques semaines plus tard,
le gouvernement publiait une circulaire excluant, par exemple, de la
régularisation les déboutés arrivés après
le 1er janvier 1989, année des demandes d'asile les plus
nombreuses.
Conscients de la tromperie dont ils étaient victimes à
la faveur de l'été, sur la base de courageux calculs électoraux,
les déboutés n'ont pas baissé les bras : Bourges,
Châlons-sur-Marne, Creil, Orléans, Paris, Strasbourg ont
relancé le mouvement des grèves de la faim, dont la plupart
se sont soldées par l'obtention, pour les seuls jeûneurs,
de quelques avantages relatifs. Mais, sur le fond, rien n'a changé :
les déboutés du droit d'asile restent, en masse, exclus
des bénéfices d'une mesure de régularisation présentée
comme « exceptionnelle ».
Si « exceptionnelle » d'ailleurs, au regard de
ses objectifs affichés, qu'elle allait entraîner, sans
plus tarder, le 14 août, la publication d'un nouveau texte
qui, lui, avouerait sans vergogne la signification réelle de
l'opération : la circulaire « relative au programme
d'aide à la réinsertion des étrangers invités
à quitter le territoire », que l'administration
traite en termes pudiques d'« aide à la réinsertion »,
comme s'il s'agissait d'un cadeau. Vingt-trois jours à peine
s'écoulent d'une circulaire à l'autre, qui disent la préméditation
de la part des pouvoirs publics.
Un progrès humanitaire
à reculons
Le piège se referme donc sur les déboutés, aux accents
d'une musique démagogique destinée à l'opinion publique.
Fermeté à l'encontre des étrangers, mais « générosité »
puisqu'il s'agit de pauvres issus du tiers-monde. On les aide,
comme il se doit modestement, dès lors qu'ils admettront de bon
gré avoir franchi les « seuils de tolérance »
en prétendant à l'asile en France, et s'en retourneront
volontairement, qui en Turquie et au Kurdistan [1],
qui au Sri-Lanka, en Haïti, au Togo ou au Zaïre, goûter
aux charmes de leurs pays d'origine avec, en poche, 1000 F par adulte
et 300 F par enfant. Les récalcitrants partiront sans ce ridicule
pécule.
Tel est, à grands traits, le contenu de l'« ouverture »
concédée aux déboutés.
Deux questions fondamentales restent sans réponse faute d'avoir
été posées par les pouvoirs publics. Qui sont les
déboutés du droit d'asile ? Et que deviendront-ils
au terme de cette très exceptionnelle opération de régularisation
qui s'achèvera le 30 novembre 1991 ?
Silence d'abord sur l'histoire qui les a conduits en France. Il légitime
la rumeur selon laquelle tout demandeur d'asile ou presque viole aujourd'hui
la Convention de Genève, protectrice des seuls politiques. Puisqu'ils
viennent de pays pauvres, leur seul motif d'exil ne saurait être
que la misère. Tel est du moins le postulat. Corollaire :
la circulaire du 23 juillet leur offre, avec parcimonie, une simple
prime à l'ancienneté.
Pour la forme, de toute évidence, surtout si l'on en juge par
les pratiques observées dans les préfectures, on trouve
mention de la possibilité d'attribuer, hors critères d'ancienneté
et d'insertion, une carte de séjour « à titre
humanitaire » à des cas « particulièrement
dignes d'intérêt » ou, selon les termes maintenus
de la circulaire Pandraud (5 août 1987), lorsque le débouté
« établit qu'il est exposé à des risques
sérieux pour sa sécurité ou sa liberté en
cas de retour dans son pays d'origine ».
Dans les faits, ces précautions ont un caractère purement
symbolique. Aux guichets des préfectures, les dossiers sont examinés
sur le seul plan quantitatif : date d'entrée en France,
durée de la procédure, temps de travail régulier.
Le reste — dangers et craintes — appartient au champ
des recours ultérieurs, aussi aléatoires que sous le régime
de la circulaire Pandraud. A la différence notable près
que les « risques sérieux », jadis
situés sur le même plan que les conditions d'insertion,
se trouvent désormais rejetés en annexe, mollement rappelés
in extremis pour mémoire. Le progrès humanitaire
marche à reculons.
La fiction d'un jugement équitable des demandeurs d'asile à
l'Office français de protection des réfugiés et
apatrides et devant la Commission des recours dispense, en pratique,
l'administration de revenir sur le passé des déboutés,
même si 75 % d'entre eux n'ont jamais pu obtenir un entretien
dans les services de l'OFPRA. La récente expérience d'Orléans
prouve le caractère surréaliste de cette position :
là, les trente-huit grévistes de l'été,
originaires de Turquie et de Guinée-Bissau, ont arraché
le droit d'être entendus par une commission ad hoc de la
préfecture. Leurs explications circonstanciées ont permis
à vingt-cinq (plus des deux tiers) d'entre eux d'obtenir d'emblée
leur régularisation ; les arguments des autres font actuellement
l'objet d'une vérification, qui pourrait aboutir à de
nouvelles décisions positives.
La loi du silence
Aurait-on peur que la liberté d'expression des déboutés
— et, en amont, celle des demandeurs d'asile — invalide
l'ensemble des pratiques actuelles de la procédure française
de détermination du statut de réfugié ? De ce
point de vue, la circulaire du 8 octobre 1991 du ministère
de l'Intérieur, interdit l'espoir d'une amélioration. Ce
texte, immédiatement exécutoire et curieusement intitulé
« Amélioration du traitement des demandes d'asile
à la frontière », définit les modes
de fonctionnement de l'OFPRA sur les aéroports de Paris et aux
postes-frontières. L'audition des demandeurs y sera « systématique ».
A Roissy, le bureau de l'Office « est situé en
zone internationale » où, par définition,
l'application du droit est la plus facultative. « Aux frontières
terrestres et maritimes, ainsi que dans les aéroports de province,
les demandes d'asile sont examinées par l'OFPRA par le biais
d'un échange de correspondances télécopiées ».
Cette circulaire ne cache pas qu'elle s'insère dans l'ensemble
« des décisions prises par le gouvernement, lors
du comité interministériel du 9 juillet 1991, sur
la maîtrise de l'immigration ». « Amélioration »
y rime donc avec « non admission» avec moins de garanties
juridiques que jamais, même si le Haut Commissariat pour les réfugiés
(HCR) « peut » intervenir. Il devra faire
preuve de célérité car il est prévu que
le délai d'intervention de l'OFPRA n'excèdera pas deux
jours ouvrables, au mieux.
Qu'il s'agisse des déboutés fabriqués à
la chaîne tout au long de ces dernières années ou
des demandeurs d'asile présents et futurs, toute réforme
se traduit ainsi par l'instauration de restrictions quantitatives aveugles
sans rapport avec les causes — de nature essentiellement qualitative —
qui expliquent en grande partie l'inflation du nombre de candidats au
statut de réfugié.
De même que la circulaire du 23 juillet 1991 évite
de redonner la parole à des déboutés qui, pour
l'essentiel, ne l'ont jamais eue, de même la récente circulaire
du 8 octobre interdit aux nouveaux demandeurs d'asile toute chance
d'explication en profondeur de leur cas. Seul changement prévisible
pour les années à venir : au lieu de débouter
en aval, c'est-à-dire en France, ceux qu'elle écartait
jusqu'alors du statut au terme d'une procédure superficielle,
la machine les déboutera en amont, hors du territoire national,
avant la mise en œuvre de la moindre véritable procédure.
Dans les deux cas de figure, la loi du silence s'impose comme règle
d'or du respect officiel du droit d'asile.
Cette vieille surdité institutionnelle, en voie de rajeunissement,
a permis, sous sa forme ancienne, de fabriquer, au cours des dernières
années, les 100 000 acteurs directs ou indirects des
grèves de la faim des derniers mois. Ceux-là sont entrés
en France avant le 1er janvier 1990. Ils ont cumulé tous
les inconvénients : pour eux, la procédure fut non
seulement injuste mais longue, parfois interminable. Ils attendaient
depuis des mois, voire des années, que l'on se prononçât
sur leur demande d'asile, et tout à coup, au début de
1990, sur injonction du gouvernement de l'époque, l'OFPRA a vidé
ses « stocks » à la « vitesse
TGV ». Naturellement, neuf fois sur dix, le verdict fut
négatif [2]. Pour la plupart
insérés dans la société française,
ils se retrouvent alors soudainement sans titres de séjour ni
de travail et priés de quitter la France sous trente jours.
D'où la revendication du Réseau d'information et de
solidarité [3] d'une régularisation
exceptionnelle en leur faveur : « Réparer un
dol administratif », comme l'expliquait l'Abbé
Pierre en mai dernier, quand il rejoignit les grévistes
de la faim de Saint-Joseph-des-Nations à Paris. Dans une lettre
qu'il adressait alors au gouvernement, il demandait : « Que
soit décidé que ceux qui avaient reçu leur récépissé
avant le 1er janvier 1990 — donc ayant vécu dans
l'espérance 15 mois et, pour le plus grand nombre, il s'agit
non de mois mais d'années — se voient attribuer,
parce que sont pris en considération le tort qu'ils subiraient,
qu'ils ont subi, et la cruauté qu'aurait leur rejet, alors que
leur intégration s'est largement effectuée, permis de
résidence et de travail » [4].
Des dizaines
de chausse-trappes
La circulaire du 23 juillet 1991 ignore ces appels. Tous ses critères
d'admissibilité et d'admission relèvent d'une intention
d'exclusion. A commencer par le choix de la date ultime d'entrée
en France — 1er janvier 1989 — qui ne tient compte
(ou qui en tient trop compte) ni des effets du changement de mode de travail
de l'OFPRA, intervenu un an plus tard, ni du fait que 48 % des déboutés
concernés, arrivés en 1989, sont donc, sans autre de forme
de procès, éliminés [5].
A cette barrière révélatrice de la volonté
réelle des auteurs du texte, s'ajoutent d'autres pièges.
Ainsi, pour 65 % des déboutés, la procédure
d'examen de leur demande d'asile a duré de cinq à vingt-quatre
mois : on exige cependant des « isolés »
(sans enfants, 71,5 % dans ce cas) une procédure minimale
de trente-six mois. De même, du fait de ce délai d'attente
à l'OFPRA et devant la Commission des recours, la plupart ont
bénéficié d'une autorisation de travail de deux
années au maximum : il leur faut néanmoins apporter
la preuve d'emplois « réguliers »
d'au moins vingt-quatre mois, comme si les opportunités professionnelles
tombaient du ciel.
Par ailleurs, pour prétendre aux conditions allégées
de régularisation, ces exilés, majoritairement entrés
en France depuis 1987 — soit depuis quatre ans au mieux —
doivent malgré tout avoir des enfants « scolarisés »,
les plus jeunes n'étant pas considérés comme des
signes d'insertion. Quand on sait les difficultés croissantes
rencontrées par les familles étrangères pour inscrire
leurs enfants à l'école...
Les chausse-trappes de la circulaire se comptent par dizaines. A celles
qui guettent les déboutés pour prétendre à
la régularisation, s'ajoutent celles qui déterminent leur
admission. La première nie leur passé de demandeurs d'asile
par l'exigence humiliante, voire dangereuse pour eux, d'un passeport.
Elle les contraint à reconnaître à nouveau l'autorité
de l'Etat qu'ils ont fui et à accepter sa protection. En majorité
arrivés sans papiers, ils doivent, en effet, demander à
leur ambassade qu'elle leur délivre le précieux document.
Cette démarche est d'autant plus inévitable que, sur la
nécessité d'un passeport, une bonne partie des préfectures
ont enchéri en imposant un « passeport en cours
de validité ».
La deuxième condition d'admission prévoit la production
d'un contrat de travail à plein temps (mi-temps pour les seules
« familles monoparentales ») à durée
indéterminée ou à durée d'au moins un an.
Mesure kafkaïenne encore et d'une duplicité raffinée :
l'administration fait mine de sélectionner ainsi les anciens
demandeurs d'asile qui montrent les meilleures aptitudes à l'insertion
dans le marché du travail. Mais elle garde benoîtement
le silence sur le fait que cette « ouverture » s'adresse
à des individus qui ont été précipités
par ses soins dans la clandestinité, puisque tous ou presque
se sont vu retirer leur titre de travail dès lors que la Commission
des recours s'était prononcée négativement à
leur encontre. Interdits d'emploi, ils doivent néanmoins dénicher
un patron qui s'engage, sur leur seule bonne mine, à les embaucher
pour une année au moins. Au moment de la signature du contrat,
agrémenté d'une taxe de 4 500 pour les smicards,
rien n'autorise, en effet, l'employeur à utiliser, ne serait-ce
qu'à l'essai, son futur salarié. Les officines de marchands
de contrats bidons ont, de la sorte, grâce aux pouvoirs publics,
de beaux jours de prospérité devant elles, au moment même
où le gouvernement se flatte de lutter opiniâtrement contre
les exploiteurs de main-d'oeuvre au noir.
La circulaire du 23 juillet est donc, en elle-même et dans
sa mise en œuvre, un piège à déboutés.
Sous prétexte de concession à leur combativité,
elle tente de les attirer dans un leurre. Tout y est, en réalité,
prévu pour les renvoyer à la clandestinité dont
ils veulent sortir. Combien seront en fin de compte régularisés ?
Sans doute moins de 10 000, soit une part inférieure à
10 %. L'administration ne manquera pas de profiter de ce score
pour accuser les associations d'avoir sciemment gonflé leurs
évaluations en avançant le chiffre de 100 000, oubliant
que la rapide désillusion des déboutés a dissuadé
nombre d'entre eux d'aller se faire enregistrer pour rien aux guichets
des préfectures.
Vers des charters électoraux ?
A quoi peut bien servir une opération aussi contradictoire ?
A l'évidence, on aurait pu en faire l'économie, la vieille
circulaire Pandraud suffisant amplement à mener à bien une
régularisation aussi exceptionnelle. A moins qu'il ne s'agisse,
au fond, de tout autre chose : par exemple, d'une simple actualisation
de fichiers, utile aux amateurs de charters électoraux. Les automobilistes
ont appris, en septembre dernier, que le permis de conduire à
points verrait le jour avec six mois de retard, en juillet au lieu
de janvier 1992 : le dispositif informatique prévu pour
cette opération recueille aujourd'hui les informations demandées
aux déboutés lors de leur passage en préfecture ;
adresses personnelles et professionnelles y sont soigneusement répertoriées,
comme celles de victimes peut-être déjà désignées
pour des retours spectaculaires, potentiellement fertiles en bulletins
de vote dans les années qui viennent.
Les pouvoirs publics savent que les déboutés ne partiront
pas tous, loin s'en faut. Mais la flatteuse annonce de statistiques
d'expulsions en hausse ou la retransmission télévisée
de l'envol d'une poignée d'avions pleins de quelques centaines
d'entre eux pourraient séduire bientôt les électeurs
qui manquent. D'autant que, faute de précisions sur ces passagers,
ils y verront de banals étrangers en situation irrégulière.
Quant aux dangers et aux menaces dans les pays d'origine, les caméras
ne les filmeront pas. Ni vus ni connus.
Que ces hypothèses se vérifient ou pas, l'immense majorité
restera en France. Pour des raisons bien compréhensibles, les
Kurdes feront l'impossible pour éviter leur retour en Turquie ;
les Zaïrois leur retour au Zaïre ; les Haïtiens
en Haïti ; les Sri-Lankais chez eux, comme tant d'autres issus
de pays incertains ou en crise. Chacun le sait, à commencer par
les responsables politiques qui agissent, de ce fait, exactement comme
s'ils souhaitaient conserver un volume de main-d'oeuvre en situation
d'irrégularité, propice aux secteurs économiques
les plus fragiles, alors que leur était offerte une occasion
rêvée d'assainir une partie de la situation sur des bases
humanitaires admissibles par tous.
Mais il leur faut — question de mode et de look,
sans doute — sacrifier néanmoins aux rites des droits
de l'homme. La circulaire du 14 août 1991 révèle,
de ce point de vue, outre les intentions cachées de la circulaire
du 23 juillet, d'extraordinaires qualités imaginatives.
Ce texte au titre prometteur — « Programme d'aide
à la réinsertion des étrangers invités à
quitter le territoire » — fait comme si des
foules de clandestins (déboutés en tête, puisqu'il
leur revient le mérite d'avoir stimulé son élaboration)
allaient se bousculer aux portes de l'Office des migrations internationales (OMI)
pour empocher la misérable prime au départ de 1000 F.
Deux mois et demi après sa publication, trois ou quatre dizaines
à peine de candidats ont confirmé leur volontariat. C'est
tout dire.
Rien n'aura été négligé pour asseoir la
bonne notoriété du programme. Attachés humanitaires
dans les ambassades de France (vite disparus de la liste annoncée
des bons samaritains, cautions de l'opération), organisations
humanitaires et organisations non gouvernementales (ONG) de développement
auront été invités à la fête :
les uns pour recruter et persuader les « cibles » ;
d'autres pour concourir aux voyages ; certains enfin pour garantir
à quel point un tel retour d'immigrés dans le tiers-monde
ne manquerait pas d'apporter un second souffle au développement.
Il faudra identifier un jour ceux qui, dans l'ombre, auront cédé
aux chants des sirènes et conjugué droits de l'homme avec
reconduites à la frontière.
Comme un bruit
d'« asile intérieur »
En attendant, le Centre de recherche et d'information pour le développement
(CRID), collectif de trente-deux ONG, a exprimé, le 23 septembre,
sa « plus grande réserve face à un dispositif
qui vise à concrétiser très rapidement un nombre
important de projets de réinsertion ». Il note que
« l'opération d'aide au retour vise surtout des demandeurs
d'asile déboutés invités à quitter le territoire.
Or, compte tenu du caractère sommaire des procédures qui
ont présidé à l'examen de leurs dossiers, on peut
estimer que nombre de ces déboutés auraient dû bénéficier
du statut de réfugiés politiques. Ceux-là craignent
pour leur liberté, voire leur vie en cas de retour dans leur pays
d'origine », précise le CRID dans ce communiqué
qui met, par ailleurs, en doute le « caractère réellement
volontaire de leur décision de quitter la France ».
Tout avait pourtant été essayé pour promouvoir
l'honorabilité du projet de « retour aidé ».
Les pouvoirs publics ont tenté de mettre en avant l'enthousiasme
de certains Etats à cette perspective. Sénégal,
Mali ou Haïti auraient, dès septembre, souscrit de bon coeur
à des accords bilatéraux en ce sens. Manque de chance,
le ministre des Affaires étrangères de Bamako devait,
le jour même cette annonce, démentir son consentement et
affirmer sa volonté de ne voir aucun débouté rentrer
au pays dans ces conditions ; avant le coup d'Etat militaire du
30 septembre, le régime démocratique haïtien
devait également exprimer ses plus extrêmes réserves.
D'intéressantes révélations sur une conception
française futuriste du droit à l'asile ont été
esquissées à l'occasion de cette recherche de parrains
humanitaires destinée à rendre le projet présentable.
Notamment l'idée selon laquelle on pourrait imaginer l'installation
des populations menacées dans une autre région de leur
propre pays — par exemple des Kurdes en Turquie mais
hors du Kurdistan turc — de façon à éviter
leur éparpillement sur la planète, tout particulièrement
dans l'Hexagone. Cette théorie, qui ne dit pas encore son nom,
rappelle celle de l' « exil intérieur »,
susceptible, si l'on n'y prend garde, de multiplier les camps à
travers le monde sous le couvert d'une politique du « chacun
chez soi» qui interdit aux pauvres, même victimes de persécutions,
d'en appeler à une solidarité effective et de prétendre
à la libre circulation des personnes.
Les « grands pays des droits de l'homme» ne sont décidément
plus ce qu'ils prétendent être.
Une concertation
en forme de piège
Quoiqu'il en soit, les clauses de sauvegarde insérées dans
les deux circulaires, qui ménagent une petite et ultime chance
d'évaluation des risques en cas de retour, montrent à quel
point les autorités françaises doutent elles-mêmes
de la validité des jugements censés garantir que les déboutés
ne sont pas de légitimes réfugiés interdits de statut.
Pourquoi, dans ces conditions, tromper les déboutés quand
il reste possible d'imaginer une solution raisonnable à la crise ?
De toute évidence, convenablement informée sur leur histoire
et sur leur véritable identité, l'opinion publique peut
admettre le bien-fondé de leur volonté de rester en France,
tant pour s'y protéger de l'oppression que parce qu'ils y sont
insérés de longue date sur les plans familial et professionnel [6].
Dans un message intitulé « Une colère qui est
aussi la nôtre » , rendu public le 3 mai, Mgr Pierre
Joatton, au nom de la Conférence épiscopale des évêques,
avait demandé « aux responsables politiques d'entendre
le désespoir » des déboutés. « Engendrer
des exclus, précisait-il, nous semble déshumanisant
pour tous, pour les déboutés eux-mêmes et également
pour la société qui les rejette ».
La pression des grèves de la faim, puis, le 25 mai, la plus
massive des manifestations d'étrangers en France depuis de nombreuses
années (au moins 10 000 personnes dans la rue, à
Paris, de Strasbourg-Saint-Denis à La Madeleine), ont incité,
à ce moment, le gouvernement à ouvrir une concertation avec,
notamment, les associations du Réseau d'information et de solidarité.
Après des déclarations de principe d'ouverture — « Le
ministre des Affaires sociales souhaite ardemment que des solutions apportent
aux grévistes de la faim les raisons de mettre un terme à
leur mouvement et aux souffrances qu'il entraîne » —
, tout n'a cessé de régresser comme s'il s'agissait, dès
l'origine, de briser simplement la détermination des déboutés.
Non seulement les circulaires n'ont rien changé à leur
avenir, mais même les anciens grévistes tardent encore
à bénéficier des engagements de Jean-Louis Bianco ;
une grande partie d'entre eux restent, en octobre, dans l'attente,
sous la menace d'injonctions à quitter le territoire et interdits
d'emplois.
Et, comme s'il s'agissait de bien souligner le caractère négligeable
des mesures de régularisation exceptionnelle, aucun moratoire
n'a jamais pu être obtenu des pouvoirs publics, protégeant
l'ensemble des déboutés de toute mesure d'éloignement
pendant les quatre mois d'application de la circulaire du 23 juillet
qui, faute d'avoir été signée par les ministres
compétents et d'avoir été publiée au Journal
officiel, n'a pas l'autorité juridique nécessaire
à sa reconnaissance par les tribunaux.
Reste aux déboutés à espérer dans la détermination
et l'influence du Comité de suivi exigé par les associations
et composé d'André Jeanson, de Jacques Monestier, de l'Abbé
Pierre et du Pasteur Jacques Stewart [7].
En acceptant d'y participer, les deux derniers ont indiqué, le
6 juillet, leur volonté de garantir « la bonne
application des mesures exceptionnelles, dérogatoires et humanitaires »
prises en faveur des déboutés et de veiller à l'
« élaboration de propositions pour l'amélioration
des conditions du droit d'asile en France ».
L'ultime espoir des déboutés repose désormais largement
sur les épaules de ces quatre sages.
Notes
[1] A l'occasion de la campagne pour
les élections législatives organisées en octobre 1991
en Turquie, l'un des thèmes principaux de l'opposition a porté
sur la « transparence » des commissariats
et des prisons. Ce qui en dit long sur la légitimité,
pourtant souvent contestée, des demandeurs d'asile originaires
de Turquie.
[2] Plein Droit,
n° 10, mai 1990.
[3] Le Réseau d'information
et de solidarité regroupe les associations suivantes : Accueil
et Promotion, CAIF, CIEMI, Cimade, CLAP, FASTI, GISTI, GREC, MRAP, Service
national de la Pastorale des migrants. D'autres associations les ont
rejointes dans la campagne nationale en faveur des déboutés
lancée dès le premier semestre 1990 : Aide aux demandeurs
d'asile d'Afrique centrale (ADAAC), Aide aux demandeurs d'asile d'Afrique
de l'Ouest (ADAAO), Aide et soutien aux Haïtiens de France (AISOHAF),
Collectif des femmes immigrées, Comité de travail des
Turcs et Kurdes en France, Groupe Cap Vert-Guinée Bissau.
[4] Lettre de l'Abbé
Pierre au Premier ministre, au ministre des Affaires sociales et de
l'Intégration, au ministre de l'Intérieur, au secrétaire
d'Etat à l'Intégration et au secrétaire d'Etat
à l'Action humanitaire, 20 mai 1991.
[5] Les chiffres relatifs
à la situation des déboutés sont tirés de
« Demandeurs d'asile déboutés »,
Réseau d'information et de solidarité, avril 1991,
20 F.
[6] Voir le sondage IPSOS
sur l'image des réfugiés politiques, réalisé
en France à la demande de la Fondation Amir Jahanchahi, en mai
et août 1991 (le Monde, 21 septembre 1991).
[7] Comité de suivi
des déboutés, BP 39 007, 75 327 Paris Cedex 07.
Retour au sommaire

Dernière mise à jour :
19-12-2000 20:17.
Cette page : https://www.gisti.org/
doc/plein-droit/15-16/regularisation.html
|



 En ligne
En ligne
