|
|
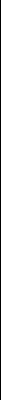
|
Plein Droit
n° 20, février 1993
Europe : un espace de « soft-apartheid »
Réglementation des étrangers :
dispositions récentes
Retour
au sommaire
Entrée
Le feuilleton de la zone « internationale » ou « de
transit » s'est clos (sur le plan parlementaire) par le vote
de la loi dite Quilès le 6 juillet 1992, comportant
essentiellement la nouvelle rédaction de l'article 35 quater
de l'ordonnance de 1945 sur les zones d'attente aux frontières,
zones où sont maintenus les étrangers dont l'entrée
en France est jugée indésirable (on se rappelle que la première
version de l'article 35 quater, l'« amendement Marchand »,
avait fait l'objet de la censure du Conseil constitutionnel).
Une circulaire d'application, datée du 9 juillet
1992, a suivi de peu le vote de la loi, et un décret du
15 décembre 1992 fixe les règles de procédure
qu'impose l'intervention de l'autorité judiciaire dans la décision
de maintien en rétention de l'étranger.
En revanche, plus de six mois après la loi, on attend toujours
la publication du ou des décrets qui définiront les modalités
d'intervention des associations humanitaires auprès des étrangers maintenus.
A ce jour, la mise en pratique de la disposition de la loi qui prévoit
que « l'étranger peut demander l'assistance d'un
interprète et d'un médecin et communiquer avec un conseil
ou toute personne de son choix », n'est pas des plus faciles. [1].
Étudiants
Une circulaire du 29 octobre 1991 (qui n'a fait l'objet d'aucune
publicité), émanant du ministère de l'Intérieur,
invite les préfectures à vérifier, lors de l'instruction
des demandes de renouvellement de titres de séjour « étudiant »,
la réalité et le sérieux des études poursuivies,
notamment en « demandant à en connaître les
résultats ». Confirmant une pratique courante, cette
circulaire renforce le climat de suspicion à l'égard des
étudiants étrangers, et confie de façon fort contestable
aux services préfectoraux une mission qui ne devrait relever que
des établissements d'enseignement. [2].
Mariages
Dans une circulaire du 16 juillet 1992, le ministère
de la Justice donne des indications aux procureurs pour une « harmonisation
des pratiques des parquets en matière de consentement au mariage ».
Sans qu'ils soient expressément désignés, les étrangers
candidats au mariage sont la cible de cette circulaire, dont la publication
s'inscrit dans la politique actuelle de chasse au mariage blanc. On notera
en particulier l'hypocrisie de la position de la Chancellerie qui, tout
en précisant que le fait que l'un des futurs conjoints soit en
situation irrégulière ne peut être un motif pour que
les officiers d'état-civil refusent la célébration
d'un mariage, rappelle cependant que ceux-ci ont le devoir de transmettre
au procureur tout renseignement relatif à l'établissement
d'un crime ou d'un délit. La situation irrégulière
constituant un délit, voilà donc validé le circuit mairie-procureur-préfecture
qui, de fait, peut empêcher un étranger sans papiers de se
marier.
Autorité parentale
La modification de l'article 372 du code civil (loi du
8 janvier 1993) a des incidences sur l'application de l'article 15-3
de l'ordonnance de 1945, qui prévoit la délivrance de
plein droit d'une carte de résident au parent d'enfant français
à condition qu'il exerce l'autorité parentale sur cet
enfant. Jusqu'alors, dans le cas de parents naturels, il était
nécessaire de faire établir une déclaration conjointe
en vue d'exercer en commun l'autorité parentale. Désormais,
celle-ci est présumée exercée en commun si les
parents de l'enfant naturel vivent ensemble au moment de la reconnaissance
(concomitante ou décalée), à condition que celle-ci
ait lieu avant que l'enfant ait atteint l'âge d'un an.
Retour
au sommaire
Retour
au sommaire
Notes
[1] Sur les difficultés
soulevée par la loi, voir le document de l'Anafé :
« Entrée sur le territoire : difficultés », octobre
1992.
[2] Voir la « Note
complémentaire à la brochure sur la situation juridique
des étudiants étrangers en France. La circulaire du 29 octobre
1991 », Gisti, juin 1992.

Dernière mise à jour :
6-02-2001 11:55.
Cette page : https://www.gisti.org/
doc/plein-droit/20/reglementation.html
|



 En ligne
En ligne



 En ligne
En ligne

