|
|
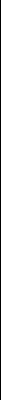
|
Plein Droit n° 14, juillet 1991
« Quel droit à
la santé pour les immigrés ? »
Annie Thébaud-Mony
Catherine Lepetit
En France, comme dans les autres pays industrialisés,
la tuberculose a beaucoup régressé au cours du XXème
siècle. Ceci est dû en partie à l'amélioration
des conditions de vie de fractions importantes de la société
française, surtout depuis le début des années 50,
et à l'application du traitement antibiotique. Cependant, aujourd'hui,
la tuberculose n'a pas disparu et demeure un indicateur d'inégalités
sociales, les groupes sociaux dans lesquels l'incidence est la plus
forte étant toujours ceux qui vivent en situation de précarité
sociale et économique. Dans les pays d'industrialisation ancienne,
la prévalence de la tuberculose est faible en moyenne nationale.
Mais elle reste élevée dans les communautés d'origine
étrangère. C'est le cas en France.
Un débat existait dans la première moitié
du siècle, entre ceux qui attribuaient la tuberculose à
la « misère physique et morale » — aux
« comportements à risque », dirait-on aujourd'hui —
caractéristique de la « culture ouvrière »,
et ceux qui y voyaient une conséquence des conditions de vie
très dures des ouvriers au début du siècle. De
même, aujourd'hui, des thèses s'affrontent concernant la
tuberculose : « maladie importée »,
« maladie de la transplantation », de la « condition
immigrée », ou conséquence des conditions de
vie et de travail faites aux travailleurs immigrés en France.
Une représentation dominante s'est imposée, dans le corps
médical en particulier, mais aussi dans l'opinion publique, qui
fait de la tuberculose la maladie des migrants, éveillant (ou
réveillant) les très anciennes images xénophobes
de la « peste » et de la contamination apportée
et répandue par l'étranger [2].
La maîtrise de la chimiothérapie antituberculeuse remonte
à près de quarante ans. Depuis lors, les instances scientifiques
et médicales internationales préconisent le traitement
ambulatoire ; les rapports d'experts de l'Organisation mondiale
de la santé (1964, 1974, 1982), affirment avec force depuis plus
de vingt ans l'inutilité de la cure en sanatorium. Or la
France est un des seuls pays au monde à avoir maintenu des sanatoriums
en exercice. Outre la « nécessité économique »
des professionnels qui y travaillent et font pression pour le maintien
de cet appareil sanatorial qui les fait vivre, des pratiques se perpétuent
parmi les médecins, en particulier les pneumologues, qui prescrivent
encore à certains malades des séjours de longue durée
en sanatorium.
Selon la Société française de pneumologie, ces
pratiques sont justifiées non pour des motifs d'ordre médical,
mais pour des « considérations d'ordre médico-social »
(1984). Parmi celles-ci figurent en particulier le fait d'être
immigré.
La répartition sociodémographique des cas de tuberculose
met en évidence d'importantes disparités selon la catégorie
socioprofessionnelle et la nationalité.
La sur-représentation des ouvriers non qualifiés, des
chômeurs et des non assurés sociaux parmi les malades montre
que la relation pauvreté/tuberculose demeure d'une criante actualité
dans la société française de la fin du XXème
siècle.
Les disparités selon les nationalités font surgir la
question centrale de la maladie « importée »
ou « produite ». Les données recueillies
dans l'étude au regard de l'ancienneté d'immigration (celle-ci
est en moyenne de huit ans) écarte la première hypothèse.
L'immigration la plus récente concerne une minorité de
malades (réfugies du sud-est asiatique, certains Maliens). Les
malades maliens arrivés entre 1962 et 1984, sont tous des hommes
jeunes (20-30 ans) et vivent pour 85 % d'entre eux en habitat collectif,
le plus souvent surpeuplé (Montreuil est la « deuxième
ville malienne » après Bamako). Les réfugiés
du sud-est asiatique, hébergés dans deux centres d'accueil
(Vaujours, Noisy-le-Sec) arrivent pour la plupart de camps de réfugiés
dans lesquels les conditions de vie étaient particulièrement
dures.
Les Algériens, qui représentent 23 % des malades
d'origine étrangère sont d'immigration beaucoup plus ancienne
et dispersée dans le temps : 21 % des malades algériens
sont nés en Île-de-France, 18 % sont arrivés
en France après 1971, 55 % entre 1945 et 1970 et 6 %
avant 1945.
En revanche, deux facteurs jouent un rôle déterminant
dans la survenue de la tuberculose. En premier lieu intervient la contamination
dont le principal foyer est le domicile du malade, surtout si
le taux d'occupation par pièce est élevé. C'est
le cas des malades résidant en habitat collectif. Mais il faut
aussi rappeler qu'au recensement de 1982, l'indice de peuplement en
Seine Saint-Denis fait état de 24 % de logements surpeuplés.
Le deuxième facteur important dans la genèse de la maladie
est l'état des défenses immunitaires de l'individu.
Contaminée par le bacille de Koch, une personne en bonne santé
pourra « virer sa cuti » sans avoir la tuberculose.
En revanche, celle-ci se déclarera si le malade atteint est en
état de moindre défense. C'est le cas de tous ceux qui,
pour des raisons diverses, ont de mauvaises conditions de santé.
Pour certains malades, la tuberculose apparaît au terme d'un
long processus d'atteintes à la santé ou d'épuisement
lié aux conditions de vie et de travail. C'est en particulier
le cas d'ouvriers algériens ou marocains, occupant en France
depuis de longues années des emplois non qualifiés, pénibles
et souvent insalubres. L'histoire de M. Irzit, cinquante et un
ans, d'origine marocaine, illustre ce processus. Il habite seul dans
une chambre vétuste, en immeuble.
« Je suis arrivé en France en 1957. J'ai travaillé
chez Renault, puis Chausson. Maintenant, je suis cariste chez X... (entreprise
sous-traitante de manutention). Ma femme est au Maroc, dans le Sud et
j'ai six enfants. Je vais tous les ans là-bas. Mais là-bas,
il n'y a pas de pluie, pas de culture, un peu d'élevage. Depuis
quatorze ans, il ne pleut pas...
Depuis plus de trois ans, j'étais malade. Au commencement,
j'avais mal au ventre et aux reins. Il m'arrivait d'être toujours
fatigué. J'ai un travail très dur comme cariste, très
dur... tout le monde m'appelle, je suis toujours debout, 8 par
jour. J'ai une sonnerie (bip, bip), ils m'appellent tout le temps. Avant,
quand j'avais mal au ventre, j'ai été opéré
de l'appendicite. Et puis une fois, le travail, c'est très très
dur. J'ai toujours, toujours mal, je fais un grand effort pour travailler.
Et puis cette fois là, j'ai fait un malaise. Après, j'étais
très fatigué. J'allais, obligé, au boulot. Et le
médecin, il n'a pas trouvé ma maladie.
Une fois, j'ai travaillé à l'usine jusqu'à
midi et je suis avec mon camarade à manger ma gamelle. Je ne
peux pas me lever, j'ai un malaise. Ils m'ont transporté à
l'hôpital Bichat. Je suis resté vingt-six jours comme ça
à l'hôpital... quatre piqûres par jour pendant vingt-six
jours. Puis je suis resté quinze jours chez moi. Je suis retourné
travailler mais j'ai toujours mal partout. Le médecin m'a envoyé
au spécialiste. J'ai mal à l'oreille droite. J'ai toujours
du bruit dans ma tête parce qu'à l'usine, il y a beaucoup
de bruit. Après, j'ai arrêté quinze jours le travail.
Je rentre le 7 août 1983. Le chef m'a dit : « Il
faut prendre des vacances ». Je suis parti, toujours malade.
Quand je rentre, le médecin (du travail) me dit :
« Il faut prendre des médicaments ; il ne faut
pas continuer cariste ». Il a dit à mon contremaître
de chercher une autre place. Je décharge des caisses dehors.
Alors là, j'ai très froid, il y a beaucoup de courant
d'air. Le 21 décembre, à l'usine, il y a une semaine
de chômage technique. Je me dis que peut-être cela va aller
mieux.
Mais peu à peu, ma maladie augmente jusqu'au 2 janvier.
Le docteur me donne des médicaments pendant quinze jours. J'ai
mal aux reins, je ne peux pas bouger. Je ne peux pas manger. Je retourne
au docteur, il m'envoie à la clinique, j'ai très mal là
(au niveau de l'estomac), je ne peux pas marcher, j'ai 39° de fièvre.
Ils me font un tubage à l'estomac. Rien. Après, je retourne
au docteur qui m'envoie passer une radio. Là, la dame me dit :
« Il faut aller tout de suite à l'hôpital Beaujon. »
Et voilà. Je suis resté quatorze jours à l'hôpital,
puis ils m'ont envoyé au sanatorium (huit mois). Le docteur
dit que maintenant les poumons ça va bien. Mais moi, je me
sens pas vraiment bien, et quand je monte l'escalier, je suis très
essoufflé ».
Cet itinéraire, au cours duquel se conjuguent pénibilité
du travail et genèse de la maladie, illustre les « mécanismes
sociaux de l'usure », dont parle F. Cribier [3].
D'autres histoires pourraient être rapportées qui illustrent
ces mêmes mécanismes. Dans le cas de ces travailleurs venus
d'ailleurs, de multiples facteurs socio-économiques (conditions
de vie et de travail) et socioculturels (isolement, séparation
familiale, difficultés face aux multiples démarches administratives
nécessaires à la vie en France, incompréhension
linguistique) peuvent contribuer à ce processus d'usure dont
la tuberculose devient le symptôme.
Le traitement antibiotique de la tuberculose permet de faire disparaître
les symptômes en quelques semaines. Cela signifie qu'après
cinq à six semaines de traitement, le malade ne se sent plus
malade, même s'il doit impérativement continuer à
prendre des médicaments pendant plusieurs mois pour assurer sa
guérison.
Dans l'accès au diagnostic, on observe des différences
selon la nationalité des malades, tant dans les premiers symptômes
ressentis que dans le choix de la première structure de soins
à laquelle ils se sont adressés. Les malades français
consultent dès l'apparition de symptômes précoces
non spécifiques tandis que les malades d'origine étrangère,
en particulier lorsqu'ils sont issus de groupes socio-économiques
très défavorisés, sont amenés à consulter
seulement en présence de symptômes aigus et souvent en
situation d'urgence. De ce fait, la suspicion du diagnostic de tuberculose
est posée plus rapidement quand il s'agit d'un malade étranger
amené à l'hôpital et présentant des symptômes
aigus que lorsqu'un médecin généraliste se trouve
en présence de symptômes peu différenciés
chez un malade français.
La décision de départ au sanatorium n'est pas un choix
des malades mais une décision sans appel du médecin et/ou
de l'assistante sociale, décision souvent appuyée, pour
convaincre le malade, sur l'argument de la contagion :
« Quand ils m'ont dit que c'est une maladie contagieuse,
j'ai pas voulu prendre de risque. Et puis le petit est toujours après
moi. C'est surtout à l'hôpital, ils m'ont isolé
et ils m'ont foutu la trouille. Le docteur, à T., il m'a
dit : « votre maladie n'est plus contagieuse trois jours
après le traitement ». J'ai demandé : « alors
qu'est ce que je fais là ? ». Il m'a dit :
« c'est par sécurité » (M. Y.,
34 ans, Algérien).
Certains expriment leur préférence pour un traitement
ambulatoire qui leur permet de rester chez eux :
« Moi, j'ai dit : « faut me laisser les
comprimés, je vais les prendre les comprimés ».
Mais ils n'ont pas confiance » (M. T., 30 ans,
Malien).
Le temps de séjour au sanatorium a toujours été
plus long que ce qui avait été annoncé au malade
avant son départ :
« L'assistante sociale a dit : « Tu restes
là-bas deux mois », et moi je suis resté cinq
mois. Je ne sais pas pourquoi » (M. T. 24 ans,
Malien).
« Vous allez à B. pour vous reposer pendant un
mois... N'importe comment, à tous ceux qui sont à B.,
ils disent ça les toubibs, et puis une fois qu'on y est, ils
vous gardent. Dans l'ensemble, les gens veulent sortir et ce qu'on dit
là bas, c'est que les médecins gardent les gens pour se
faire des ronds ». (M. W., 43 ans, Français
originaire de Martinique).
Le temps du sanatorium est un temps mort, un temps vide dans un environnement
perçu comme indifférent sinon hostile :
« On fait rien, on reste là-bas sans rien faire,
seulement prendre les médicaments et c'est tout, on reste là
c'est tout. Si j'ai envie de sortir, ils me donnent un petit papier.
Il n'y a pas d'occupation. Seulement il faut descendre le matin à
six heures chercher les comprimés. On les prend et après,
il n'y a rien à faire de la journée ». (M. T.,
24 ans, Malien).
« On joue au flipper, on va se promener, y'a rien à
faire. À partir de 10 heures (du soir) il faut que tout le monde
dorme. On va au café du village ». (M. S.,
31 ans, Malien).« Dans une seule chambre on est déjà
cinq ; y en a qui fument, qui boivent, qui font du bruit, et puis
moi j'aime pas les Noirs et les Arabes. Je suis pas raciste... mais
enfin les gens se mettent à fumer, à boire, y a même
un type qui se baladait en état d'ivresse dans les couloirs.
Certains ne prennent pas les médicaments et il y a pas de contrôle.
Je ne faisais rien de toute la journée, les livres, les petites
balades dans les couloirs, la télévision, c'est tout »
(M. T. 31 ans, Français originaire de La Réunion).
« Il n'y a aucune occupation, que la promenade, c'est
ce que je reproche, le manque d'ambiance. Les gens s'ennuient. C'est
devenu comme un hospice de vieillards. J'aurais aimé apprendre
quelque chose, un petit métier. Quand on est malade, c'est déjà
pas drôle, mais rien pour soutenir le moral. Et puis il y
a du bruit le soir, certains sont bourrés » (M. A.T.,
56 ans, Algérien).
D'une part cette situation conduit à d'importants surcoûts,
pour la sécurité sociale, la prise en charge financière
d'un malade envoyé en sanatorium étant 100 à
200 fois plus élevée que celle d'un malade traité
à domicile.
D'autre part, le fait de privilégier la logique institutionnelle
dispense, en quelque sorte, les médecins hospitaliers d'un véritable
travail d'adaptation de la prise en charge à la diversité
socio-économique et socioculturelle des malades. Infantilisés
par le séjour en sanatorium, les plus défavorisés
d'entre eux, en particulier ceux d'origine étrangère,
sont les plus susceptibles d'abandonner le traitement avant terme, faute
d'information.
Enfin, cette logique institutionnelle marginalise les malades non assurés
sociaux (nombreux dans notre étude) puisque l'accès à
des soins remboursables leur est interdit. Leur précarité
justifierait une prise en charge institutionnelle leur permettant d'être
nourris et logés quelque temps pour pouvoir guérir. Paradoxalement,
ce sont les seuls malades à qui, pour raison économique,
le sanatorium n'est pas prescrit.
Par ailleurs, certaines conséquences socio-économiques
sont directement liées d'une part aux formes de prise en charge,
d'autre part au statut du malade par rapport à l'emploi. Les
longs arrêts de travail se traduisent par d'importantes pertes
de salaire qui conduisent parfois le malade et sa famille à de
pénibles difficultés financières. Or ce sont principalement
les ouvriers non qualifiés qui partent le plus longtemps au sanatorium.
Pour certains malades en situation de précarité, l'arrêt
de travail a eu pour conséquence la perte d'emploi : ainsi
un malade malien âgé de 25 ans a perdu son emploi
pour la deuxième fois lors d'une rechute de tuberculose. Il connaissait
le traitement et voulait le prendre chez lui. Le médecin a refusé
et l'a envoyé au sanatorium. Il y a passé sept mois. Au
retour, l'entreprise de nettoyage a refusé de le reprendre.
En outre, des décisions d'inaptitude pour tuberculose, après
la guérison, de la part de médecins du travail, sont également
citées comme obstacle à une nouvelle embauche.
D'autres conséquences atteignent l'équilibre familial
(mères de famille dont les enfants ont dû être placés
en institution), ou se traduisent par une rupture d'autonomie (personnes
âgées qui, une fois hospitalisées, n'ont pu rentrer
chez elles).
Enfin, chez ceux qui ne se sont jamais sentis malades, dont la maladie
a été dépistée sur clichés radiologiques
sans qu'ils ne présentent aucun symptôme, le séjour
en sanatorium engendre un sentiment durable de très grande vulnérabilité
et la peur d'une rechute :
« Les médecins, ils insinuent qu'il vous reste
une espèce de fragilité, qu'on a quelque chose qui reste.
Je ne peux pas dire depuis quand je suis malade. Ca m'a beaucoup surprise
d'apprendre que j'avais cette maladie. Elle a été suspectée
au cours d'un dépistage radiologique annuel. Je ne me suis jamais
sentie malade, mais je me suis fait beaucoup de souci surtout que le
médecin s'est vraiment appesanti ». (Mme H.,
29 ans, Algérienne, secrétaire médicale).
De manière générale, les malades rencontrés
se plaignent de ne recevoir, de la part des médecins, que peu
ou pas d'information concrète sur les mécanismes de la
maladie, du traitement et de la guérison.
Une jeune femme algérienne, née en France, butte, sans
recours, sur l'incompréhensible :
« Au cours de ma grossesse, on m'a fait passer une radio
obligatoire. J'avais passé la radio au 7e mois de grossesse.
Ils ont attendu la visite du 8e mois pour me le dire. Ils m'ont dit
d'aller voir le pneumologue au dispensaire. Là, ils m'ont dit
que je devais immédiatement me faire hospitaliser au sanatorium [...].
Je ne comprenais rien. J'ai demandé des explications, je me sentais
très bien, pas du tout malade [4] ! Comment avais-je pu l'attraper cette maladie !
Comment ? Au contact d'autres gens ? Je n'ai jamais très
bien compris. Ils m'ont dit que les Africains, les Maghrébins,
les Asiatiques sont plus sensibles à la tuberculose que les Français...
c'est vrai ça ? Ils m'ont dit que ma tuberculose peut revenir
comme ça un jour.
« Quand je suis sortie du sanatorium, ils m'ont dit d'aller
voir le gynécologue pour me faire mettre un stérilet,
qu'il fallait surtout pas que je sois enceinte à nouveau avant
quatre ou cinq ans. Le médecin m'a dit que c'était la
grossesse qui m'avait provoqué la tuberculose. Cela nous inquiète
beaucoup mon mari et moi... » (Mme M., Algérienne,
25 ans).
La plupart des malades savent seulement qu'ils ont une « maladie
des poumons ». Français et Algériens disent
avoir entendu parler de la tuberculose, à l'école ou par
les médias. Les Marocains y voient « la silicose +
une tâche au poumon » (cette représentation est
probablement liée pour nombre d'entre eux à leur expérience
de mineur). Les Maliens et les Sénégalais, pour la plupart,
« se sentent malades » sans savoir quelle est la
maladie dont ils souffrent.
En dépit de la diversité des malades atteints de tuberculose,
la représentation qu'en ont les médecins apparaît
focalisée autour de trois portraits-type :
- le tuberculeux « Nord-Africain » ou « Africain
noir »,
- l'éthylique ou le fou sans domicile fixe,
- les vieux.
Ces trois groupes de malades ont, aux yeux des médecins, des
caractéristiques communes dont certaines formes de déviance
et leur incapacité à prendre correctement leur traitement
de façon autonome. Ces portraits-type, représentations
dominantes des malades tuberculeux, justifient la prescription du séjour
en sanatorium.
Ainsi, aux yeux des médecins, la tuberculose apparaît
toujours comme le signe d'une certaine marginalité sociale, ce
qui rend nécessaire, selon eux, au nom des « considérations
médico-sociales », un séjour en sanatorium qui
relève alors d'un contrôle social quasi coercitif surtout
lorsqu'il tend à devenir une mesure destinée préférentiellement
sinon exclusivement aux malades d'origine étrangère.
La situation décrite n'est pas, nous le savons, limitée
à la Seine Saint-Denis.
Il existe une contradiction entre cette inertie institutionnelle très
forte que symbolise la cure sanatoriale et l'exclusion des soins pour
de nombreux malades non assurés sociaux. Les conditions de prise
en charge de 103 d'entre eux, ont été étudiées
à partir de l'expérience d'un dispensaire de soins gratuits
de Médecins du Monde après diagnostic par des structures
publiques de santé. La plupart des malades ont reçu par
Médecins du Monde quinze jours de traitement gratuit puis
ont été perdus de vue. La gratuité effective d'un
traitement ambulatoire antituberculeux dans les structures publiques
de santé serait une réponse. Mais ces patients, dont l'histoire
personnelle et « médicale » est souvent complexe
et difficile à comprendre, justifieraient d'une attention plus
grande et plus individualisée que la moyenne des malades.
C'est l'inverse qui se produit en raison d'une méconnaissance,
par les médecins, de cette histoire. Plus que les malades français,
les malades d'origine étrangère sont pris dans des filières
institutionnelles qui empêchent pour eux toute possibilité
de choix.
Les dernières recommandations du Haut-Conseil à l'Intégration,
concernant l'exigence du titre de séjour pour bénéficier
des soins, ne vont-elles pas faire obstacle encore davantage à
une prise en charge efficiente des malades étrangers, non seulement
lorsqu'ils sont atteints de tuberculose, mais de toute autre maladie ?
- Chauvenet A., Médecine au choix, médecin
de classe, PUF, 1978.
- Cottereau A. « La tuberculose : maladie urbaine
ou maladie de l'usure au travail ? Critique d'une épidémiologie
officielle : le cas de Paris », Sociologie du
Travail, avril-juin 1978, 192-225.
- « La tuberculose en 1987 et évolution des années
antérieures », Rapport du Service Central de
la Tuberculose en Seine Saint-Denis, Bondy, 1988.
- Lepetit C., Thébaud-Mony A., Grosset J.,
« La tuberculose en Seine-Saint-Denis. les cas mis au
traitement en 1984 », Rev. Mal. Resp. ,
1988, 5, 129-136.
- Lepetit C., Thébaud-Mony A. « Tuberculose
respiratoire en Seine Saint-Denis : résultats du traitement »,
Rev. Mal. Resp. , 6, 451-456.
- Société de Pneumologie de langue française.
(1984). « Recommandations pour le traitement de la tuberculose
en France », Rev. Mal. Resp. , 1984,
1, 59-62.
- Thébaud-Mony A., Lepetit C. « Les filières
de soins des nouveaux cas de tuberculose respiratoire en Seine-Saint
Denis en 1984-1986 », Revue d'épidémiologie
et de Santé Publique, 37, 327-335.
Notes
[1] Ce texte s'appuie sur
les résultats d'une recherche faite par l'équipe ISIS
en 1984-88, concernant la prise en charge des 578 malades tuberculeux
mis au traitement au cours de l'année 1984 dans le département
de la Seine Saint-Denis. Nous avons étudié les filières
de soins et le vécu du traitement par les malades, et interviewé
des médecins.
[2] Thébaud-Mony A.,
« Besoins de santé et politique de santé ».
Thèse pour le doctorat d'État, Paris V Sorbonne,
1980. Cf. sur ce point le paragraphe concernant l'action sanitaire internationale
avant la première guerre mondiale, p. 21-24.
[3] Cribier F., « Itinéraires
professionnels et usure au travail : une génération
de salariés parisiens », Le Mouvement social, juillet-septembre
1983, 124.
[4] En France, le dépistage
radiologique peut conduire à l'identification d'anomalies à
la radio sans aucun symptôme. En l'absence de vérification
bactériologique de la présence du bacille tuberculeux,
il est très difficile de savoir s'ils s'agit véritablement
ou non d'une tuberculose active.

Dernière mise à jour :
31-07-2001 11:18.
Cette page : https://www.gisti.org/
doc/plein-droit/14/tuberculose.html
|



 En ligne
En ligne



 En ligne
En ligne

