|
|
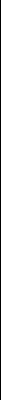
|
Plein Droit n° 18-19, octobre
1992
« Droit d'asile :
suite et... fin ? »
Jean-Pierre Alaux
Si l'on en croit les Etats occidentaux, les demandeurs
d'asile sont aujourd'hui presque tous illégitimes. Ils ne pourraient
donc les accueillir en dépit de leur tradition de « terres
d'asile ». Seulement, leurs critères d'admission évoluent
avec les circonstances comme s'il s'agissait sans cesse de mettre au
point les obstacles capables d'interdire l'exercice effectif du droit
d'asile.
Voir aussi l'encadré
« Reconnaissance du statut
de réfugié »
« Le peuple français donne l'asile aux étrangers
bannis de leur patrie pour la cause de la liberté et il le refuse
aux tyrans » (Constitution française de 1793, art. 120.).
Qu'un pays européen — l'Allemagne — s'apprête
à modifier bientôt sa Constitution pour se protéger
des demandeurs d'asile ; que la Cour suprême des Etats-Unis
légitime, par deux fois en 1992, le rapatriement aveugle et automatique
de milliers de boat-people haïtiens montrent, s'il en était
besoin, la gravité des menaces qui pèsent sur le dispositif
international de protection des opprimés. Les 17 millions
de réfugiés au moins (dont moins de 5 % en Europe
et moins de 140 000 en France, selon une étude récente)
et les 25 millions de personnes déplacées dans le
monde font décidément peur aux « terres d'asile »,
ou réputées telles, de l'Occident.
Le temps est bel et bien fini où l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) et la Commission
de recours, créés le 25 juillet 1952, accordaient
le statut à la quasi-totalité de ceux qui y postulaient.
Ils étaient alors, il est vrai, pour l'essentiel, des transfuges
du monde européen communiste et, de ce fait, des prises de guerre
froide. Ils étaient également peu nombreux : à
peine 1 200 en 1972 contre 61 500 au cours de l'année
record de 1989. Mais la peur qu'ils suscitent ne date pas d'hier :
quand, en 1981, ils sont moins de 20 000 à demander l'asile,
on accorde le statut à 77,7 % d'entre eux ; quatre
ans plus tard, en 1985, il suffit que leur nombre augmente un peu — moins
de 29 000 — pour que le taux de reconnaissance s'effondre
à 43,3 %. En 1990, au lendemain du franchissement du pic
des 61 000 demandes, il sera de 15,5 %. Mais il remontera,
comme par enchantement, en 1991 (19,7 %), aussitôt que les
requérants seront moins nombreux (46 800) (voir le tableau
« Reconnaissance du statut de
réfugié »).
Cette miraculeuse et constante proportionnalité inversée
entre le volume de la demande et celui des accords en dit long sur les
critères qui président à l'attribution du statut
de réfugié. De toute évidence, il y a belle lurette
que l'Ofpra et la Commission des recours font un peu office de douaniers
et veillent, à leur manière, au moins autant à
limiter l'ampleur des flux migratoires qu'à protéger les
victimes de l'oppression.
Le ver s'est d'ailleurs mis à ronger le fruit du droit d'asile
dès l'adoption, en 1951, de la Convention de Genève. La
ségrégation initiale qu'elle imposait alors au bénéfice
exclusif de « toute personne qui, par suite d'événements
survenus avant le 1er janvier 1951, et craignant avec raison d'être
persécutée.... » durera jusqu'en 1967. En
négligeant les oppressions du sud de la planète — coloniales
ou néocoloniales mais postérieures —, cette
clause restrictive les considère implicitement comme normales,
voire naturelles. La France, qui hésite trois années avant
de ratifier la Convention et ne lèvera les réserves originelles
qu'à la fin des années 60, se préserve déjà
au mieux des tragédies qui se multiplient, au vu et au su de
tous, dans son ancien empire.
C'est donc dans le plus pur respect de la tradition occidentale du
droit d'asile que l'Ofpra peut affirmer aujourd'hui qu'« il
faut considérer que l'exercice de droits politiques ou syndicaux,
dans de jeunes démocraties, peut engendrer certains désagréments
et conduire parfois les autorités de ces pays à limiter
ces droits en procédant, par exemple, à des arrestations
ou contrôles d'identité, dont la nature ne peut s'analyser
comme des faits de persécutions dans la mesure où ils
restent « conformes » aux principes internationaux
(garde-à-vue, définition des délits et des peines,
contrôle juridictionnel) » [1]. On pouvait, à l'expérience, supposer les droits
humains parents pauvres du pur état de droit et synonymes de
libertés minimales pour les déshérités.
Grâce à la philosophie politique naturaliste de l'Ofpra,
on est sûr qu'il s'agit d'une norme. L'Office d'ailleurs s'explique,
en ce domaine, sans métaphore : la seule crainte fondée
est, selon lui, celle du requérant dont « le séjour (...)
dans son pays d'origine est devenu intolérable (...) ou
le deviendrait », s'il y retournait [2].
La norme s'adapte donc négativement, dès l'origine, à
l'augmentation des demandes dans un souci constant d'exclusion du tiers-monde.
Si sa détermination reposait sur l'éthique ou sur le droit,
nul ne se risquerait à de telles violations intellectuelles des
droits de l'homme. Mais, comme toutes les études du marché
de l'asile montrent que les utilisateurs viennent et viendront massivement
de zones non européennes, caractérisées par un
respect aléatoire des libertés, la jurisprudence se fait
complaisante à l'égard des formes d'oppression les plus
courantes. C'est un calcul où le qualitatif, présumé
déterminant, sert tout au plus d'habillage au quantitatif.
En ce sens, les politiques du droit d'asile, depuis la deuxième
guerre mondiale, ont toujours fondamentalement obéi aux mêmes
impératifs que les choix en matière d'immigration. Ce
phénomène, discret quand le volume et l'origine des demandeurs
d'asile s'adaptent quantitativement et qualitativement à la tolérance
et aux besoins migratoires, saute aux yeux dès lors qu'il y a
distorsion. Dans ces périodes, aujourd'hui par exemple, les mêmes
obstacles qu'on oppose aux flux migratoires s'érigent aussi sur
la route des réfugiés potentiels. La « responsabilisation »
européenne et américaine des transporteurs, la multiplication
des obligations de visas, l'intensification — voire leur légalisation —
des zones de non-droit aux frontières s'efforcent d'empêcher,
de façon indifférenciée, les uns et les autres
de quitter leurs pays ou d'entrer dans les nôtres. En compliquant
l'exil et la demande d'asile, désormais expéditivement
préjugée, sans procédure ni possibilité
de recours véritables dans les ports et les aéroports,
ces obstacles ont encore la fonction secondaire d'ignorer, avant même
son expression auprès des organismes spécialisés,
une requête qui ne sera donc pas considérée comme
telle. Quelle meilleure banalisation du droit d'asile dans le melting
pot de la migration ?
Dans le contexte de cette spécieuse tradition du droit d'asile,
il n'est de liberté que nominale pour l'Ofpra et la Commission
des recours. A l'heure où même des Constitutions européennes
plient sous l'impérieuse nécessité de dissuader
les candidats au statut et où une Cour suprême occidentale
légitime leur refoulement automatique, quoi de plus normal qu'il
revienne, en France, au ministre délégué aux Affaires
étrangères, M. Georges Kiejman, d'annoncer, le 11 juin
1992, à la veille de la visite à Paris du président
chilien, M. Aylwin, que l'Ofpra va bientôt exclure du bénéfice
de sa protection les Chiliens et les Bulgares ? Normal encore que
l'Office coure aux frontières portuaires et aéroportuaires,
en 1991, quand le gouvernement les lui montre du doigt, pour y préjuger
en accéléré les requérants. Normal toujours
que, la même année, cet Office, par définition protecteur,
n'ait que du mutisme à opposer à une mesure administrative
d'interdiction du travail à l'encontre des demandeurs d'asile.
Et que dire de l'annonce, en juin dernier, par Mme Renouard,
présidente du Conseil d'administration de l'Ofpra, mais
aussi directeur des Français à l'étranger au...
ministère des Affaires étrangères, selon laquelle,
pour les exilés de l'ex-Yougoslavie, « la solution
retenue (par qui ?) passe par l'attribution d'un titre de
séjour temporaire qui permet aux personnes de trouver refuge
sans devoir entamer une procédure d'intégration de longue
haleine » [3], y compris sans doute celle de la demande d'asile ?
Plus que jamais dans son histoire, l'Ofpra est aux ordres et sert,
le petit doigt sur la couture de la politique migratoire, des critères
qui n'ont qu'une lointaine parenté avec les droits de l'homme.
Dans ce contexte de violations répétitives du droit d'asile
de part et d'autre de l'Atlantique (voir l'article « Violation des lois
internationales »),
il est pour le moins étrange que le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) ne semble rien avoir de
plus urgent que de mener à bien ce qu'il appelle une « évaluation
des ressources humaines » au sein de ses délégations
d'Europe occidentale en vue de leur réaffectation partielle en
Europe de l'Est. Ce projet impliquerait-il, de sa part, une approbation
implicite des nouvelles pratiques en œuvre dans les vieilles démocraties ?
A moins qu'il ne s'agisse d'exporter clef-en-main à l'Est le
« modèle » made in Occident..
Notes
[1] L'Office français
de protection des réfugiés et apatrides, chapitre 3,
p. 23.
[2] Ibid., p. 8.
C'est nous qui soulignons.
[3] Documentation Réfugiés,
n° 191, 30 juillet — 8 août 1992,
cité de la Libre Belgique, 12 juin 1992.

Dernière mise à jour :
10-02-2001 17:36.
Cette page : https://www.gisti.org/
doc/plein-droit/18-19/tradition.html
|



 En ligne
En ligne



 En ligne
En ligne

