|
|
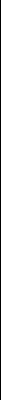
|
Plein Droit n° 14, juillet 1991
« Quel droit à
la santé pour les immigrés ? »
Hélène Bretin
1ère
partie | 2ème partie |
3ème partie
D'autres femmes étrangères que nous avons
rencontrées n'ont pas eu recours à cette méthode.
Leur expérience, leur relation avec l'institution médicale
en matière de contraception et d'accouchement n'en est pas moins
marquée par ce qu'a généré leur statut d'étrangère.
« Le jour de l'accouchement, ça a été
terrible à cause d'une sage-femme. Au début, c'était
pas prévu la césarienne. C'était prévu que
j'accouche normalement (...). Elle a demandé au médecin
de me faire une césarienne. Je savais pas ce que ça veut
dire la césarienne. Le médecin n'était pas d'accord...
Quand elle m'a demandé pour la césarienne, moi je croyais
que c'était des points, c'est tout.
« Le lendemain, quand je me suis réveillée,
j'ai vu la césarienne, j'ai vu des trucs, des sérums et
tout, j'ai dit : c'est ça la césarienne ! Après
j'ai vu mon ventre, c'était terrible ! ! ! Quand
j'en ai parlé avec mon mari, c'était trop tard. Elle est
sortie pour voir mon mari et lui a dit : votre femme a demandé
la césarienne. Moi j'ai pas demandé la césarienne.
C'est vrai, elle m'a demandé, et moi, à cause des douleurs,
j'avais dit oui. Elle m'a dit : on va vous soulager Madame avec
une césarienne. Moi j'ai dit oui comme ça, je savais pas
ce que c'était une césarienne.
« Je ne sais pas, après je me suis demandé
peut-être elle est raciste. Elle n'aime pas les Arabes. Il y a
des racistes partout, c'est la vérité. Il y a des Arabes
qui n'aiment pas les Français, il y a des Français qui
n'aiment pas les Arabes. Ça, c'est la vérité, ça
se passe partout. Ce que j'ai dans ma tête, c'est ça. Parce
qu'il n'y avait pas de raisons. Pourquoi la césarienne ?
J'ai passé mes radios de bassin à cause de ça et
j'avais demandé à la sage-femme, j'avais posé des
questions pour mon accouchement, s'il y avait des problèmes.
Elle m'avait dit : votre échographie est bien, vos radios
sont bien, normalement.
« ... Je ne suis pas
raciste,
mais quand ils voient une Arabe,
ils abusent un peu... »
« Le médecin m'avait donné un masque à
oxygène pour respirer un petit peu. Dès que le médecin
part, elle m'enlève le masque. Dès que le médecin
revient, je lui demande et il me le redonne, dès qu'il repart,
elle l'enlève. Vraiment je suis tombée avec une femme...
j'oublierai jamais ce jour là, tellement j'ai eu peur. Je suis
sûre et certaine qu'elle est raciste. » (Saïma)
« Quand je suis arrivée, la bonne femme a regardé
mon dossier, elle a dit : vous êtes suivie ? J'ai dit :
oui, ici. Elle a dit : c'est une césarienne. Mon mari a
dit : qu'est ce que vous voulez que je vous dise ?...
« J'accoucherai plus à l'hôpital. La
clinique c'est mieux parce que quand le gynécologue dit une chose,
c'est une chose. À l'hôpital, même celle qui balaye
donne son avis je crois ! Il y avait au moins cinq dames :
« une césarienne oui, oui » ; l'autre :
« non, non, on peut la faire accoucher » ;
l'autre : « non, c'est une césarienne » ;
devant moi. Je les voyais aller et venir dans le couloir, je tremblais :
ça y est j'ai quelque chose ! Comment ça se fait,
tous ces médecins, ils étaient au moins dix ou onze. Ils
m'ont pas expliqué. Moi sur la table, allongée, je perdais
du sang. C'était un dimanche. Il n'y avait pas beaucoup de personnel.
Surtout avec les stagiaires.
« Moi, je vous dis, je suis pas raciste, mais quand ils
voient une Arabe, ils abusent un petit peu. Oh oui, même beaucoup !
Parce que j'ai vu que si c'était une Française, ils vont
pas faire ça hein. Ils appellent tous les internes, ils viennent
te toucher, ils ont pas le droit de venir te toucher. Ca fait mal quand
on fait rentrer les doigts. Toi tu l'enlèves, l'autre remet son
doigt, elle n'a pas le droit. Si la malade dit non, ils ne touchent
pas. Moi, comme c'était un accouchement par le siège,
pour apprendre, une enlève son doigt, l'autre le replace :
« regarde comment il est » ; l'autre :
« je sens un genre de zizi ». Moi, j'ai rien dit.
Je ne suis pas méchante, j'ai dit : peut-être ils
apprennent, ils s'y connaissent pas. Au moins dix, hommes et femmes
ont mis leurs doigts » (Zahoua).
Au sein de la structure de soins et face au modèle dominant
de régulation des naissances, le choix fait par la femme peut
perdre toute sa valeur et sa cohérence. Marqué comme marginal,
il donne lieu à un jugement et à une culpabilisation.
Zahoua, avec ses sept enfants, peut en parler y compris dans ses relations
avec l'équipe du centre de PMI-planification :
« Quand elles voyaient une femme qui avait beaucoup d'enfants,
elles aimaient pas qu'elle soit encore enceinte.
— Vous l'avez senti ça ?
— Oui. Faites ça... faites ça... Maintenant,
il y a quelqu'un qui me donne un coup de main ? Personne. Quelqu'un
qui m'aide pour les enfants ? personne. Si je veux faire l'avortement,
c'est moi qui sais. Si je veux pas avoir d'enfant, c'est moi qui sais.
Si je suis enceinte et que je viens vous voir, même si vous êtes
gynécologue et que vous me dites : oh ! vous faites
ça ? Je sais ce que je fais !
« Toutes les femmes vous diront la même chose...
Quand je suis rentrée d'Algérie, j'étais gênée
d'aller les voir. Ils aiment pas. Je sais pas s'ils aiment pas pour
la santé de la mère, je ne comprends pas moi. Je suis
en très bonne santé, j'ai rien du tout. Quand F.
m'a vue, elle a dit : c'est votre premier ? tellement je suis
bien. J'ai pas le ventre sorti. C'est comme si j'avais pas eu d'enfants.
À l'hôpital, ils disent qu'il faut faire des exercices...
moi je ne les fais pas. J'y arrive pas avec mes gosses.
« C'est pas le gynécologue qui vous dit ça,
c'est l'entourage. C'est pas le médecin qui dit : pourquoi ?
C'est trop ! C'est l'équipe. Sinon elles sont très
gentilles. »
C'est ce même jugement que veut éviter Noura à
l'hôpital. Il conditionne sa propre réponse face à
une attitude qui pose a priori la contraception comme allant de soi,
fait nettement sentir l'absence d'alternative :
« Ils m'ont pas demandé mon avis ni rien. Ils m'ont
demandé si je voulais la pilule ou le stérilet, j'ai dit
la pilule.
— Et si vous disiez : ni l'un ni l'autre ?
— Non ! j'ai pas dit comme ça. On sait
jamais ! Parce qu'ils disent que les Arabes, ils veulent les bébés
tout de suite, ils veulent comme ça... j'ai pas dit, hein !!! »
Les femmes étrangères immigrées font souvent partie,
en France, des catégories sociales les plus défavorisées.
Aux lois du marché qui, dans leurs pays d'origine, ont conduit
au départ hommes et femmes, répondent celles qui dans
nos sociétés — dit Claude Julien —,
renforcent un mécanisme contribuant largement à notre
prospérité tout en maintenant la précarité
et la marginalisation des populations immigrées [5].
Au sein de notre propre société, dans le contexte de
crise économique, la récession modifie le regard sur l'immigration
(Gérard Noiriel) : « La stabilisation accroît
la visibilité des immigrés, déplace le regard vers
les “improductifs”, surtout les enfants ; la problématique
de la famille, donc de la généalogie, donc de l'“assimilation”,
aiguisée par les fantasmes xénophobes, est en terrain
sûr. » [6]
Ce même processus n'est-il pas à l'œuvre également
dans le regard sur la fécondité des femmes étrangères
en France, au travers des questions qui resurgissent régulièrement
et font parfois la une de certains quotidiens : serons-nous encore
français demain ? Au travers des inquiétudes sur
les difficultés d'intégration des enfants de la deuxième
génération, l'échec scolaire, la délinquance...
En France, la fécondité des femmes d'origine étrangère
demeure supérieure à celle des femmes d'origine française
(3,18 enfants par femme contre 1,84 en 1982). Néanmoins,
elle baisse progressivement et se rapproche de la moyenne française.
En 1985, le nombre moyen d'enfant par femme étrangère
était de 3,05. Ici, pourtant, on a tendance à « stigmatiser »
les pratiques culturelles et reproductrices des femmes qui ont une fécondité
plus élevée que la nôtre.
Chaque émigration, parce qu'elle a son histoire, suppose des
réalités différentes : celle qui, dans le
cas des Algériennes, distingue les femmes de la seconde génération,
des femmes immigrées de la première génération ;
celle aussi qui distingue par exemple les femmes algériennes
des femmes d'Afrique sub-saharienne, d'immigration plus récente
dans notre pays.
Les femmes étrangères vivent les contradictions inhérentes
à la confrontation des systèmes culturels, notamment dans
leur demande de contraception et la manière dont elles la vivent.
Elles peuvent être issues de sociétés où
l'enfant entre dans une logique différente, en termes de survie
et d'assurance vieillesse ; sociétés aussi dans lesquelles
les niveaux d'éducation des femmes sont parfois encore très
peu élevés. La faiblesse du niveau d'instruction à
laquelle s'ajoutent les difficultés de communication, contribuent
à accentuer le caractère technique de la demande de contraception
sans que puisse se résoudre l'angoisse provoquée justement
par les contradictions vécues. Celles-ci sont d'autant plus difficiles
à exprimer dans la relation avec les praticiens que cette relation
est doublement inégalitaire : sur le plan du savoir et sur
celui du rapport entre culture dominante et cultures dominées.
Ces femmes sont alors confrontées au regard profondément
ethnocentriste d'une société qui reconnaît les pratiques
différentes comme formes de déviances. « Déviances »
qui, en même temps qu'elles nourrissent l'idéologie de
la discrimination, suscitent le contrôle et l'intervention pour
une assimilation à la logique culturelle dominante.
Face aux résultats ou plutôt à l'absence de résultats
clairs et nets quant à la toxicité à long terme
du produit, l'attitude la plus raisonnable voudrait que l'on renonçât
à l'utiliser tant qu'il demeure impossible de conclure, ce qui
peut être considéré comme une restriction du choix
des femmes. Mais, coupée des conditions concrètes de la
pratique, la notion de choix est privée de sens. Les conditions
de choix et d'information dont peuvent bénéficier les
femmes de faible niveau d'instruction et qui ne parlent ni n'écrivent
le français ne sont-elles pas restreintes a priori ?
Rappelons que, dans le débat international sur les effets secondaires
et la toxicité du produit, les défenseurs de cette technique
se sont très souvent appuyés sur la logique de l'impasse,
de l'urgence et du derniers recours pour présenter des situations
où elle apparaît comme un « moindre mal ».
On peut considérer qu'une injection est préférable
à un « Xième » avortement ou un « Xième »
enfant, s'il met en danger la santé (la vie ?) de sa mère
ou si les conditions de vie de la famille sont précaires. Cette
logique qui contribue à reléguer au second plan la question
de l'innocuité soulève un problème éthique.
En Suède, le contraceptif injectable, qui est interdit dans les
programmes de coopération, est autorisé dans le pays dans
des conditions de suivi médical intensif, de façon ponctuelle
et avec une information complète des femmes.
Contraceptif de l'impasse, du non choix, de l'urgence, l'injectable
interroge également les praticiens sur la nature de leurs interventions
y compris dans des conditions de pratique insatisfaisantes, avec une
réponse qu'eux-mêmes considèrent souvent comme insatisfaisante.
Le recours à la technique, lorsqu'il exclut toute alternative
dans la réponse faite à la femme, peut devenir une fin
en soi. En outre, il peut aussi abolir le recul nécessaire aux
médecins, qui leur permet de savoir à quels besoins ils
sont amenés à répondre et si leur réponse
y est adaptée.
Au delà des questions strictement liées au produit lui-même,
l'injectable n'est qu'un révélateur, un outil pris dans
des logiques ambivalentes entre émancipation, libération
et aliénation. Ailleurs, ce sera la stérilisation féminine
ou masculine, la pose de stérilets, d'implants sous cutanés,
la « taxe » aux ménages défavorisés
qui dépassent le quota d'enfants autorisé, l'avortement
forcé... ou plus sournoisement la restriction absolue des choix
et le diktat d'une technique choisie dans la logique d'efficacité
et d'expertise technocratique des programmes de planification conçus
sans les personnes auxquelles ils s'adressent.
La suppression de cette technique n'a d'intérêt que si
la recherche des alternatives donne lieu à un travail sur les
conditions dans lesquelles s'envisage souvent sa prescription.
Les structures de soins gratuites que sont les consultations de gynécologie
en centre de PMI et de planification sont absolument indispensables
pour faciliter l'accès au système de soins et surtout
le suivi médical de femmes peu favorisées. Cela peut contribuer
à limiter la pratique d'urgence.
Ce suivi ne peut s'envisager qu'avec des conditions de travail et de
communication optimales. Dans le cadre des consultations de planification,
le recours aux services d'interprètes interculturelles constitue
une aide certaine mais insuffisante. Il serait très important
que les équipes de santé des centres comptent parmi leurs
membres, des femmes de même origine que les consultantes. Cela
contribuerait à faciliter la communication, à mieux connaître
les femmes, à favoriser aussi les contacts et les discussions
avec les maris. De la même manière, on pourrait envisager
des consultations d'ethnomédecine, (telles qu'elles se pratiquent
dans un centre médico-social pour les réfugiés
et demandeurs d'asile) qui permettent de comprendre le(s) sens de la
demande (somatique ou mentale) des personnes qui se présentent.
Des équipes de soins de centres de PMI nous l'ont dit :
derrière les silences, il y a parfois des situations dramatiques,
des détresses immenses. Elles ne peuvent être décryptées
a priori, surtout pour un regard occidental non familiarisé avec
la culture d'origine des femmes et les conséquences de la migration
sur leur identité, leur santé [7].
En PMI, des équipes de soins prennent des initiatives afin d'améliorer
et d'adapter leur pratique. En sollicitant la venue d'une intervenante
turque, africaine, etc. parlant du pays d'où viennent les femmes,
de son histoire, du système culturel, des traditions, des modèles
sociaux et familiaux, elles sont amenées à mieux saisir
et analyser les attitudes et pratiques des consultantes, à porter
sur celles-ci un regard différent : autant d'éléments
qui, s'ils sont généralisés, contribuent à
de meilleures conditions de communication et d'information adaptées
aux besoins des femmes.
Il n'appartient pas aux seuls praticiens et au système de soins
de modifier les rapports de domination qui structurent les inégalités
que nous avons mises à jour. Mais celles-ci ne peuvent être
réduites avec une offre dominée par une rationalité
technique, décalée et limitée face aux problèmes
qui sont posés. Cela nous amène à un niveau beaucoup
plus profond de changements radicaux qui questionnent l'accès
au savoir, la modification des rapports de domination.
S'il est un message à retenir du travail accompli avec les femmes
rencontrées, c'est que leur santé n'est pas toute contenue
dans leur utérus ! Pourtant, toutes partagent les conséquences
d'une approche médicalisée qui tend à restreindre
leur santé aux conditions objectives de la reproduction. Leur
santé passe bien sûr par la qualité du suivi des
grossesses, du déroulement des accouchements, du suivi contraceptif.
Il faut replacer ces conditions dans la perspective qui leur donne leur
force et leur sens. Pour les femmes, la santé dépend « non
pas de la multiplication des actes médicaux autour de leur sexualité,
mais de leur propre capacité autonome à infléchir
les choix qui décident de leurs conditions de vie et donc de
santé. » dit A. Thébaud-Mony [8].
Pour Meredeth Turshen [9], la définition
et l'analyse de la santé des femmes est indissociable du concept
de « pouvoir des femmes ». C'est-à-dire,
écrit-elle, « non seulement leur participation politique
à la vie publique mais aussi l'expression de leur statut dans
la législation. Non seulement leur participation économique
à la force productive, mais aussi le paiement pour leur travail.
Non seulement les idéologies concernant leurs rôles, mais
aussi l'importance et le contenu de l'éducation à laquelle
elles ont accès. L'expression des intérêts des femmes
dans chacun des domaines que sont la législation, la politique
familiale, l'éducation et l'idéologie, l'emploi, la représentation
politique, donne la mesure de leur participation sociale, économique,
politique, dans la société ». Elle donne
aussi la mesure de leur participation à la définition
de la santé et de la maladie, de l'adaptation des soins de santé
à leurs besoins, de leur accès aux soins de santé.
La santé des femmes étrangères met directement
en question leur condition de migrantes, les conditions d'intégration
de leur groupe social d'origine au sein de la société
d'accueil, leur insertion individuelle dans le tissu social.
L'étude d'une réalité qu'est la prescription de
la contraception débouche sur la question des inégalités
sociales. Une société qui fonctionne sur un modèle
fondamentalement inégalitaire, rend la lutte pour leur réduction
d'autant plus difficile à mener. Elle passe par la reconnaissance
et le respect de tout individu, de l'altérité ; par
la disparition du regard ethnocentriste ; par l'amélioration
globale des conditions socio-économiques des populations défavorisées
de notre société, qu'elles soient françaises ou
étrangères. À travers la prescription de la contraception
nous l'avons vu, ces enjeux sont en cause. Ils questionnent de manière
cruciale tous les acteurs qui possèdent un quelconque pouvoir
au sein du système social, sur les choix politiques implicites
dans lesquels s'inscrivent leurs actes et leurs répercussions
sur l'évolution de notre société. Il y a plus à
espérer de la solidarité que de l'aide. Il y a plus à
gagner (attendre) de la gratuité et de consultations pluri-culturelles,
que d'une gestion médicalisée de la différence.
Notes
[5] C. Julien, Démographie,
Les privilèges et le vertige, Le Monde diplomatique, Mai
1990.
[6] G. Noiriel, Le
creuset Français, Histoire de l'immigration XIXe-XXe siècles,
Seuil, Paris 1988.
[7] M. Cosio, Th. Locoh,
« Un long combat contre l'ignorance et l'abandon des femmes
à leur sort », Le Monde Diplomatique, mai 1990.
[8] A. Thébaud-Mony,
Besoins de santé et politique de santé, Thèse
pour le doctorat d'état, Paris V, 1980
[9] M. Turshen, The
politics of Public Health, Rutgers University Press, New Jersey
1989.

Dernière mise à jour :
12-08-2001 23:29.
Cette page : https://www.gisti.org/
doc/plein-droit/14/contraception-3.html
|



 En ligne
En ligne



 En ligne
En ligne

