Article extrait du Plein droit n° 29-30, novembre 1995
« Cinquante ans de législation sur les étrangers »
Le code de la nationalité : entre statu quo et innovation
L’attribution à la naissance
Alors que le code civil retenait la filiation comme mode quasi-exclusif d’attribution de la nationalité française d’origine, la loi de 1851 a réintroduit le jus soli dans le droit de la nationalité en déclarant français l’enfant né en France d’un étranger qui lui-même y est né – règle qui ne sera plus jamais remise en cause par la suite. Le nouveau code conserve la combinaison du droit du sol et de la filiation.
En ce qui concerne la filiation, jusqu’à la loi de 1927, seul le père transmettait toujours sa nationalité à l’enfant sans possibilité pour celui-ci de la répudier, même s’il était né à l’étranger. La loi de 1927, en même temps qu’elle décidait que la femme française épousant un étranger resterait française, décida que leurs enfants seraient français s’ils étaient nés en France, étrangers s’ils n’y étaient pas nés.
Le code de 1945 conserve cette dissymétrie entre la transmission de la nationalité française par le père et par la mère, mais en l’atténuant. Ainsi, seul le père continue à transmettre sans réserve la nationalité française à ses enfants légitimes (l’enfant naturel a la nationalité française si le parent qui l’a reconnu le premier, ou le père en cas de reconnaissance simultanée, a la nationalité française) ; quant aux enfants nés d’une mère française, ils sont eux aussi français quel que soit leur lieu de naissance (« C’est un large et assez aventureux apport à notre nationalité », commente René Savatier à l’époque), mais ils conservent une faculté de répudiation – refusée aux enfants nés d’un père français – s’ils ne sont pas nés en France.
La même dissymétrie subsiste dans le cadre de l’application du « double jus soli » : est français l’enfant légitime né en France d’un père qui lui-même y est né (ou, dans le cas d’un enfant naturel, dont le parent qui l’a reconnu le premier est lui-même né en France) ; lorsque c’est la mère qui est née en France (ou le parent qui a reconnu l’enfant en second dans le cas des enfants naturels), l’enfant est également français de naissance, mais conserve une faculté de répudiation, ce qui était le cas sous l’empire de la loi de 1927.
L’acquisition
Par mariage
Sous l’empire du code civil, la femme prenait automatiquement la nationalité de son mari. La femme française épousant un étranger perdait donc la nationalité française, tandis que la femme étrangère épousant un Français devenait française. Pour des raisons démographiques, la loi de 1927 avait décidé, à l’inverse, que la femme française qui épousait un étranger restait française, sauf demande expresse de sa part d’acquérir la nationalité de son mari. En revanche, la femme étrangère épousant un Français n’acquérait pas, en principe, la nationalité française, sauf si elle optait pour la nationalité française ou perdait, en vertu de sa loi nationale, sa nationalité d’origine.
Afin d’étendre le champ de la nationalité française, le nouveau code de la nationalité efface le principe de la loi de 1927 selon lequel l’étrangère épousant un Français restait étrangère : elle devient de plein droit française, sauf expression, par la femme elle-même, de la volonté contraire, et sauf opposition du gouvernement.
Est en revanche maintenue la règle selon laquelle les femmes françaises épousant un étranger conservent leur nationalité française, sauf répudiation.
En raison de la naissance en France
Déjà sous l’empire du code civil, l’enfant né en France d’un étranger pouvait réclamer à sa majorité la qualité de Français à condition de déclarer son intention de fixer son domicile en France.
La loi du 26 juin 1889, guidée là encore par la volonté d’étendre le champ de la nationalité française, déclara français, sauf faculté de renonciation, tout individu né en France d’un étranger et qui, à l’époque de sa majorité, était domicilié en France.
L’ambiguïté de cette formulation, qui pouvait laisser entendre que la nationalité française était, dans ce cas, attribuée rétroactivement à la naissance et non pas acquise à la majorité, fut levée par la loi du 10 août 1927 : l’étranger né en France devenait français à sa majorité s’il était, à ce moment-là, domicilié en France. Le décret-loi du 12 novembre 1938 ajouta à la condition de domicile la possession, par l’intéressé, d’une autorisation de séjour de plus d’un an.
Par ailleurs, sous l’empire de la loi de 1927, l’étranger né et domicilié en France – et qui avait donc vocation à devenir français à sa majorité – pouvait, pendant sa minorité, opter pour la nationalité française sans condition de résidence antérieure.
L’ordonnance du 19 octobre 1945 introduit ici trois modifications importantes et restrictives par rapport à la législation antérieure :
- elle subordonne l’acquisition de la nationalité française à la majorité à une durée de résidence : jusqu’en 1945, on considérait que le seul fait d’avoir en France son domicile à sa majorité valait acquisition de la nationalité française pour l’étranger né en France ; désormais, celle-ci n’est acquise que si l’intéressé réside régulièrement en France depuis cinq ans lorsqu’il atteint sa majorité ;
- elle subordonne la faculté d’opter pendant la minorité pour la nationalité française, à cette même condition de résidence habituelle en France de cinq ans ;
- enfin, elle élargit les possibilités pour le gouvernement de faire opposition : l’opposition est désormais possible non seulement dans le cas de l’acquisition par déclaration, comme c’était déjà le cas, mais aussi dans le cas de l’acquisition de plein droit à la majorité ; et outre l’indignité, le gouvernement peut aussi invoquer désormais le défaut d’assimilation ou une grave infirmité physique ou mentale de l’intéressé.
Par naturalisation
Si la question des naturalisations a toujours été de celles qui soulevaient les controverses politiques et idéologiques les plus vives – notamment depuis l’adoption de la loi de 1927 fortement critiquée pour avoir fabriqué des « Français de papier » –, si, à la Libération encore, ces controverses se sont poursuivies (voir « Naturalisations : le bon grain plutôt que l’ivraie »), elles ne se reflètent pas vraiment dans le nouveau code. En effet, les conditions de la naturalisation ne sont pas substantiellement changées.
La principale modification concerne la durée du stage, qui passe de trois ans à cinq ans. Pour le reste, l’ordonnance apporte des précisions sur les conditions de recevabilité de la demande qui ne figuraient pas dans les textes antérieurs : l’intéressé doit être de bonnes vie et mœurs, et ne pas avoir subi de condamnation pénale à plus d’un an de prison ou même à une peine moindre s’il s’agit d’un délit que la loi française sanctionne par la relégation (vagabondage, mendicité, délits contre l’honnêteté et les mœurs) ; il doit être suffisamment assimilé ; il doit être sain d’esprit et assez sain de corps pour ne pas être une charge pour la communauté française.
Mais cette modification est plus formelle que substantielle dans la mesure où ces éléments guidaient déjà en fait l’administration dans son appréciation de l’opportunité d’une naturalisation.
Les incapacités
Si les discriminations que Vichy avait établies entre les Français nés de père français et les autres ont disparu à la Libération, l’ordonnance de 1945 laisse subsister les incapacités à l’égard des naturalisés que la loi de 1927 avait instaurées et que le décret-loi de 1938 avait encore étendues. Ainsi, les naturalisés ne peuvent remplir de mandats électifs pendant dix ans et ne peuvent être électeurs pendant cinq ans ; toutefois, le nouveau code abaisse à cinq ans le délai pour accéder à la fonction publique et au barreau (voir infra).
La déchéance
Dans ce domaine politiquement et idéologiquement sensible, l’ordonnance du 19 octobre 1945 laisse subsister l’essentiel des dispositions résultant des décrets-lois du 12 novembre 1938 et du 9 septembre 1939, et même de la loi du 16 juillet 1940 validée sur ce point par l’ordonnance du 24 mai 1944.
C’est la loi de 1927 qui, en même temps qu’elle élargissait l’accès à la nationalité française, avait prévu la faculté de déchoir de la nationalité française les Français ayant acquis, sur leur demande, cette nationalité. La déchéance était encourue pour avoir accompli des actes contraires à la sûreté intérieure et extérieure de l’État français, ou pour s’être livré au profit d’un pays étranger à des actes incompatibles avec la qualité de citoyen français et contraires aux intérêts de la France, ou enfin pour s’être soustrait aux obligations résultant des lois de recrutement. Mais elle était prononcée par jugement, l’action étant intentée par le ministère public à la demande du ministre de la justice.
Le décret-loi du 12 novembre 1938 ajouta à la procédure de déchéance la possibilité de déclarer par décret qu’un Français a perdu la nationalité française si, possédant la nationalité d’un pays étranger, il se comporte en fait comme le national de ce pays. Il modifiait, par ailleurs, la procédure de déchéance, qui était désormais prononcée par décret sur avis conforme du Conseil d’État. Il incluait parmi les motifs de la déchéance les actes contraires à l’ordre public ou au fonctionnement des institutions, et y ajoutait une quatrième hypothèse : le fait d’avoir commis un crime ou un délit ayant entraîné une condamnation à une peine égale ou supérieure à un an de prison.
Le décret-loi du 9 septembre 1939 avait encore élargi – pour une période temporaire, mais dont il ne fixait pas le terme – les possibilités de prononcer la déchéance de la nationalité française : la déchéance n’était plus seulement réservée aux étrangers ayant acquis la nationalité française sur leur demande, c’est-à-dire le plus souvent par naturalisation ; elle pouvait aussi être prononcée à l’égard des étrangers ayant acquis la nationalité française par l’effet de la loi, y compris, par conséquent, ceux qui, nés en France, l’avaient acquise à leur majorité. La déchéance pouvait de surcroît être prononcée pour des faits commis avant l’entrée en vigueur des nouveaux textes ; et, alors que sous l’empire de la législation précédente elle ne pouvait intervenir que dans le délai de dix ans suivant la naturalisation ou l’accomplissement des faits reprochés, elle pouvait désormais être prononcée à toute époque, sans limitation dans le temps.
Sous Vichy, la loi du 16 juillet 1940 relative à la procédure de déchéance de la qualité de Français avait entériné et pérennisée ces dispositions : elle sera validée à la Libération par l’ordonnance du 24 mai 1944...
L’ordonnance du 19 octobre 1945 revient, sur ce point, légèrement en arrière. La déchéance reste prononcée par décret. Elle s’applique à tous les modes d’acquisition de la nationalité française, et non pas seulement à la naturalisation. L’énumération des faits susceptibles de justifier la déchéance reste sensiblement la même ; toutefois, en ce qui concerne les infractions de droit commun, seuls les crimes ayant entraîné une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement – et non plus toute condamnation à une peine égale ou supérieure à un an – sont susceptibles d’entraîner la déchéance. Est conservée également la faculté d’étendre la déchéance à la femme et aux enfants mineurs, sous réserve toutefois qu’ils ne soient pas français d’origine et qu’ils aient une autre nationalité.
En revanche, l’ordonnance limite à nouveau dans le temps la faculté de prononcer la déchéance de la nationalité française : elle ne peut intervenir que pour des faits commis dans les dix années suivant l’acquisition de la nationalité française et ne peut être prononcée après l’expiration d’un délai de dix ans suivant l’accomplissement de ces faits.
Naturalisés : les incapacités
|

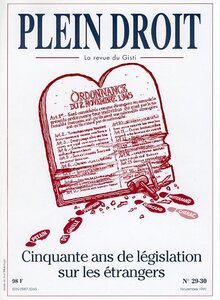
![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)










Partager cette page ?