Article extrait du Plein droit n° 46, septembre 2000
« D’autres frontières »
Des droits universels... sous condition
Anne du Quellennec
Enseignante-chercheuse à l’Université Parix X Nanterre
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 proclame des droits universels. Inhérents à la nature humaine, ils appartiennent à l’humanité toute entière. De même, la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’ONU en 1948, proclame des droits civils et politiques et des droits économiques et sociaux valables pour l’ensemble de l’humanité. Pourtant, on constate bien souvent que les individus ne peuvent effectivement exercer leurs droits que lorsqu’ils sont ancrés dans un territoire.
A titre d’exemples, l’accès aux logements sociaux, aux services publics locaux, aux prestations sociales, ou tout simplement la possibilité de se marier sont conditionnés par une domiciliation sur une commune.
L’appartenance à une collectivité géographiquement identifiée est en pratique un préalable nécessaire à l’obtention de droits pourtant énoncés comme universels. Cela se vérifie de façon particulièrement nette pour les droits sociaux. On fait parfois valoir que la territorialisation des droits – le mécanisme de rattachement à un territoire donné pour accéder aux droits – permet d’accroître la protection des plus démunis et donc l’égalité de tous : les collectivités locales seraient des relais de l’Etat-providence sur le terrain, resserrant les mailles du filet « providentiel ». En sens inverse, on constate que la territorialisation des droits, en multipliant les cloisonnements juridiques, multiplie les obstacles pour accéder aux droits. Qu’en est-il en réalité ?
L’exigence d’appartenance à une collectivité se traduit juridiquement par des notions variables : le domicile, la domiciliation ou encore la résidence. Aucune branche du droit ne fait l’économie de ces notions, mais aucune n’utilise les mêmes critères pour déterminer l’ancrage territorial pertinent pour accéder à tel ou tel droit. Domicile civil, domicile fiscal, domicile électoral, domicile de nationalité : aucun ne se définit de la même façon.
Le domicile, au sens civil, est le lieu du principal établissement de l’individu ; il a pour objet de le rattacher à un point du territoire pour qu’il y exerce ses droits civils (mariage, filiation, autorité parentale, successions…). Selon le code civil, toute personne est censée avoir un domicile et un seul. Or, ces impératifs se conjuguent mal avec les conditions de la vie moderne caractérisée par une plus grande mobilité, qu’elle soit volontaire ou bien subie en raison d’une situation de pauvreté ou de grande précarité. C’est pourquoi l’évolution législative tend de plus en plus à localiser juridiquement les individus par le biais de la « résidence », à condition que celle-ci acquière une certaine durée. Le lieu de rattachement de chacun est alors déterminé par ses liens de famille, ses intérêts, ses habitudes : c’est le lieu où cette personne vit ordinairement.
Cette évolution, particulièrement visible en droit de la famille, est guidée par une volonté de souplesse et de respect de la vérité : la réalité de la résidence s’oppose au caractère de plus en plus fictif du domicile.
Or, plus le critère de rattachement est interprété de façon souple, plus le nombre d’individus qui peuvent faire valoir des droits est élevé : si le critère est celui de la résidence, il suffit que la personne « vive ordinairement » sur le territoire d’une collectivité pour pouvoir accéder aux droits et bénéficier des services qu’elle procure. Cette tendance est donc révélatrice d’un plus grand souci de protection des personnes.
En dehors du domicile civil, trois domaines illustrent bien la diversité des éléments pris en compte pour déterminer ce que la loi appelle selon les cas le « domicile » ou la « domiciliation », cet ancrage territorial indispensable à l’accès aux droits : il s’agit du droit électoral, du droit fiscal et du droit de la nationalité.
Une « norme » fluctuante et imprécise
Selon le code électoral, la détermination du domicile conditionne l’inscription sur une liste électorale, modalité indispensable à l’exercice du droit de vote. Cette inscription résulte de trois conditions alternatives : avoir un domicile réel dans la commune, y habiter depuis six mois au moins, ou encore figurer pour la cinquième fois au rôle d’une des contributions directes communales(1). Il est de jurisprudence constante que l’existence d’attaches personnelles dans la commune n’est pas pertinente et ne suffit pas à justifier l’inscription sur la liste électorale de cette commune.
Si le droit électoral rejette avec véhémence l’idée selon laquelle les liens personnels et affectifs peuvent être pris en compte pour déterminer un domicile, on pourrait penser que, dans les autres champs d’application de cette notion, les mêmes conséquences en découlent. Tel n’est pas le cas : la domiciliation est décidément une « norme » fluctuante et imprécise.
Ainsi, la détermination du domicile fiscal fait appel aux notions de foyer et de lieu de séjour. Par foyer, on entend le lieu où le contribuable ou sa famille habite normalement, c’est-à-dire le lieu de sa résidence habituelle, à condition que celle-ci ait un caractère permanent. La détermination du domicile fiscal fait donc intervenir des notions telles que les attaches personnelles, les intérêts familiaux, la résidence de fait.
Le droit de la nationalité, lui, fait aussi référence, pour déterminer le « domicile de nationalité », à « la résidence effective [correspondant] au centre des attaches familiales et des occupations professionnelles ». Mais, ce faisant, il restreint la notion de domicile au lieu de l’élargir, puisqu’il exige que le domicile comporte des caractéristiques supplémentaires par rapport à la notion classique du code civil (voir article p. 21).
Le législateur tente, dans chacun de ses domaines d’intervention, de définir le domicile ou la domiciliation, l’ancrage territorial, en fonction des objectifs poursuivis par la loi. Si cette pratique offre l’avantage d’une adaptation du droit à la réalité, elle engendre cependant des éléments de complexité. Ceci est particulièrement vrai au niveau local, lorsque le « domicile », la « domiciliation » ou encore la « résidence » sur le territoire de la collectivité conditionnent l’exercice des droits et l’accès à certains services municipaux, départementaux ou régionaux.
Risques d’exclusion
Le caractère multiforme, la plasticité de notions qui conditionnent l’accès à des droits, n’est pas sans danger. En effet, les autorités locales peuvent jouer sur ce flou et s’en servir pour déterminer des règles strictes d’appartenance territoriale qui aboutiront à refuser l’accès aux droits à de nombreux individus.
Pour bien comprendre comment ce risque peut se concrétiser, il faut se rappeler que les procédures administratives d’exercice des droits civils et sociaux fonctionnent suivant un principe de sectorisation géographique qui aboutit à exclure de ces procédures tous ceux qui, privés d’adresse – ou dont l’adresse ne présente pas de stabilité suffisante, comme les hôtels meublés par exemple –, ne peuvent se réclamer d’une appartenance territoriale. Et lorsque ce n’est pas l’accès aux droits et services qui est subordonné à une exigence de la domiciliation, ce sont les modalités de cet accès qui sont plus ou moins avantageuses (tarifs préférentiels notamment) selon qu’on appartient ou non à la collectivité.
Compte tenu des conséquences de la sectorisation, il est important de savoir quels droits peuvent être ou sont en pratique dépendants d’un ancrage territorial.
Il s’agit avant tout des droits mis en œuvre dans le cadre des compétences décentralisées des collectivités locales, dépendant de leur libre initiative : c’est notamment le cas des prestations facultatives que les collectivités locales peuvent mettre en place au titre de l’action sociale.
Mais il s’agit aussi de l’aide sociale légale, c’est-à-dire de l’ensemble des prestations dont les collectivités locales doivent obligatoirement assurer la charge. Ces prestations sont destinées à faire face à des besoins auxquels les personnes concernées sont dans l’impossibilité de pourvoir.
Les choix contestables des communes
Traditionnellement, les collectivités décentralisées ont peu de marge de choix en matière d’aide sociale légale, puisque c’est la loi elle-même qui en fixe les règles, et leur action se développe surtout dans le domaine des aides facultatives. Mais, qu’il soit obligatoire ou facultatif, l’octroi de ces aides est soumis à une condition de domiciliation, à l’exigence d’un ancrage territorial, notamment au sein de la commune qui gère l’aide sociale par l’intermédiaire du centre communal d’action sociale (CCAS).
Aux termes de l’article 124 du code de la famille et de l’aide sociale, toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions d’attribution (parmi lesquelles figure, pour certaines prestations, la condition de régularité du séjour), des différentes formes de l’aide sociale. A priori, ces aides, obligatoirement inscrites au budget des collectivités locales, ne semblent soumises qu’à une simple condition de résidence sur le territoire national. La commune joue cependant en pratique un rôle important dans la distribution de ces prestations, car c’est elle qui instruit les demandes.
Bien qu’aucune de ces aides ne dépende des communes – puisque c’est le département qui est compétent en matière d’aide sociale –, elles sont traditionnellement chargées, moyennant une indemnisation, de monter les dossiers. L’exigence d’un ancrage territorial pour accéder aux droits joue à ce moment précis : seules les personnes domiciliées dans la commune vont se voir ouvrir des droits tels que le droit à l’aide médicale à domicile et hospitalière, l’aide aux handicapés, l’aide aux personnes âgées alors que, théoriquement, seule la résidence sur le territoire français est exigée.
Ce choix est contestable tant sur le terrain de l’opportunité que de la légalité. D’une part, en matière d’aide sociale légale, la commune a peu de marge de manœuvre, « l’établissement du dossier constituant une obligation, indépendamment de l’appréciation du bien-fondé de la demande »(2). Et si, en matière d’action sociale facultative, l’accès à certains droits peut en entraîner d’autres – tel l’accès au logement social, par exemple, qui ancre, de fait, une personne au sein de la commune –, l’accès à l’aide sociale légale ne produit aucun de ces effets et ne « coûte » rien à la collectivité, si ce n’est le poids des travailleurs sociaux à sa charge.
D’autre part, cette pratique n’est pas conforme à la législation sociale actuelle. Une circulaire du ministère de la santé(3) rappelle qu’il est « illégal de refuser l’ouverture de tels dossiers aux personnes sans domicile fixe, aux gens du voyage et aux étrangers », en d’autres termes, aux personnes ne pouvant pas forcément apporter la preuve d’un rattachement fixe et unique à la collectivité. On ne saurait être plus clair.
S’agissant au contraire des aides facultatives, leur bénéfice est soumis à des conditions fixées discrétionnairement par les pouvoirs publics locaux. Le fait que ces aides soient accordées aux seuls habitants de la commune est quasiment leur raison d’être.
Décentralisation sociale
En effet, c’est en vue de privilégier ses propres habitants que la commune octroie, sans y être contrainte, des aides financières et matérielles : aides à la rentrée scolaire, distribution de denrées aux familles en difficulté, aides financières exceptionnelles sur demande, sorties pendant les vacances pour les jeunes en difficulté…
Depuis 1982, la priorité a été accordée à la décentralisation sociale, c’est-à-dire au transfert de compétences en matière sociale aux communes, départements et régions, considéré comme de nature à favoriser l’exercice réel de la démocratie(4).
Il s’agissait d’un revirement complet par rapport à une évolution multiséculaire qui avait poussé à concentrer toujours davantage, entre les mains de l’État, les décisions en la matière. L’idée sous-jacente était que la société civile recélait des capacités propres pour résister à la crise et serait plus apte que l’État à le faire. Mais, comme le soulignait Jacques Rondin dès 1985(5), cette pétition de principe pour « l’autogestion civile » est plutôt révélatrice d’une impuissance, d’une démission de l’État que d’une véritable volonté politique. Les conséquences ? Des conflits de compétence négatifs dont les populations marginalisées paient le prix : dépourvue d’un ancrage territorial suffisant, une partie de la population, alors qu’elle réside sur le territoire de la collectivité – mais le plus souvent aux frontières de celle-ci –, pourra constituer une « clientèle » qu’aucune collectivité n’accepte de reconnaître comme sienne.
En effet, l’exigence d’un ancrage territorial pour accéder aux droits, qu’il s’agisse de la notion rigoureuse du domicile ou bien de la notion plus souple du lien avec la commune consacrée par le conseil d’État(6), revient toujours à élaborer un critère territorial permettant de déroger au principe d’égalité.
Or, s’il est légitime de conférer aux collectivités locales, au nom du principe constitutionnel de leur libre administration, une marge de manœuvre quant à la détermination de leurs ressortissants – qui auront accès aux droits et services qu’elles créent –, cette autonomie ne doit pas pour autant aboutir à un isolement, un cloisonnement des communes les unes par rapport aux autres, au risque d’exclure les individus extra-territorialisés (voir l’article qui suit).
Ainsi, l’exigence d’un ancrage territorial comme condition d’accès aux droits, par le biais juridique de la domiciliation, dessine une sorte de catégorie intuitive – l’« ayant droit local », celui qui appartient pleinement et entièrement à la collectivité – et détermine en négatif les individus « étrangers » à la collectivité.
Est-ce à dire qu’il faut pouvoir être labellisé comme tel pour bénéficier du principe d’égalité des usagers devant le service public ? Et alors que l’État est censé être le garant de l’égalité sur tout le territoire, la territorialisation des droits ne soulève-t-elle pas de considérables contradictions au regard du principe d’égalité des citoyens et de l’universalisme républicain ?
C’est l’idée même de solidarité que la domiciliation met en jeu : elle autorise à se « délier » de l’autre, à se désolidariser de celui qui est différent en raison de son mode de vie, ou bien parce que pauvre, étranger, jeune… Ce refus du mélange réussit à faire émerger l’idée selon laquelle ces « populations autres » n’ont pas de légitimité à accéder au système de protection, aux ressources fiscales de la collectivité « financées » par ceux qui en ont la faculté.
Ne gérer que « ses » pauvres
Une fois que « l’Autre » est figuré et catalogué comme étranger, il est facile, évident de « lui dénier tout bénéfice de la solidarité »(7). Lorsque l’on parle d’accueil et d’hospitalité, on ne parle pas seulement, en effet, des étrangers mais aussi du groupe d’accueillants : la capacité de chacun à accueillir « renvoie à sa propre image et en est le révélateur »(8).
Les réticences à mener une véritable politique d’hospitalité, les attitudes protectionnistes au sein d’une collectivité infra-nationale renvoient aux peurs que l’on retrouve à l’échelon étatique, peurs liées à l’idée d’un « trop plein ». Elles sont révélatrices d’un souci de protection contre « un effet de contamination qu’engendrerait la cohabitation avec les pauvres »(9). Le terme de contamination a d’ailleurs été utilisé au début de l’année 2000 par un élu parisien du 8e arrondissement, commentant les risques que ferait courir la décision du rectorat revenant à sectoriser certains enfants des 18e et 10e dans son arrondissement.
La décentralisation – qui portait en elle l’espoir de voir dans les collectivités décentralisées autant de relais de l’État permettant la prise en charge des plus démunis par des institutions sur le terrain – semble avoir été perçue par les acteurs publics comme le moyen, au contraire, d’exclure une population non désirable et de « gérer ses pauvres » certes, mais rien que les siens.
Or, si l’appartenance à la collectivité territoriale – la « solidarité territoriale » – devenait plus discriminante que l’appartenance nationale, la logique du « localisme », à savoir la valorisation de la proximité, du pareil et de l’identitaire s’opposerait alors de front à l’universalité.
Notes
(1) Article L 11 du code électoral.
(2) Article 137 du code de la famille et de l’action sociale.
(3) Circulaire n° 95-08 du 21 mars 1995 relative à l’accès aux soins des personnes les plus démunies.
(4) J. Baguenard, La décentralisation, Que sais-je, PUF 1996.
(5) J. Rondin, Le sacre des notables, Fayard 1985.
(6) C.E. Sect. 13 mai 1994, Commune de Dreux, Rec. p.233.
(7) J. Barou, Formes urbaines et rupture sociale, Hommes et Migrations n° 1147, octobre 1991.
(8) D. Schnapper, La relation à l’Autre, Commentaire n° 80, 1997.
(9) J. Donzelot, Fragmentation urbaine et zones défavorisées : le risque de désolidarisation, Hommes et Migrations n° 1147, octobre 1991.

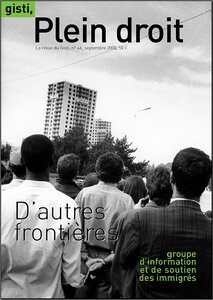
![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)










Partager cette page ?