Article extrait du Plein droit n° 46, septembre 2000
« D’autres frontières »
Le « domicile de nationalité »
Laurence Roques et Didier Liger
Avocats
Contrairement aux Anglo-saxons pour qui le domicile, assimilé au foyer d’origine et permanent, attribué à la naissance, permet à celui qui est né dans l’un des États du Commonwealth de demeurer jusqu’à sa mort rattaché à la patrie qui l’a vu naître, quel que soit son lieu de résidence, le droit français n’attache en principe aucun droit de nationalité à la simple naissance en France et la notion de domicile d’origine y est inconnue.
En droit français, le domicile est une condition d’acquisition, parfois de conservation, mais non d’attribution de la nationalité française à titre originaire. (La naissance sur le territoire français peut toutefois, dans certains cas conférer la nationalité française, par exemple lorsque l’un des parents est lui-même né en France). Le domicile conditionne notamment l’acquisition par naturalisation ainsi que l’énoncent les articles 21-16 et 21-17 du code civil aux termes desquels : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » et « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande ».
Les termes de « résidence » et de « résidence habituelle » utilisés ici laissent supposer que le domicile, dans le droit de la nationalité, ne correspond pas à la définition théorique contenue dans l’article 102 du code civil (« Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement »), mais à « une notion réaliste inspirée par des faits et calquée sur eux »* de nature à démontrer l’intégration de l’étranger en France et à « éliminer toute discussion sur le droit de l’étranger à un domicile »*. C’est pourquoi la Cour de cassation a énoncé, dans un arrêt de principe, en 1955, que « l’étranger doit non seulement avoir sa résidence habituelle en France, mais elle doit présenter un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles »*. Ainsi était née la définition du domicile de nationalité, qui devait être ensuite reprise tant par le conseil d’État* que dans les circulaires ministérielles.
Une jurisprudence réaliste
Depuis lors, la jurisprudence des deux ordres juridictionnels, et plus particulièrement celle de l’ordre administratif, n’a cessé d’affiner les contours de cette notion de domicile de nationalité, en utilisant – paradoxalement – la méthode casuistique et réaliste propre au droit anglo-saxon, qui consiste à refuser de prendre une position de principe abstraite pour s’attacher plutôt aux circonstances de l’espèce.
Pour avoir son domicile de nationalité en France, l’étranger doit résider régulièrement, aussi bien lors de sa demande que lors de l’acquisition de la nationalité française. Cette condition, d’abord imposée par la jurisprudence*, est désormais prévue par l’article 21-27 du code civil depuis la loi du 24 août 1993.
Bien que les textes ne précisent pas la durée ni la nature du titre attestant la régularité du séjour, l’étranger titulaire seulement d’un visa ou d’une autorisation provisoire de séjour est considéré comme n’ayant pas de résidence stable en France*. De même, ses années de résidence en France ne seront comptabilisées qu’à compter de la date de délivrance de son titre de séjour, sauf à démontrer qu’il avait auparavant entrepris des démarches tendant à la régularisation de sa situation administrative*.
Occupations professionnelles et attaches familiales
Mais la notion de « domicile de nationalité » inclut d’autres éléments : les occupations professionnelles et les attaches familiales.
L’étranger doit disposer de revenus stables et suffisants provenant de l’exercice d’une profession ou éventuellement de la famille, mais dont l’origine doit, dans tous les cas, être localisée en France*. Ces conditions ont notamment joué contre les étrangers séjournant en France en qualité d’étudiants : pendant longtemps, ils se sont vu opposer une fin de non recevoir de la part des autorités administratives, au motif tout à la fois qu’ils devaient repartir à terme dans leur pays, que leurs ressources étaient précaires et qu’elles provenaient du pays d’origine.
Là encore, fidèles à l’examen des circonstances de l’espèce plutôt qu’aux positions de principe, les juridictions administratives, précédées par la Cour de cassation, ont jugé que l’étudiant pouvait, dans certains cas, avoir en France son domicile de nationalité, dès lors qu’il démontrait son intention d’y demeurer, notamment par l’exercice d’une activité salariée* non précaire, à plein temps*, l’achat d’un appartement*, ou l’existence d’attaches familiales en France*.
Les juridictions administratives ont également assoupli leur jurisprudence pour tenir compte de la conjoncture économique et de la précarisation de l’emploi. Elles ont par exemple censuré le refus opposé à un étranger résidant de longue date en France avec toute sa famille qui, après avoir occupé divers emplois, avait fait l’objet d’un licenciement économique et recherchait depuis lors en vain un nouvel emploi*, ou celui notifié à une étudiante ayant une formation dans un domaine d’activité qui offrait de réelles possibilités d’emploi*.
Pour attester de ce qu’il a en France son domicile de nationalité, on demande aussi à l’étranger que toutes ses attaches familiales soient établies en France*. A moins que les liens familiaux ne soient rompus : ainsi, pendant longtemps, seul l’étranger divorcé*, séparé de fait* ou encore dont les enfants étaient majeurs, pouvait acquérir la nationalité française si son conjoint ou ses enfants étaient demeurés ou retournés dans le pays d’origine*.
Depuis quelques années, dans ce domaine encore, la jurisprudence s’est assouplie, pour tenir compte des modifications de la structure familiale ainsi que des difficultés de l’entrée et du séjour des étrangers en France. Ainsi ont été jugées recevables la demande d’un étranger ayant laissé au pays des enfants naturels issus d’une précédente union et aux besoins desquels il subvenait*, celle d’une étrangère dont les enfants ou l’époux étaient à l’étranger temporairement pour des raisons de santé* ou professionnelles*, ou encore celle d’une étrangère dont l’un des trois enfants mineurs était resté au pays pour poursuivre sa scolarité*.
Enfin, très récemment, la cour administrative d’appel de Nantes s’est penchée sur l’incidence de la situation administrative du conjoint de l’étranger sollicitant l’acquisition de la nationalité française, eu égard au refus systématiquement opposé à celui ou celle dont le conjoint était soit en séjour irrégulier en France, soit resté dans son pays d’origine.
Cette question de principe a donné lieu à trois arrêts rendus le même jour, aux termes desquels la cour a jugé que le fait que le conjoint soit demeuré à l’étranger – ou considéré comme tel car en situation irrégulière, les autorités françaises ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour – ne pouvait constituer un motif d’irrecevabilité de la demande de naturalisation*. Suivant les conclusions de sa commissaire du gouvernement, la cour a réaffirmé ainsi que la volonté et la réalité de l’intégration dans la société française, telle qu’elle est possible au jour où l’étranger sollicite la nationalité française, constituent l’élément déterminant de l’existence du domicile de nationalité.
Résidence habituelle, résidence continue
Cette idée d’intégration préside également à la définition de la condition de résidence des jeunes nés en France qui, aux termes des dispositions de l’article 21-7 du code civil, acquièrent désormais automatiquement la nationalité française à l’âge de dix-huit ans, s’ils résident en France et s’ils ont eu leur résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans à compter de l’âge de onze ans.
En effet, le législateur, en distinguant la notion de résidence « habituelle » de celle de résidence « continue », a souhaité permettre à ceux des jeunes issus de l’immigration concernés par ce texte, qui étaient souvent amenés à repartir quelques années dans le pays de leurs parents, à la demande de ces derniers, de devenir néanmoins français sans avoir à pâtir de leur double appartenance.
Cependant, à la différence de la résidence du « domicile de nationalité » qui doit témoigner de la volonté d’intégration du candidat, la résidence visée aux dispositions de l’article 21-7 du code civil est plutôt conçue comme devant faciliter l’intégration du requérant. C’est pourquoi cette résidence peut-être éventuellement irrégulière et se prouver par tous moyens*.
L’armée comme résidence
Enfin, la condition de résidence disparaît à l’égard du jeune né en France qui est incorporé en qualité d’engagé dans l’armée française (article 21-9 al. 2 du code civil).
L’assimilation de l’incorporation dans l’armée française à la résidence en France n’est pas nouvelle. Prévue par les dispositions de l’ancien article 78 du code de la nationalité, reprise par les nouvelles dispositions de l’article 21-26-3°1 du code civil(1), elle a, pendant de nombreuses années, permis aux militaires originaires d’anciens territoires français d’outre-mer d’Afrique noire qui servaient sous les drapeaux français lors de l’accession de leur pays à l’indépendance, de conserver la nationalité française.
En principe, pour pouvoir conserver la nationalité française au moment de l’accession à l’indépendance des territoires d’outre-mer, les personnes originaires de ces territoires devaient être domiciliées en France, et non dans un de ces territoires*. Le domicile visé par le législateur s’entendait du domicile de nationalité tel que défini plus haut. Mais la Cour de cassation, dans un arrêt de principe Bokassa rendu le 29 mai 1985, avait admis que l’assimilation à la résidence en France de la présence hors de France dans une formation régulière de l’armée française, prévue pour les cas d’acquisition de la nationalité française, valait a fortiori pour les cas de conservation de la nationalité française : elle s’appliquait donc aux militaires originaires des anciennes colonies françaises qui se trouvaient sous les drapeaux français lors de l’accession de leur pays à l’indépendance*.
Là encore, le souci d’intégration était légitimement pris en compte. Comment, en effet, ne pas voir dans le fait de choisir de se battre pour un pays, la volonté ultime d’intégration et d’appartenance à celui-ci ? L’application de cette assimilation de résidence à ces militaires revenait en somme à reconnaître « l’impôt du sang » versé pour la France.
Des anciens combattants abandonnés à leur sort
Pourtant, sans aucune explication décente, le législateur de 1993 a décidé de mettre fin à cette jurisprudence, en adoptant l’article 43 de la loi du 22 juillet 1993, issu d’un amendement de M. Mazeaud, voté en catimini : l’assimilation à la résidence en France de la présence hors de France en temps de paix comme en temps de guerre dans une formation régulière de l’armée française « n’est applicable qu’aux cas d’acquisition ou de réintégration dans la nationalité française », et non plus aux cas de conservation de celle-ci.
Faisant fi des principes les plus élémentaires de la non rétroactivité des lois et de l’autorité de la chose jugée, la Cour de cassation, en 1997*, a déclaré que ces dispositions étaient de nature interprétative, ce qui revient à permettre la remise en cause de la reconnaissance de la nationalité française à tous ces anciens militaires, trente ans après la délivrance de leurs certificats de nationalité française !
Comme l’a relevé Paul Lagarde, « en limitant l’assimilation de résidence aux seuls cas d’acquisition ou de réintégration, le législateur, pour des motivations manifestement financières, ne visait qu’à briser la jurisprudence Bokassa »*. On sait, en effet, que, par une discrimination difficilement acceptable, le montant des pensions versées aux anciens combattants n’est pas le même selon qu’ils ont conservé ou non la nationalité française.
Lors de la discussion de la loi Guigou du 16 mars 1998, plusieurs amendements, dont l’un adopté par la commission des lois de l’Assemblée nationale, ont été présentés, tendant à l’abrogation de l’article 43 de la loi de 1993 ; mais ils ont été rejetés, à la demande de la garde des sceaux…
Semblant contredire la désinvolture avec laquelle sont traités ces anciens militaires, le législateur a récemment introduit dans le code, à la suite d’une proposition de loi sénatoriale, une nouvelle possibilité d’acquisition de la nationalité française par les étrangers engagés dans les armées françaises et blessés en mission, au cours ou à l’occasion d’un engagement opérationnel, sans condition de résidence(2). Mais cette soudaine compassion est trompeuse, car la nouvelle disposition ne concernera en pratique que quelques personnes par an*.
* Pour ne pas alourdir les développements, on a préféré ne pas faire figurer ici les références jurisprudentielles et doctrinales. Elles sont signalées par un astérisque et nos lecteurs intéressés peuvent se les procurer en nous les demandant.
Circulaire DPM n° 2000/254 du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité française et perte de la nationalité française.
|
Notes
(1) « Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : […] 3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l’armée française ou au titre du service national actif ».
(2) Loi n° 99-1141 du 29 décembre 1999.

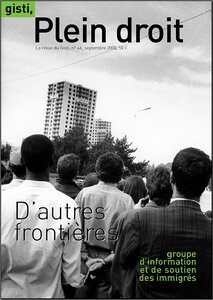
![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)










Partager cette page ?