Article extrait du Plein droit n° 47-48, janvier 2001
« Loi Chevènement : Beaucoup de bruit pour rien »
Les subtilités du Conseil d’État
Danièle Lochak
Professeur de droit public à l’Université de Paris X-Nanterre.
L’article 12 bis 7° a été présenté comme l’une des dispositions phares de la loi Chevènement. Il prévoit la délivrance « de plein droit » d’une carte de séjour temporaire à l’étranger « dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ».
Une fois décodées cette terminologie et cette syntaxe alambiquées, on comprend que le législateur a voulu retranscrire, dans l’ordonnance de 1945, les principes sur la base desquels la Cour européenne des droits de l’homme puis les juridictions administratives françaises ont jugé qu’un refus de séjour pouvait constituer une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit à chacun le droit au respect de sa vie privée et familiale.
La disposition en cause, présentée comme une innovation capitale, ne l’est donc pas vraiment, puisque, depuis longtemps, le juge imposait à l’administration, saisie d’une demande de délivrance d’un titre de séjour, lorsqu’elle constatait que l’étranger ne remplissait pas les conditions prévues par les textes pour obtenir l’un ou l’autre des titres existants, de s’assurer qu’un éventuel refus ne porterait pas une atteinte disproportionnée à ce fameux droit garanti par l’article 8.
Mais il est vrai que cette obligation était rarement – c’est un euphémisme – respectée spontanément par l’administration, comme l’atteste l’importance du contentieux en la matière et le nombre de refus de séjour censurés par le juge pour violation de l’article 8. Conformément à l’adage selon lequel « ce qui va sans dire va encore mieux en le disant », on ne peut donc que se féliciter de ce que le législateur ait décidé d’inscrire en toutes lettres, dans l’ordonnance de 1945, le droit pour l’étranger qui a ses attaches personnelles et familiales en France d’obtenir une carte de séjour.
C’est bien, en effet, un droit qui est reconnu à l’étranger – la délivrance est « de plein droit », dit le texte –, et l’administration se trouve, comme disent les juristes, en situation de « compétence liée ». Théoriquement. Car, en réalité, le droit en question n’est nullement inconditionné : il est au contraire subordonné à la reconnaissance, par l’administration, non seulement de l’existence mais aussi de l’intensité des attaches qui lient l’étranger à la France.
Il ne suffit pas d’avoir des « attaches », il faut encore que ces attaches soient telles qu’elles justifient de donner un titre de séjour à un étranger qui, la plupart du temps, est en situation irrégulière, ou à tout le moins précaire : on conçoit bien qu’un privilège aussi exorbitant ne saurait être accordé à la légère.
L’administration retrouve ainsi un très large pouvoir d’appréciation. On comprend, dans ces conditions, que le ministre de l’intérieur ait jugé bon de proposer aux préfectures, par le biais de la circulaire du 12 mai 1998, un mode d’emploi détaillé de la disposition en cause. Détaillé… mais néanmoins incomplet, et de surcroît ouvertement discriminatoire à l’encontre des couples non mariés en général et des couples de même sexe en particulier.
Il a fallu la promulgation de la loi sur le Pacs, en novembre 1999, pour que le ministre de l’intérieur prenne conscience que certaines choses avaient changé : d’où la circulaire du 10 décembre 1999, qui retouche a minima la circulaire du 12 mai sur les points où elle était trop manifestement incompatible avec les nouvelles dispositions législatives [1].
Une interprétation restrictive
Mais ce défaut de la circulaire du 12 mai 1998 n’était pas le seul, ce qui a conduit le Gisti à l’attaquer devant le Conseil d’État. Dans un arrêt rendu le 30 juin dernier, celui-ci a annulé un certain nombre de ses dispositions [2]. En ce qui concerne l’interprétation de l’article 12 bis 7°, il n’a usé que très timidement – trop timidement – de son pouvoir d’annulation : tout en reconnaissant le caractère restrictif de certaines dispositions, il les a néanmoins sauvées de la censure en considérant qu’elles ne liaient pas les préfectures et que, dès lors qu’elles n’avaient pas de caractère impératif, elles n’étaient pas illégales.
Le problème, c’est que les préfectures n’ont pas la même vision de ce qui est impératif et de ce qui ne l’est pas que le Conseil d’État : quand on leur dit que, sauf exception, le demandeur devra justifier de cinq ans de résidence en France, il est peu probable qu’elles acceptent d’abaisser la barre à trois ans ou quatre ans, quels que soient les éléments du dossier.
Au-delà des critiques que l’on peut adresser à une pratique jurisprudentielle malheureusement trop fréquente et dont les méfaits ont déjà été dénoncés dans ces colonnes [3], il est clair que l’interprétation restrictive donnée par la circulaire d’une disposition pourtant présentée comme une innovation capitale risque fort de limiter les retombées positives qu’on pouvait en espérer.
Le premier constat qui ressort de la lecture de la circulaire, c’est qu’elle évacue toute référence à la vie privée et se borne à évoquer la vie familiale. C’est ainsi que, dès la première phrase, la notion de vie privée et familiale est explicitée en ces termes : « la vie privée et familiale au titre de laquelle vous pourrez être conduit à délivrer un titre de séjour est limitée en principe à la seule famille nucléaire, à savoir une relation maritale et/ou une relation filiale ». La phrase suivante, qui apporte des exceptions à ce principe, continue à ignorer la vie privée puisqu’elle envisage uniquement « les autres aspects de la vie familiale au sens large (liens collatéraux, adoptions, tuteurs, grands-parents) ».
Or, la notion de vie privée est distincte de la notion de vie familiale et ne se confond pas avec elle. S’il est vrai que, lorsqu’est invoquée et retenue l’atteinte à la vie privée et familiale, c’est le plus souvent la vie familiale qui est en cause, il reste qu’il peut y avoir atteinte à la vie privée alors même que l’intéressé n’a pas d’attaches familiales dans le pays de résidence, comme l’a reconnu la Cour européenne des droits de l’homme dans un certain nombre d’affaires concernant des étrangers [4].
Dans l’arrêt C. c/Belgique du 7 août 1996, en particulier, la Cour, constatant que le requérant avait tissé de réels liens sociaux dans le pays d’accueil où il avait vécu depuis l’âge de onze ans, y avait reçu une formation scolaire puis professionnelle et travaillé pendant plusieurs années, en avait déduit qu’il y avait établi une vie privée, « laquelle englobe le droit pour l’individu de nouer et développer des relations avec ses semblables, y compris dans le domaine professionnel et commercial ».
Silence sur la vie privée
La circulaire ne se borne pas à faire le silence sur la vie privée : elle semble bel et bien exclure toute délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui n’aurait pas en France d’attaches familiales, si l’on en juge par le passage suivant : « Cette première vérification de l’existence d’une vie familiale en France à laquelle une décision de refus de séjour serait susceptible de porter atteinte vous permettra, à ce stade, d’opposer déjà un refus aux demandes émanant de personnes célibataires ou sans réelles attaches familiales en France » (souligné par le ministre). Et si des « dérogations » sont prévues aux principes énoncés, elles ont trait exclusivement à la condition tirée de la stabilité de la vie familiale et de l’impossibilité de reconstituer cette vie familiale en dehors du territoire français.
Si la circulaire prétend que les célibataires ne peuvent se réclamer de l’article 12 bis 7°, alors que la loi parle bien de protéger la vie privée, et pas seulement la vie familiale, n’était-elle pas à l’évidence illégale ?
Le Conseil d’État en a jugé autrement et a rejeté sur ce point le recours du Gisti. Pourtant – et à cet égard l’arrêt est positif – le juge proclame clairement que la notion de vie privée est distincte de la notion de vie familiale, de même qu’il reconnaît la justesse du constat fait par le Gisti quant au silence de la circulaire à propos de la vie privée. S’il n’annule pas les passages litigieux, c’est en appliquant un raisonnement qui consiste à dire, en substance, que même si la circulaire traite exclusivement de la vie familiale, son silence sur la vie privée ne peut pas et ne doit pas signifier que la vie privée ne sera jamais prise en compte : « si les développements suivants se rapportent exclusivement, dans le texte de la circulaire attaquée, à la vie familiale de l’étranger, ladite circulaire mentionne expressément la vie privée ; [et] elle ne pouvait avoir légalement ni pour objet ni effet d’empêcher un étranger remplissant les conditions de l’article 12 bis 7° de présenter au seul titre de son droit au respect de sa vie privée et l’administration de lui délivrer, le cas échéant, ledit titre de séjour ».
A ce raisonnement subtil qui s’apparente beaucoup aux « réserves d’interprétation » du Conseil constitutionnel, on aurait évidemment préféré une annulation nette et franche.
Sans famille, point de salut
Car à supposer même que le contenu de l’arrêt soit un jour porté à la connaissance des destinataires de la circulaire, ce genre de subtilités risque fort de leur échapper. Ils continueront donc à appliquer la circulaire à la lettre, ce qui bien entendu les conduira à refuser la délivrance d’un titre de séjour à quiconque ne peut faire état d’attaches familiales (à moins que l’intéressé ne soit « pacsé », auquel cas on lui appliquera les dispositions, quand même plus favorables, de la circulaire du 10 décembre 1999).
Sans famille, donc, point de salut. Mais même en famille, les choses sont loin d’être jouées d’avance. Car le second constat qui ressort de la lecture de la circulaire, c’est une interprétation particulièrement restrictive de la notion de vie familiale elle-même.
Certes, la circulaire, prenant le contre-pied des pratiques qui prévalaient jusque-là, pose en principe que, au regard de l’appréciation de l’existence d’une vie familiale, il n’y a pas de différence substantielle entre le mariage et le concubinage. Mais pour se contredire immédiatement après puisque, pour apprécier le caractère effectif de la relation de concubinage, elle prescrit de prendre en compte, outre l’ancienneté de la vie de couple et la durée du séjour antérieur en France – conditions également imposées aux conjoints –, la présence d’enfants issus de cette relation.
Cette dernière disposition, et celle-là seulement, a été censurée par le Conseil d’État, en tant qu’elle posait une règle nouvelle, non prévue par la loi, que le ministre n’avait donc pas compétence pour édicter.
De multiples conditions non prévues par la loi
Mais la circulaire prévoit encore d’autres conditions, applicables cette fois aussi bien au mariage qu’au concubinage, à savoir que le demandeur doit, sauf exception, séjourner habituellement en France depuis plus de cinq ans, que sa famille doit, elle aussi, résider en France depuis plus de cinq ans, et que l’un au moins des membres de la famille proche doit disposer d’un titre de séjour en cours de validité.
Autant de conditions non prévues par la loi. Concernant la régularité du séjour, la circulaire explique la raison de cette exigence en affirmant que, dans le cas contraire, la vie familiale peut se reconstituer sans dommage en dehors du territoire français.
Mais l’affirmation est bien trop péremptoire : d’une part, confondant régularité et stabilité du séjour, elle néglige les hypothèses où le membre de la famille, quoique démuni de titre de séjour, aurait résidé pendant de longues années en France, au point que son départ du territoire français porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; d’autre part, elle ignore les hypothèses où les deux conjoints, n’ayant pas la même nationalité, ne sont nullement assurés de pouvoir reconstituer leur vie familiale en dehors de la France.
Le Conseil d’État n’a pourtant voulu annuler aucune de ces dispositions, se bornant à constater qu’elles n’avaient pas de caractère réglementaire. La formule éclaire mal sur la motivation de la décision.
S’agissant de la condition de durée de séjour, on peut penser que c’est la rédaction même de la circulaire qui l’a sauvée de l’annulation : une durée inférieure à cinq ans ne pourra être admise que de manière exceptionnelle, dit-elle, ce qui réserve formellement le pouvoir d’appréciation des autorités préfectorales. Malheureusement, on sait d’expérience que ce pouvoir d’appréciation, rarement utilisé au bénéfice des étrangers, a encore moins de chances de jouer en leur faveur si le ministre présente d’emblée cette hypothèse comme exceptionnelle.
En ce qui concerne la condition de régularité du séjour des membres de la famille, qui, elle, est présentée comme impérative par la circulaire, la lecture des conclusions du commissaire du gouvernement laisse penser que le Conseil d’État y a vu une application de sa propre jurisprudence : ce qui devait inévitablement le conduire à regarder la disposition en cause comme le simple rappel d’une règle préexistante, et non comme édictant une règle nouvelle.
A moins, plus simplement, qu’il se soit laissé convaincre par la raison invoquée pour la justifier (la possibilité de reconstituer la vie familiale à l’étranger) et qu’il ait considéré que la règle avait pour elle la force de l’évidence. Une évidence trompeuse, pourtant, puisque, comme on l’a montré plus haut, l’atteinte à la vie familiale est largement indépendante de la régularité du séjour des membres de la famille. Sans même parler de l’atteinte portée à la vie privée qui, là encore, est complètement passée sous silence.
Comment interpréter la multiplication des conditions mises, dès le départ, par le ministre lui-même, à la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article 12 bis 7°, sinon comme une volonté de verrouiller un dispositif aux virtualités potentiellement libérales ? Le plus clair de l’histoire, c’est que, sous l’apparence trompeuse d’une délivrance de plein droit, l’administration conserve intact son pouvoir discrétionnaire, sans que le Conseil d’État trouve à y redire. Certes, comme tout pouvoir discrétionnaire, celui-ci s’exercera sous le contrôle du juge : mais cela veut dire encore du contentieux, encore des délais – avec, dans l’intervalle, la clandestinité et le risque d’être à tout moment éloigné du territoire. ;
Notes
[1] Voir Plein Droit n° 45, mai 2000, « Pacs : le droit de vivre à deux », p. 34.
[2] Pour un commentaire général de cet arrêt, voir plus loin, p. 51.
[3] On pourra notamment se reporter à un (très) ancien article paru dans le numéro 2 de Plein Droit, de février 1988, qui analysait le sort réservé à la circulaire de 1985 sur le regroupement familial par le Conseil d’Etat dans un autre arrêt rendu en 1987 à la requête du Gisti : « Les rafistolages du Conseil d’Etat ».
[4] Voir sur ce point l’article p. 18.

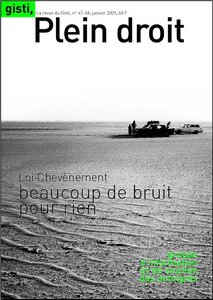
![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)










Partager cette page ?