Article extrait du Plein droit n° 47-48, janvier 2001
« Loi Chevènement : Beaucoup de bruit pour rien »
Défaite ou victoire ?
Danièle Lochak
Professeur de droit public à l’Université de Paris X-Nanterre.
Si l’on en juge par le nombre de dispositions annulées, le Gisti obtient là une grande victoire : six dispositions ont été censurées par le Conseil d’État, ce qui est beaucoup pour une seule circulaire. Certes, à nos yeux c’est encore insuffisant, puisque nous avions repéré bien d’autres illégalités ; mais on ne peut pas attendre du Conseil d’État qu’il porte toujours le même regard que nous sur les textes que nous lui déférons. Et même si nous continuons à penser que nous avons raison, c’est lui qui dit le droit…
Donc, en l’occurrence, le Conseil d’État nous a suivis en grande partie. Mais on ne peut en rester au constat : on a gagné, on a perdu. Certaines victoires n’ont qu’une portée symbolique ; à l’inverse, certaines défaites ne sont qu’apparentes ; enfin, de façon plus générale, on aimerait être sûr que là où la position de l’administration a été clairement censurée par le juge, celle-ci en tirera les conséquences.
Parmi les griefs invoqués par le Gisti, plusieurs portaient sur le fait que le ministre, n’ayant pas le pouvoir réglementaire, n’était pas compétent pour prendre par circulaire les mesures d’application de la loi – et cela indépendamment de tout jugement porté sur le contenu de ces mesures – que seul le Premier ministre est compétent pour prendre par décret.
Il s’agissait notamment des conditions mises à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » d’une part, « profession artistique et culturelle » de l’autre ; ou encore de l’organisation de la procédure devant la commission du titre de séjour, la circulaire confiant au représentant de la préfecture les fonctions de rapporteur.
Sur tous ces points, le Conseil d’État a donné raison au Gisti. Mais les dispositions annulées ayant dans l’intervalle été reprises par décret (ce qui atteste a posteriori du bien-fondé de nos critiques concernant l’incompétence du ministre), la satisfaction obtenue est purement symbolique.
Une victoire ambiguë
Au chapitre des victoires susceptibles d’avoir une portée concrète, on relève essentiellement l’annulation de certaines des conditions restrictives mises à la délivrance de la carte de séjour « vie privée et familiale ». Le Conseil d’État a annulé d’une part la disposition qui, pour l’application de l’article 12 bis 7°, subordonnait à la présence d’enfants communs la reconnaissance de l’effectivité de la vie familiale entre concubins [1], d’autre part celle qui exigeait de l’étranger né en France et y ayant effectué la plus grande part de sa scolarité qu’il justifie de son séjour en France mois par mois.
Autre victoire, un peu ambiguë : celle qui aboutit à l’annulation de la disposition de la circulaire prévoyant la saisine de la commission du séjour en cas de refus de renouvellement d’une carte de résident.
De fait, la circulaire allait ici plus loin que la loi, puisque l’article 14 quater de l’ordonnance ne prévoit la saisine de la commission, en ce qui concerne la carte de résident, qu’en cas de refus de délivrance et non de refus de renouvellement. Mais on peut se demander quel intérêt il y avait à demander l’annulation d’une disposition a priori favorable aux étrangers.
L’explication est la suivante : dans la mesure où la carte de résident doit être renouvelée de plein droit sans que rien puisse y faire obstacle – sauf l’absence du territoire français pendant plus de trois ans consécutifs (art. 18) ou la situation de polygamie (CE, 18 juin 1997, Gisti) –, l’obligation de saisir la commission pour le non-renouvellement d’une carte de résident, assortie de la précision que la saisine n’avait pas lieu d’être en cas de polygamie ou d’absence prolongée du territoire français, laissait entendre implicitement mais nécessairement que le non-renouvellement pourrait être motivé par d’autres raisons que l’une de ces deux-là, et notamment par la menace pour l’ordre public, en dépit de la position claire prise sur ce point par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 août 1993.
Un ajout évident de conditions restrictives
S’agissant des points sur lesquels le Conseil d’État ne nous a pas suivis, il convient également d’opérer des distinctions. Dans certains cas, le rejet du recours n’équivaut pas à nous donner tort sur le fond : simplement, le Conseil d’État interprète la circulaire autrement que nous et lui donne une portée différente, moins restrictive.
C’est le cas, par exemple, à propos de la situation du conjoint d’un étranger titulaire d’une carte « retraité ». La circulaire dispose sur ce point que « le conjoint du titulaire de la carte de séjour “retraité” ayant résidé régulièrement en France avec lui sous couvert d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident pendant la durée de validité de la dernière carte de résident délivrée au titulaire du droit principal, bénéficie d’un titre de séjour conférant les mêmes droits, à la condition d’être lui-même à la retraite ».
Ce faisant, elle semble bien subordonner la délivrance d’un titre de séjour au conjoint du titulaire de la carte « retraité » à des conditions supplémentaires non prévues par la loi : 1. la condition que le conjoint soit lui-même à la retraite (la formulation, de surcroît, est ambiguë : faut-il avoir atteint l’âge de la retraite ? ou avoir pris effectivement sa retraite ? ou encore toucher une pension de retraite ?) ; 2. la condition que la résidence régulière en France, prévue par la loi, ait coïncidé avec la durée de validité de la dernière carte de résident du bénéficiaire de la carte retraité (ce qui impliquerait, par exemple, que si le conjoint est reparti dans le pays d’origine préalablement, il ne pourrait plus prétendre à la délivrance du titre de séjour prévu par les textes).
L’ajout de conditions restrictives paraissait tellement évident que le commissaire du gouvernement avait conclu sans hésitation à l’annulation de la circulaire sur ce point. Or, le Conseil d’État ne l’a pas suivi, préférant réinterpréter la circulaire de façon à la rendre compatible avec la loi, sur la base d’un raisonnement à vrai dire assez obscur et alambiqué.
Réinterprétations tortueuses
En ce qui concerne la condition que le conjoint soit lui-même retraité, on lit dans l’arrêt : « il résulte des dispositions [de l’article 18 bis]… que le conjoint lui-même retraité du titulaire d’une carte de “retraité” a droit à la carte susmentionnée de façon autonome au titre du premier alinéa dudit article 18 bis ». Le Conseil d’État a-t-il voulu dire par là que, compte tenu de cet élément, la circulaire n’a pas pu vouloir dire ce qu’elle semblait dire, à savoir que le conjoint doit lui aussi être à la retraite ?
Quant à la seconde condition, il l’interprète ainsi : « en disposant que [ce] conjoint devait avoir résidé avec son conjoint “pendant la durée de validité de la dernière carte de résident” de ce dernier, la circulaire attaquée n’a pas entendu imposer au conjoint intéressé d’avoir résidé avec son conjoint pendant l’intégralité de la durée de validité de la dernière carte de résident de ce dernier ; que, dans ces conditions, elle n’a pas ajouté une condition à celles qui figurent à l’article 18 bis ».
Eh bien, s’il en est ainsi, tant mieux. Mais plutôt que de se livrer à ces réinterprétations tortueuses de la pensée administrative, n’eut-il pas été plus simple et plus sûr d’annuler des dispositions trompeuses (au point que même quelqu’un d’aussi avisé que le commissaire du gouvernement s’y est laissé prendre) ?
Quel impact pour le non-dit ?
On peut exprimer des regrets analogues en ce qui concerne les conditions d’application de l’article 12 bis 7°. Le Conseil d’État reconnaît que la circulaire est muette sur la prise en compte de la « vie privée » pour l’application de l’article 12 bis 7°, mais il n’y voit pas un motif d’annulation, dès lors que ce silence ne peut être interprété comme interdisant d’invoquer la vie privée à l’appui d’une demande de titre : c’est une façon de rappeler qu’un étranger peut prétendre à un titre même s’il n’a pas de liens familiaux mais seulement des liens personnels en France et qu’il ne se trouve donc pas dans l’un des cas prévus par la circulaire.
De même, il refuse d’annuler la disposition qui prévoit que, sauf exception, la durée de vie commune d’une part, du séjour en France d’autre part, ne pourra être inférieure à cinq ans, estimant que cette disposition, purement indicative, n’a pas de caractère réglementaire : ce qui signifie qu’on peut demander un titre même si l’on n’a pas cinq ans de séjour et que les préfectures ne peuvent refuser sa délivrance pour cette seule raison.
Cela étant, une annulation claire et nette eut été de loin préférable, car les agents destinataires de la circulaire vont bien entendu continuer à l’appliquer à la lettre, sans se soucier – à supposer qu’ils en aient connaissance – de la lecture souple qu’en a préconisé le Conseil d’État.
En ce qui concerne les dispositions de la circulaire relative au champ de compétence de la commission du titre de séjour, il est également regrettable que le Conseil d’État s’en soit tenu à une interprétation neutralisante du texte qui lui était soumis.
La circulaire indiquait – et indique toujours puisque sur ce point elle n’a pas été annulée – que la commission du titre de séjour ne doit être saisie que pour les demandes émanant d’étrangers relevant effectivement des articles 12 bis et 15 de l’ordonnance. Elle précise encore, plus loin, que les préfectures peuvent s’abstenir de saisir la commission lorsque l’étranger ne remplit pas, de façon certaine, une condition de fond de ces articles (les termes sont soulignés dans la circulaire).
Ces indications pouvaient certes paraître de bon sens et en gros conformes à la jurisprudence rendue à propos l’ancienne commission du séjour. Mais compte tenu de la façon dont sont désormais rédigées plusieurs des dispositions de l’article 12 bis, subordonner la saisine de la commission au caractère non douteux de l’appartenance de l’étranger à l’une des catégories mentionnées revient à limiter le champ de compétence de la commission bien en deçà des véritables exigences de la loi.
Comment peut-on, par exemple, décider qu’un étranger relève effectivement de l’article 12 bis 7° (vie privée et familiale) ou 12 bis 11° (étrangers malades) ou, à l’inverse, prétendre que, de façon certaine, il ne relève pas de ces dispositions, alors que la décision ne pourra être prise qu’après un examen approfondi du dossier qui suppose des appréciations délicates ? C’est justement dans ces hypothèses, parce qu’il n’y a aucune certitude, que la consultation de la commission est utile, voire indispensable ; or la rédaction de la circulaire incitera évidemment les préfectures à ne pas saisir la commission dans ces cas-là.
Le Conseil d’État n’a pas tenu compte de ces objections et s’est borné à constater que « lorsqu’un étranger ne remplit pas les conditions énoncée par les articles 12 bis et 15 de l’ordonnance et ne peut par conséquent être regardé comme étant mentionné auxdits articles, le préfet n’est pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour », de sorte que la circulaire n’a fait sur ce point que rappeler l’état du droit applicable.
La vraie question, en définitive, est celle des effets pratiques des victoires remportées au contentieux. Lorsqu’un décret est annulé, il n’est plus en vigueur, et l’annonce de son annulation paraît au Journal Officiel. S’agissant des circulaires, leur caractère officieux continue à jouer en leur faveur : rien n’oblige en pratique l’autorité hiérarchique à avertir les fonctionnaires des annulations prononcées par le juge, encore moins des précautions avec lesquelles il faut appliquer les dispositions validées pour tenir compte des « réserves d’interprétation » du Conseil d’État.
C’est ainsi que, près d’un an après l’annulation par le Conseil d’État, dans son arrêt du 26 janvier 2000, de quatre dispositions capitales de la circulaire du 25 juin 1998 sur l’asile territorial, on n’a toujours pas la preuve que des instructions quant aux conséquences à en tirer aient été données aux préfectures par le ministre de l’intérieur. ;

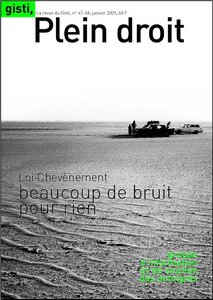
![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)










Partager cette page ?