Article extrait du Plein droit n° 28, septembre 1995
« Les nouvelles batailles de Poitiers »
Les mystifications du 22 bis
Danièle Lochak
Le libéralisme affiché par le juge n’est qu’une façade derrière laquelle se dissimule une réalité moins glorieuse. On dira que le juge n’y peut rien, et qu’il est bien obligé de statuer en droit, et pas en opportunité ni en équité. L’explication n’est pas convaincante. D’abord, le Conseil d’État a lui-même accepté de s’engager dans la voie du contrôle de l’opportunité, puisque pour censurer les erreurs manifestes d’appréciation commises par l’administration, il est bien obligé de tracer la frontière entre ce qui est excessif et ce qui ne l’est pas ; et finalement, ses critères ne sont pas très différents de ceux de l’administration préfectorale. Ensuite, il suffit de comparer les décisions du Conseil d’État avec les jugements rendus par les tribunaux administratifs pour prendre conscience du caractère particulièrement rigoureux des premières ; non pas que les juges de première instance soient d’un libéralisme effréné, mais leurs décisions favorables aux étrangers sont souvent censurées en appel par le Conseil d’État qui donne raison au préfet.
Tel est le constat qu’on peut dresser à l’issue d’une rapide plongée dans les décisions rendues en 1994 en matière de reconduite à la frontière. L’inventaire qui suit ne prétend pas à l’exhaustivité, mais le tableau dressé est hélas représentatif d’une réalité décidément bien déprimante.
Requêtes tardives
Le nombre de requêtes formées sur le fondement de l’article 22 bis et rejetées comme tardives atteste – au minimum – un dysfonctionnement dans le dispositif prévu par le législateur, qui était censé apporter aux intéressés une protection plus efficace que le recours de droit commun auquel il se substitue. L’expérience prouve que l’avantage tiré du caractère suspensif du recours formé dans les 24 heures est largement contrebalancé par l’impossibilité fréquente qu’ont les étrangers de le former en temps utile : soit qu’il est déjà trop tard lorsqu’ils retirent le pli recommandé à la poste, soit qu’ils ne réalisent pas que le délai de 24 heures est… un délai de 24 heures, que le cachet de la poste, contrairement à la formule consacrée, « ne fait pas foi », que les samedis et dimanches comptent comme des jours ouvrables, etc.
Rien ne sert de plaider l’ignorance. Non seulement « nul n’est censé ignorer la loi », mais, comme le rappelle avec constance le Conseil d’État, « la notification indiquait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision » : cette formalité suffit à faire courir lesdits délais et à justifier l’irrecevabilité, même si du coup l’intéressé est privé de tout recours.
Parmi la masse impressionnante de décisions rejetées pour cause de tardiveté, on se bornera à citer celle qui constate que la requête a été enregistrée une heure (!) après l’expiration du délai de 24 h (Badji, 30 novembre 1994) ou encore cette autre où l’intéressé alléguait que le juge judiciaire devant lequel il avait comparu avait refusé d’enregistrer son recours : aucun élément ne permettant d’établir la véracité de ses dires, l’argument n’est même pas pris en compte (Kepuke, 9 novembre 1994).
Il faudra bien, quand même, que le Conseil d’État se décide un jour à sortir de ses confortables certitudes : car un recours que les trois quarts des gens ne parviennent pas à former est-il encore un recours effectif au sens de la Convention européenne des droits de l’homme ?
Le mythe du retour facile
Dans deux arrêts fort remarqués en leur temps – Imanbaccus et Mme Olmos Quintero, du 29 juin 1990 – le Conseil d’État avait posé en principe que lorsqu’un étranger se trouve dans l’un des cas où il peut être reconduit à la frontière, « le préfet doit apprécier si la mesure envisagée n’est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l’intéressé, des conséquences d’une exceptionnelle gravité », et qu’il appartient au juge de vérifier que le préfet n’a pas commis sur ce point d’erreur manifeste d’appréciation.
Après avoir posé un si beau principe, le Conseil d’État avait toutefois rejeté les deux recours au fond. Ce qui, rétrospectivement, était déjà un mauvais présage. Dans la première espèce, l’intéressé alléguait être en France depuis 1982 (soit depuis huit ans au moment de l’arrêté de reconduite), y être entré juste avant sa majorité, vivre au domicile de sa belle-mère de nationalité française, et ne plus avoir d’attaches à l’île Maurice. Ces éléments n’ont pas ébranlé les membres du Conseil d’État, qui ont rejeté son recours sans hésitation si l’on en croit les conclusions du commissaire du gouvernement.
Dans la seconde espèce, la requérante n’était en France que depuis moins d’un an, mais elle vivait en concubinage avec un Français – avec lequel elle s’était du reste mariée après l’intervention de l’arrêté de reconduite – et était enceinte de quelques semaines.
Le juge n’a pas retenu l’erreur manifeste, une telle erreur devant correspondre, selon le commissaire du gouvernement, à des cas exceptionnels dans lesquels la reconduite aurait des conséquences humainement inacceptables : étranger sous traitement médical lourd et continu, femme en fin de grossesse. « Ce serait rendre un mauvais service à la juridiction administrative que de l’inciter à nourrir des incertitudes et des scrupules excessifs dans ce contentieux de la reconduite à la frontière. Il va de soi que les décisions de police en cette matière portent toujours une atteinte grave à la situation personnelle des intéressés. Cela ne saurait suffire, sauf à contrarier l’application de la loi, à retenir trop largement l’existence d’une erreur manifeste », déclarait le commissaire du gouvernement, dont on ne savait pas à l’époque qu’il serait un jour Directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’Intérieur [1].
Sur la base de cette jurisprudence, on note bien quelques annulations de reconduites à la frontière sur l’ensemble de l’année 1994, mais elles sont rarissimes.
A été ainsi considérée comme entachée d’erreur manifeste la reconduite à la frontière d’une ressortissante chinoise entrée en France en octobre 1989, déboutée de sa demande auprès de l’OFPRA, qui vivait maritalement avec un ressortissant chinois titulaire d’une carte de séjour et avec son propre fils né en Chine en 1984, et qui avait travaillé depuis son entrée sur le territoire français comme salariée déclarée (Mme Hu, 6 juillet 1994).
Mais en sens inverse, le juge n’a pas cru devoir annuler la reconduite à la frontière d’un ressortissant congolais qui alléguait pourtant devoir poursuivre des traitements à la suite de graves brûlures de la face subies en 1983 (Lubaki, 4 mai 1994).
Le Conseil d’État ne s’est pas non plus laissé convaincre, contrairement au tribunal administratif d’Orléans, du caractère excessif de l’atteinte portée à la situation personnelle d’une ressortissante nigériane dont l’état de santé était précaire et qui suivait un traitement médical, dès lors qu’il n’apparaissait pas que les affections dont elle souffrait l’empêcheraient de voyager sans danger ni que l’interruption des soins reçus en France lui ferait courir des risques graves (Préfet d’Indre-et-Loire c/Mme Baba, 30 novembre 1994).
Dans un autre arrêt de principe (Mme Babas, 19 avril 1991), le Conseil d’État avait posé la règle selon laquelle l’administration, lorsqu’elle prend une mesure de reconduite à la frontière, doit vérifier que l’atteinte portée au respect de la vie familiale – garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme – n’est pas disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Cela ne l’avait pas empêché en l’espèce de rejeter le recours de Mme Babas : entrée en France pour rejoindre son concubin de nationalité marocaine, elle avait donné naissance à un enfant en mars 1989 ; mais l’atteinte portée aux liens du couple n’était pas irrémédiable, avait estimé le juge, faisant valoir que son concubin pouvait la suivre au Maroc, ou qu’elle-même pouvait revenir ultérieurement en France pour solliciter un titre de séjour.
Quel respect de la vie familiale ?
L’attitude du Conseil d’État est parfaitement résumée dans ce considérant qui figure dans tous les arrêts de rejet : « compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l’intéressé, et eu égard aux effets d’une telle mesure », la reconduite à la frontière n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Autrement dit, lorsque l’intéressé ne séjourne en France que depuis peu d’années, a fortiori depuis quelques mois, et qu’il n’a jamais été ou n’est plus depuis longtemps en situation régulière, le juge considère que son départ ne porte qu’une atteinte minime à sa vie familiale, d’autant que la reconduite à la frontière ne l’empêche pas de revenir en France immédiatement après.
L’idée que la reconduite à la frontière n’a pas de conséquences durables est évidemment battue en brèche par ce qu’on sait de la pratique des consulats. Mais le Conseil d’État, lui, fait semblant de ne pas le savoir, ce qui lui permet de s’en tenir imperturbablement et avec bonne conscience au formalisme juridique le plus étroit.
Les annulations sont si rares qu’elles en deviennent presque surprenantes. Le Conseil d’État a ainsi considéré que portait une atteinte excessive au respect de la vie familiale la reconduite à la frontière d’une jeune algérienne entrée en France avec sa famille à l’âge de 5 ans en 1962 et qui y avait résidé sans interruption jusqu’en 1986 et à nouveau depuis 1989 (Préfet des Yvelines c/Mlle Hmima Bali, 29 décembre 1993), ou encore la mesure frappant une Zaïroise déboutée de sa demande de statut de réfugié qui vivait en France depuis l’âge de 12 ans et y avait séjourné sans interruption depuis 1977 – à part une interruption d’un an en 1989 –, et qui, mariée avec un Zaïrois, avait eu avec lui un enfant né en France, maintenant âgé de 7 ans (Mme Sinda, 21 novembre 1994).
En revanche, n’est pas contestable aux yeux du juge la mesure frappant un demandeur d’asile débouté de nationalité chinoise dont la femme séjournait régulièrement en France avec leurs deux fils, puisque la femme pourra déposer une demande de regroupement familial (Li, 21 novembre 1994). Toujours enfermé dans sa tour d’ivoire et soucieux de statuer « en droit » pur, le juge n’a cure des aléas liés à un retour en Chine, ni des obstacles juridiques et pratiques qui entravent l’exercice du soi-disant droit au regroupement familial.
Peu importe que l’étranger vécût en France maritalement avec une femme dont il avait eu un enfant, né en 1987 et à l’égard duquel il exerçait l’autorité parentale (Mbambi, 6 juillet 1994). Peu importe de même que l’intéressée ait été sur le point de contracter mariage avec le ressortissant français avec lequel elle vivait déjà dès lors, nous dit-on, que la reconduite à la frontière ne lui interdit pas de se marier (sic) (Mlle Jawad, 7 février 1994). La solution n’est d’ailleurs pas différente lorsque le mariage a pu avoir lieu avant l’exécution de la mesure, comme dans le cas de ce ressortissant camerounais entré en France en 1981, qui vivait maritalement depuis 1988 avec une Française, avec laquelle il s’était finalement marié… mais après l’intervention de l’arrêté préfectoral (Afane, 4 mai 1994).
D’une façon générale, le fait que l’arrêté de reconduite soit intervenu juste avant ou juste après la célébration du mariage – qui laisse évidemment supposer que cette mesure avait pour objet, et dans le premier cas pour effet, de faire obstacle au mariage – laisse le Conseil d’État de marbre : il est vrai qu’en droit strict la légalité d’une mesure s’apprécie à la date où elle a été prise et que, même sous l’empire de la législation antérieure à 1993, seul était protégé contre la reconduite le conjoint de Français marié depuis plus de six mois ; vrai aussi que, toujours en droit strict, l’étranger marié avec un(e) Français(e) peut demander un visa pour revenir en France et y mener une vie familiale normale…
Le droit, on le sait, s’accommode bien des fictions.
Ce même raisonnement a conduit le Conseil d’État à donner raison au préfet contre le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne dans une affaire concernant une ressortissante turque, qui séjournait en France avec son époux détenteur d’un titre de séjour et avec ses cinq enfants : car selon le Conseil d’État, l’intéressée pouvait emmener ses enfants avec elle et attendre que son mari dépose une demande de regroupement familial (Préfet de la Marne c/Mme Etemoglu, 19 septembre 1994). Que les enfants n’aient le choix qu’entre interrompre leur scolarité et être séparés de leur père, ou rester en France avec leur père mais sans leur mère, et cela pendant longtemps compte tenu des aléas de la procédure de regroupement familial, la Haute assemblée ne s’en émeut guère.
Et cette attitude n’est pas isolée. On la retrouve dans de nombreuses affaires dans lesquelles le Conseil d’État prend le contre-pied des juges de première instance.
Dans un arrêt Buayi, rendu le 6 novembre 1987, et qui fit lui aussi à l’époque grand bruit chez les commentateurs attitrés de sa jurisprudence, le Conseil d’État avait jugé que la décision qui fixe le pays de destination en cas d’éloignement du territoire était une décision distincte de l’arrêté d’expulsion ou de reconduite à la frontière. Sur cette dernière, il lui revenait d’exercer un contrôle non pas « restreint », c’est à dire limité à la censure de l’erreur manifeste d’appréciation, mais « normal », de façon à vérifier notamment le respect du principe de non refoulement posé par la Convention de Genève et la non violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme qui interdit de renvoyer une personne dans un pays où elle risquerait d’être exposée à des tortures ou des traitements inhumains et dégradants.
Risques encourus dans le pays de destination
Il est vrai qu’après cette belle déclaration de principe, le Conseil d’État n’avait pas hésité, dans ce même arrêt, à décider qu’en l’espèce le requérant, originaire du Zaïre, et dont la demande d’admission au statut de réfugié avait été rejetée par l’OFPRA, « ne justifiait d’aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d’origine », ce qui laissait mal augurer des effets concrets de cette jurisprudence formellement libérale.
De fait, bien rares ont été les annulations prononcées sur le fondement de cette jurisprudence - dont a cependant bénéficié un Algérien dans une hypothèse où, selon le juge, il n’était pas contesté que son retour vers son pays d’origine comporterait pour lui des risques liés à ses activités politiques (Bahri, 8 avril 1994). Mais les autres requérants ont eu moins de chance. Qu’il s’agisse du Zaïre, de Haïti, de la Colombie, du Ghana, du Liberia, de la Turquie (pour des Kurdes), de la Chine, de l’Albanie, de la Mauritanie, de l’Algérie, du Sri Lanka (pour un Cinghalais), de l’Irak (pour un assyro-chaldéen) ou même du Burundi – autant de pays où comme chacun sait personne ne risque sa vie –, imperturbablement la réponse est la même : le requérant n’établit pas la réalité des risques auxquels il serait exposé, risques dont l’OFPRA et la Commission des recours, relève le Conseil d’État, n’ont d’ailleurs pas retenu l’existence. Le mot « d’ailleurs » est utilisé à dessein pour faire croire que l’argument est surabondant ; il ne saurait cacher que le rejet de la demande de statut pèse de façon déterminante dans l’appréciation du Conseil d’État. Celui-ci n’a pas de raison de démentir une juridiction avec laquelle il entretient des rapports organiques étroits dès l’instant que le requérant n’apporte pas d’éléments nouveaux par rapport à ceux qu’il a invoqués devant les instances de détermination du statut. Cette attitude est d’autant plus contestable qu’à supposer même que l’intéressé ait été, à juste titre, débouté de sa demande parce qu’il n’entrait pas dans la définition du réfugié donnée par la Convention de Genève, il peut parfaitement encourir malgré tout des risques pour sa vie ou sa liberté en retournant chez lui.
Le Conseil d’État se montre à cet égard plus rigoureux encore que les tribunaux administratifs, si l’on en juge par le nombre non négligeable d’annulations de jugements de première instance.
Ainsi, contrairement au tribunal administratif de Lyon, le Conseil d’État a estimé que les déclarations d’une ressortissante angolaise qui se bornait à faire état de la situation générale dans son pays et à alléguer son appartenance à l’UNITA ne suffisaient pas à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée (Préfet du Rhône c/Mme Lusimbamo, 30 novembre 1994). Il n’a pas non plus estimé convaincantes les déclarations d’un ressortissant turc qui invoquait la situation en Turquie, son appartenance ethnique et son engagement politique ainsi que des persécutions subies par des membres de sa famille, car ses allégations n’étaient assorties d’aucune justification probante de la réalité de risques encourus. Le tribunal administratif de Lyon avait pourtant statué en sens inverse le contraire (Préfet du Rhône c/Rahatsoz, 30 novembre 1994).
La décision la plus surprenante reste quand même celle par laquelle le Conseil d’État a annulé un jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble qui avait estimé suffisamment sérieux les risques allégués par un Tutsi débouté de sa demande de statut de réfugié que l’administration voulait renvoyer vers le Burundi. « Si M. Bisekere fait état de la situation qui prévaut dans son pays d’origine et de son appartenance ethnique et fait valoir que, sous-officier dans l’armée du Burundi et appartenant à l’ethnie tutsi, il n’a volontairement pas rejoint son unité à l’issue du stage de formation militaire qu’il a suivi en France pour ne pas participer aux exactions dirigées contre les Hutus, il n’est pas établi par les pièces du dossier que la décision prise par M. Bisekere de ne pas rejoindre son pays ait été motivée en réalité par les risques qu’il aurait encourus en cas de retour dans son pays d’origine, risques dont au demeurant la matérialité n’est pas non plus établie » (Préfet de la Haute-Savoie c/M. Bisekere, 21 novembre 1994). Sans commentaire.
Le ministère de l’intérieur relevait déjà, en 1993, dressant la statistique des décisions rendues au cours du dernier trimestre de l’année 1992, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine, examiné vingt et une fois, dont onze fois pour des Turcs et une fois pour un Tamoul, n’avait donné lieu à aucune annulation.
On comprend, dans ces conditions, que ce même ministre de l’intérieur, dans une circulaire du 11 février 1993 adressée aux préfets, et qui faisait le point du résultat des actions contentieuses en matière de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, ait pu conclure en ces termes :
« L’analyse de ces décisions permet d’observer que le Conseil d’État […] adopte en matière de reconduite à la frontière une attitude de stricte légalité qui le conduit à s’écarter des solutions d’opportunité parfois retenues par les juges du premier degré. Cette jurisprudence […] doit vous conforter dans l’utilisation, avec de bonnes chances de succès, de la voie de l’appel contre les jugements défavorables à l’administration ».
Autrement dit : continuez à reconduire allègrement à la frontière sans trop vous soucier de la vie familiale ou de la situation personnelle des personnes ni des risques qu’elles prétendent encourir dans leur pays d’origine. Et si par hasard un tribunal administratif venait vous mettre des bâtons dans les roues, faites appel, vous êtes quasiment sûrs que le Conseil d’État vous donnera raison.
Ne serait-ce pas l’aveu que le juge, ici, n’est rien d’autre que l’alibi de l’État de droit ?
L’article 22 bis
|

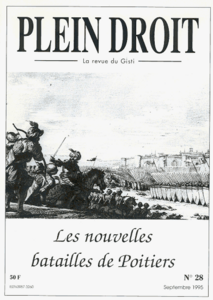
![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)










Partager cette page ?