Article extrait du Plein droit n° 41-42, avril 1999
« ... inégaux en dignité et en droits »
La charge de la preuve dans les cas de discrimination : Les femmes, les syndicats... et bientôt les étrangers
Marie-Thérèse Lanquetin
Chercheur à l’Université Paris X et à l’IRERP, institut de recherche sur l’entreprise et les relations professionnelles – Unité associée au CNRS
La directive prise par le Conseil de l’Union européenne le 15 décembre 1997 et relative à la charge de la preuve dans les cas de discriminations fondées sur le sexe, a été adoptée après une dizaine d’années de débats tant juridiques que politiques sur l’opportunité ou la nécessité d’un tel texte. Elle reprend, en effet, une jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) sur la preuve de la discrimination et spécialement de la discrimination indirecte.
Cette jurisprudence a progressivement couvert tout le champ du droit du travail et la sécurité sociale : élaborée d’abord à propos de l’égalité de rémunération entre travailleurs masculins et féminins prévue à l’article 119 du Traité CEE, elle s’applique également à l’égalité entre hommes et femmes dans l’accès à l’emploi, la formation et la promotion professionnelle, aux conditions de travail ainsi qu’en matière de sécurité sociale mais avec moins de succès.
Fallait-il adopter cette directive qui risquait de figer ou de reprendre imparfaitement une jurisprudence qui a été construite par la CJCE depuis 1981 ? Le premier projet qui remonte à 1987 a été progressivement vidé de son contenu parce que son fondement juridique (les articles 100 et 235 du Traité) exigeait l’unanimité des États. L’accord sur la politique sociale annexé au protocole social du Traité de Maastricht a fourni un autre fondement juridique et le projet a finalement été adopté à la majorité qualifiée par quatorze États membres.
La solution adoptée permettra d’assurer, du moins dans les États membres peu familiers avec le mode de raisonnement de la CJCE en matière de discrimination, une meilleure diffusion et une plus grande efficacité du droit de l’égalité entre hommes et femmes ainsi qu’une plus grande sécurité juridique. Des difficultés demeurent cependant, qui tiennent à des formulations imprécises de la directive par rapport à la jurisprudence communautaire et qui devront être levées lors des transpositions nationales.
Elle permettra, dans l’immédiat, de rendre visible, notamment dans le code du travail, le régime de la preuve de la discrimination à raison du sexe. Elle introduira dans le droit national la notion de discrimination indirecte, notion que les juges nationaux ont du mal à recevoir et spécialement le juge administratif.
Bien plus, ces nouvelles dispositions introduites dans le droit national devraient influencer le droit de la preuve de toutes les discriminations. Déjà le mode de raisonnement communautaire a été utilisé avec succès s’agissant de la discrimination anti-syndicale. Pourquoi ne le serait-il pas s’agissant des discriminations à l’égard des travailleurs étrangers ?
L’ordre juridique communautaire
La question de la discrimination est au centre de l’ordre juridique communautaire. S’agissant des personnes, l’interdiction de la discrimination est affirmée dans deux domaines : la nationalité et le sexe. Sa mise en œuvre a connu, grâce à la jurisprudence de la CJCE, d’importants développements mais avec une originalité propre à chacun de ces domaines.
En effet, pour que l’égalité entre nationaux et migrants ou entre travailleurs masculins et féminins soit réalisée en droit mais aussi en fait, la CJCE a eu recours à la notion de discrimination indirecte qui existe dès lors qu’un critère apparemment neutre aboutit au même résultat que s’il y avait discrimination directe, c’est-à-dire à des effets disproportionnés sur l’un des groupes concernés.
Mais la notion de discrimination indirecte n’a pas eu la même fonction dans les deux domaines envisagés. Pour les travailleurs migrants, poser par exemple, un condition de résidence, critère apparemment neutre, est un obstacle à la libre circulation : la non discrimination à raison de la nationalité est la condition de la libre circulation, elle est donc utilisée pour lever les obstacles à la libre circulation.
Quant à la discrimination en raison du sexe, la question centrale est la lutte contre les différences de traitement entre les hommes et les femmes au travail, et donc, celle de la preuve de la discrimination. C’est dans ce domaine que la CJCE a été le plus innovante en élaborant un processus probatoire affiné au fil des arrêts, processus appliqué non seulement à la discrimination indirecte mais à toute discrimination apparente, qu’elle soit directe ou structurelle ou encore systémique.
En effet, une différence de traitement peut être qualifiée de discriminatoire alors qu’elle ne résulte pas, à proprement parler, d’une mesure prise par un l’employeur. Elle peut résulter des représentations que l’on a d’une profession, être la conséquence des préjugés que l’on a par rapport à un certain type de main d’œuvre, auquel cas elle fait système.
Discrimination collective
La discrimination implique le plus souvent une comparaison. Mais une comparaison entre deux salariés de sexe différent n’est pas obligatoirement significative. L’originalité de la jurisprudence de la CJCE est de montrer que la dimension collective révèle le phénomène discriminatoire. Ainsi, lorsqu’une règle d’égalité est affirmée, si la mesure prise par un employeur frappe un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes, il y a présomption de discrimination, à moins que l’employeur n’établisse que ladite mesure s’explique par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.
La preuve de la discrimination indirecte comporte deux étapes. La première est à la charge du demandeur. La salariée, en l’espèce, doit montrer que la situation dans laquelle elle se trouve concerne plus de femmes que d’hommes. La seconde, à la charge de l’employeur concerne la justification de la mesure prise, de la différence constatée. Pour la CJCE « ce déplacement du fardeau probatoire est une nécessité » car « s’il appartient normalement à la personne qui allègue des faits à l’appui de sa demande d’apporter la preuve de leur réalité, il ressort de la jurisprudence de la CJCE que la charge de la preuve peut être déplacée lorsque cela s’avère nécessaire pour ne pas priver les travailleurs victimes de discrimination apparente de tout moyen efficace de faire respecter le principe d’égalité » (de rémunération)(1).
Même si la demande en justice est individuelle, il convient de resituer le demandeur dans son groupe d’appartenance – les femmes de telles qualifications – et la comparaison a lieu avec un autre groupe comparable composé majoritairement d’hommes de même qualification. Il s’agit de montrer que les données statistiques sont valables, significatives, que la différence de rémunération n’est pas le résultat de phénomènes fortuits ou conjoncturels.
La première difficulté tient à la définition des groupes comparables. Si la CJCE donne des indications au juge national, seul à même d’opérer cette appréciation, celle-ci varie selon les cas d’espèce. Mais, et c’est là la seconde difficulté, le salarié ne pourra, le plus souvent, définir seul le cadre de la comparaison. L’organisation syndicale devrait ici jouer un rôle important. Dans un certain nombre d’États membres, des agences nationales pour l’égalité jouent un rôle déterminant pour appréhender la question des discriminations et aider à préciser les termes d’un litige. En définitive, il s’agit d’établir que, à qualification égale, les femmes sont moins payées que les hommes. Ce constat permet de présumer une discrimination à moins que l’employeur ne justifie la différence en cause.
L’égalité de traitement entre hommes et femmes est un droit fondamental. Or le respect des droits fondamentaux fait partie des principes généraux du droit communautaire dont la CJCE est gardienne. De plus, le principe étant l’égalité, toute exception est d’interprétation stricte.
La présomption de discrimination étant établie par le demandeur, seules des justifications pleines et entières portant tant sur la légitimité de la mesure que sur sa proportionnalité au but poursuivi sont susceptibles de faire tomber la présomption.
La preuve à la charge de l’employeur
Le premier mérite de la directive est de fixer le régime de la preuve en lui donnant une portée générale. C’est l’objet de l’article 4 qui stipule que « les États membres, conformément à leur système judiciaire, prennent les mesures nécessaires afin que, dès lors qu’une personne s’estime lésée par le non respect à son égard du principe d’égalité de traitement et établit devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il importe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe d’égalité de traitement ».
Ce texte met la preuve à la charge de l’employeur dès lors que le demandeur « établit des faits qui permettent de présumer une discrimination directe ou indirecte ». L’établissement de ces faits ne se présente pas de manière identique dans le cas de la discrimination directe ou indirecte. Dans le premier cas, il suffira au demandeur d’établir que la prise en compte du critère prohibé est plausible, qu’on peut raisonnablement y croire pour déclencher le transfert de la charge de la preuve sur l’employeur. La directive devrait permettre de répondre au problème de la pluralité des causes.
Quant à la discrimination indirecte, l’objet de la preuve qui pèse sur le demandeur paraît plus lourd. Une première lecture lie étroitement la définition de la discrimination indirecte et l’article 4 de la directive. Le demandeur devrait établir que la mesure frappe une proportion plus élevée de femmes que d’hommes après avoir choisi le cadre pertinent de la comparaison. L’information à rassembler est importante et ne peut se concevoir sans l’intervention de tiers, organisation syndicale, comité d’entreprise, inspection du travail à défaut d’agence spécialisée.
Une autre lecture confère une plus grande autonomie à l’article 4 par rapport à la notion de discrimination indirecte. Le demandeur devrait produire des éléments suffisamment vraisemblables pour que le juge procède ou fasse procéder à des investigations complémentaires afin de rechercher des éléments de comparaison objectifs. Cette seconde lecture a le mérite d’ouvrir plus largement l’action en discrimination.
La directive définit par ailleurs, à l’article 2, la notion de discrimination indirecte : « Une discrimination indirecte existe lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion plus élevée de personnes d’un sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit approprié(e) et nécessaire et ne puisse être justifié(e) par des facteurs objectifs et indépendants du sexe des intéressés ».
Apparemment tous les ingrédients de la notion jurisprudentielle sont présents mais cette définition ne rend pas exactement compte de la jurisprudence. Elle ne fait pas apparaître clairement les rapports entre l’objectif et les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif. Pourtant l’objectif est bien premier. Le juge doit pouvoir examiner s’il est légitime avant d’examiner s’il n’y avait pas le moyen d’atteindre cet objectif de façon moins discriminatoire, et si les moyens sont appropriés et nécessaires c’est-à-dire s’ils sont proportionnés.
L’effet ou le but d’une mesure
Au plan théorique, il n’y a pas de difficultés majeures pour une extension du processus probatoire de la CJCE à d’autres motifs de discrimination. Les textes tant nationaux qu’internationaux postulent l’unité de la notion. Des difficultés se rencontrent néanmoins dans la pratique judiciaire.
L’unité de la notion résulte des textes fondateurs issus du droit international des droits de l’Homme. La définition de la notion de discrimination donnée par ces textes, et notamment par la convention 111 de l’OIT, met l’accent sur l’effet produit par une mesure : « Le terme de discrimination comprend : a) Toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement » en matière d’emploi ou de profession. L’article 1er prévoit également la possibilité, pour un État, de spécifier d’autres distinctions, ce que la France a fait notamment s’agissant des mœurs, de l’exercice normal du droit de grève ou des activités mutualistes.
Cette définition se retrouve dans les conventions de l’ONU sur l’élimination de toute discrimination à raison du sexe ou de la race. Dans ces conventions, il est dit « qui a pour effet ou pour but ». Les termes de l’alternative permettent d’affirmer que l’effet suffit.
Qu’il s’agisse de discrimination directe ou indirecte dans les domaines couverts par l’interdiction de la discrimination, la constatation de l’effet défavorable d’une mesure, constatation objective, implique la justification par l’auteur de la mesure. Contrairement à une conception traditionnelle qui faisait dépendre, même en matière civile, l’existence de la discrimination de la preuve d’une intention, le droit moderne aborde cette question comme d’autres questions en droit du travail, en termes objectifs. Il faut noter toutefois qu’en matière pénale, la place plus ou moins grande donnée à l’élément moral de l’infraction peut constituer un frein à cette analyse objective de la discrimination.
Scepticisme ambiant
Le régime juridique de la preuve de la discrimination entre hommes et femmes n’est pas à ce jour pleinement reçu par le juge français tant est prégnante la règle selon laquelle la preuve repose sur le demandeur en justice.
Le contentieux en la matière reste d’une manière générale quantitativement faible. Si l’on met à part le contentieux initié par des hommes invoquant une discrimination afin de bénéficier d’avantages conventionnels réservés antérieurement aux femmes, la Cour de cassation ne connaît que d’une ou deux affaires par an concernant les discriminations dont seraient victimes les femmes. La faiblesse quantitative de ce contentieux n’est guère propice à l’élaboration d’une politique jurisprudentielle en la matière, et jusqu’ici la Cour n’a pas manifesté clairement, dans ses quelques arrêts, la volonté de reprendre à son compte le régime probatoire construit par le droit communautaire. Elle n’a pas manifesté non plus sa volonté d’opérer un contrôle approfondi des qualifications retenues par les juges du fond.
Seul un arrêt de la Cour d’appel de Riom faisant application de la jurisprudence communautaire n’a pas été censuré par la Cour de cassation, ce qui marque une acceptation au moins tacite de cette jurisprudence. Par ailleurs, la première question préjudicielle posée par la Chambre sociale à la CJCE date seulement de 1995.
Les raisons de cette absence de dynamique contentieuse sont multiples et renvoient pour partie à une faible mobilisation des acteurs concernés qui estiment souvent que l’action en justice traduit un échec. Même si les statistiques sont accablantes, la discrimination entre hommes et femmes dans l’emploi n’est pas, en général, considérée comme une question sérieuse !
Les difficultés d’appropriation de la notion de discrimination indirecte et les obstacles judiciaires à sa reconnaissance alimentent un scepticisme ambiant sur l’efficacité de ce mode de traitement. Faute d’agence spécialisée, comme il en existe dans certains pays, les éléments à rassembler pour conduire une procédure sont souvent hors de portée du justiciable isolé qui ne trouvera pas aisément les relais nécessaires à une action efficace.
Mais si la jurisprudence communautaire ne semble guère appliquée en droit national s’agissant des femmes, il faut espérer que son utilisation technique, dans d’autres domaines, profitera également aux femmes.
A travail égal, salaire égal
La règle « à travail égal, salaire égal » était jusqu’à une date récente considérée comme s’appliquant aux seules discriminations entre hommes et femmes.
Il était admis qu’il n’existait pas, en la matière, de règle générale, et que la liberté de l’employeur, au-delà des dispositions légales et conventionnelles, primait sur l’égalité.
La Cour de cassation, dans deux affaires récentes, l’une du 29 octobre 1996 et l’autre du 15 décembre 1998 énonce que la règle « à travail égal, salaire égal », règle particulière d’égalité de rémunérations entre hommes et femmes, est l’application d’une règle plus générale d’égalité entre tous les salariés « pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ».
Elle l’applique alors à une différence de rémunération entre deux secrétaires de direction de même sexe. Elle l’applique également à un délégué syndical qui s’estimait discriminé par rapport à huit des dix salariés composant l’atelier où il travaillait : « Attendu qu’ayant relevé que M. Chatet accomplissait avec un coefficient identique, une même qualification et une ancienneté comparable, le même travail que les autres salariés de l’atelier mais percevait une rémunération moindre que celle allouée à ces derniers, et que l’employeur ne donnait aucune explication à cette différence de traitement… ». Ce faisant la Cour adopte le même mode de raisonnement que la Cour de justice. Face à une différence de traitement qui ressort des constatations de fait, alors que les salariés sont dans une situation identique, c’est à l’employeur de justifier la différence de rémunération.
C’est le mode de raisonnement de la CJCE en matière de discrimination indirecte qui a été soutenu s’agissant de la discrimination antisyndicale devant les juridictions nationales pénales et civiles.
Dans une première affaire IBM, l’inspecteur du travail avait dressé procès-verbal à propos de la situation de délégués syndicaux dont la carrière était défavorisée. Le tribunal correctionnel de Montpellier avait retenu comme constituant l’infraction, des faits et une série d’actes qui se succédaient sur plusieurs années et qui, par leurs effets cumulés, étaient susceptibles de constituer une discrimination antisyndicale. Ces éléments, de plus, ne concernaient pas une personne isolée mais un groupe appartenant à une seule organisation syndicale.
La méthode statistique et sociologique utilisée dans cette affaire était directement inspirée de la jurisprudence de la CJCE sur la discrimination indirecte. Toutefois, la Chambre criminelle prenant appui sur l’élément intentionnel n’a pas validé la démarche.
Dans des affaires civiles, en revanche, la Cour d’appel de Paris notamment retiendra la qualification de discrimination dans une affaire PEUGEOT à partir d’une même méthode d’approche. Une citation directe sera même déposée contre l’entreprise Peugeot qui préférera négocier un accord sur la carrière des délégués syndicaux.
Discrimination en raison de « l’origine »
La jurisprudence relative aux discriminations dans l’emploi subies par les étrangers est très peu abondante tant au plan civil qu’au plan pénal. Cependant, un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation mérite d’être signalé. L’attendu de principe donne une première mesure du problème : « Du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l’article L.122-45 du Code du travail, il résulte que nul ne peut faire l’objet de mesures discriminatoires en raison de son origine ».
Il s’agissait d’un salarié, R. Boufagher, licencié pour fin de chantier, l’ordre des licenciements ayant été déterminé selon le critère « de la charge de famille nombreuse différemment appréciée selon l’origine européenne d’une part et maghrébine et turque d’autre part » (c’est-à-dire que deux enfants turcs ou maghrébins équivalaient à un enfant français !). Ce critère avait été défini avec l’accord du comité d’entreprise et sans critique de l’inspection du travail. L’arrêt est certes exemplaire tant en raison de la référence constitutionnelle qu’à celle de « l’origine » du salarié. Mais il s’agissait d’une discrimination directe.
Cette décision vise donc « l’origine », catégorie juridique plus large que celle d’étranger puisqu’elle peut concerner des personnes ayant la nationalité française.
D’une manière générale, les textes ne renvoient pas uniquement au critère de nationalité mais à un ensemble de critères qui prennent en compte le fait que cette forme de discrimination prend souvent appui sur les apparences physiques, la consonance des noms ou tout autre élément faisant présumer une origine étrangère. Outre les questions posées par la mise en œuvre de ces critères, c’est évidemment à l’embauche que la discrimination est la plus marquée.
Le code du travail interdit de discriminer « à raison de […] l’origine, l’appartenance à une ethnie, une nation ou une race ». Le code pénal procède également par une énumération qui est quelque peu différente : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre personnes physiques (ou morales) à raison de […]leur appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation une race ou une religion déterminée ».
Ces énumérations renvoient aux conventions internationales des droits de l’homme que la France a ratifiées. Ainsi, la convention 111 de l’OIT énumère « la race, la couleur, l’ascendance nationale », la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme cite « la couleur, la race, la langue, la religion ou l’origine nationale… » et, enfin, la Convention de l’ONU sur l’élimination de toute forme de discrimination raciale « la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique ».
Le droit international des droits de l’Homme recourt à des énumérations variables qui s’expliquent par l’adoption successive de ces textes et les sensibilités du moment aux problèmes concernés. Si la terminologie n’est pas unifiée, elle recouvre néanmoins un large éventail commun de critères.
Une telle énumération est évidemment nécessaire pour appréhender juridiquement les discriminations au plan civil mais aussi et peut-être surtout au plan pénal en raison du principe d’interprétation stricte de ces règles.
« Egalité de chances et de traitement »
La notion de discrimination indirecte au sens du droit communautaire nécessite l’identification des groupes comparables composés majoritairement d’hommes et de femmes. Transposée aux étrangers, cette analyse suggère une identification de groupes de personnes à partir des critères évoqués. Une telle identification n’est-elle pas suspecte au même titre que celle qui résulterait d’une catégorisation dans le cadre d’un recensement ?
L’objectif ici est de lutter judiciairement contre les discriminations, et les groupes professionnels concernés sont des groupes contingents, aux contours variables dans le temps. La démarche ne vise pas à produire une représentation globale de ces groupes par référence à ces critères.
La même exigence d’identification des groupes concernés se retrouve en matière d’actions positives, mesures temporaires visant à rétablir en fait l’égalité et qui sont encouragées par les conventions internationales des droits de l’homme.
La conception française de l’égalité fondée sur l’universalité des droits rencontre ici une nouvelle conception du principe d’égalité qui s’énonce « égalité de chances et de traitement ». Ce qui implique une certaine dose de catégorisation même si l’on refuse le communautarisme.
La méthode du « testing »
Si la jurisprudence communautaire offre un outil de lutte contre les discriminations dans le travail et même s’agissant des discriminations structurelles, encore faut-il que les « étrangers » puissent accéder à l’emploi. Or l’on sait que c’est lors de l’embauche que les discriminations les concernant sont les plus fortes.
C’est plutôt du côté du droit comparé qu’apparaissent quelques pistes. On pense à la méthode du « testing » empruntée au Royaume-Uni. C’est encore une pratique sociologique et statistique qui consiste, face à une offre d’emploi, à proposer des candidats répondant tous aux mêmes critères objectifs exigés pour le recrutement. Si les candidats étrangers sont systématiquement exclus, alors il y a apparence de discrimination et l’employeur sera tenu de se justifier.
Reste que l’action judiciaire face à l’ampleur du problème posé ne peut être une voie d’action exclusive. Son caractère exemplaire devrait néanmoins prendre place dans un ensemble d’actions de lutte plus globale contre les discriminations.
L’apport du droit communautaire est d’avoir construit et appliqué, en matière d’égalité entre hommes et femmes, un raisonnement qui objective la notion de discrimination et lui confère un champ d’application élargi aux discriminations indirectes. L’article 13 du traité d’Amsterdam va permettre d’étendre cet acquis conceptuel à d’autres motifs de discrimination et, notamment, à la discrimination à raison de la race. Un projet de directive sur cette question devrait être proposé par la Commission dès la ratification du traité par les quinze États membres.
Reste la question de la connaissance et de l’établissement des faits de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination. La création d’un Observatoire, autorité administrative indépendante de lutte contre les discriminations, dotée de pouvoirs s’inspirant d’instances existant dans d’autres États serait, en France, la garantie d’une plus grande efficacité contre toutes les formes de discrimination.
Le Réseau européen contre le racisme
|
Notes
(1) CJCE, 27 octobre 1993, aff. C-127/92 ENDERBY, Rec.
Notes
[1] Titulaire : Bernadette Hétier, du MRAP, suppléants : Lorenzo Prencipe du CIEMI et Nabil Azouz, de la FTCR).

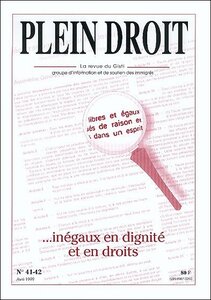
![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)










Partager cette page ?