Article extrait du Plein droit n° 41-42, avril 1999
« ... inégaux en dignité et en droits »
Entendre la parole des victimes
Véronique De Rudder, Christian Poiret et François Vourc’h
Sociologues à l’Unité de Recherche Migrations et Société/C.N.R.S, Universités Paris 7, Paris 8, Nice Sophia-Antipolis.
Depuis quinze ans, un mélange de bonnes paroles et de tactiques politiciennes a laissé un libre espace de déploiement aux discriminations et ségrégations quotidiennes, ouvertes ou voilées. En effet, la crainte de favoriser, fut-ce par « effet pervers », la progression électorale du FN a confiné l’action contre le racisme à la contestation idéologique, à l’appel aux valeurs républicaines et aux calculs politiciens. La mobilisation anti-raciste des années quatre-vingt a été étouffée sous la politisation « noble » et les excitations médiatiques autour des réponses « responsables » qu’il convenait d’apporter au Front National. Les luttes discursives, essentielles mais sans immédiate productivité sociale, ont été privilégiées, tandis que les mouvements de solidarité ont porté sur le droit au séjour des étrangers. Or, s’il est indispensable d’affronter l’idéologie raciste et ses transformations, il urge d’en combattre les modes d’expression directs et indirects et, plus encore, d’en enrayer les effets concrets.
Depuis quelques mois, le gouvernement français semble, à l’instar d’autres pays européens, chercher les voies d’une lutte plus efficace contre les discriminations racistes (liées à la couleur ou à la prétendue appartenance « raciale »), ethnistes (liées à l’« origine » ou à la culture, réelles ou supposées) et xénophobes (liées à la nationalité ou à l’origine nationale)(1). On ne peut que se réjouir de voir enfin reconnus, au plus haut niveau de l’État, l’ampleur et le caractère inadmissible de pratiques largement répandues mais jusqu’ici occultées par le recours systématique à une rhétorique auto-satisfaite sur les vertus de l’intégration républicaine. Il y a là comme une lézarde dans la bonne conscience assimilationniste des pouvoirs publics : oui, les inégalités illégales touchent massivement non seulement des étrangers mais aussi des Français qui ne sont pas vraiment acceptés comme tels ; oui, il y a urgence à engager une véritable politique d’égalisation des chances qui prenne en compte le poids des représentations et des pratiques racistes, tant dans la société civile qu’au sein des institutions ; oui, bien au delà des seuls « immigrés », il s’agit d’un enjeu majeur pour l’égalité et la démocratie, donc pour l’ensemble des habitants, citoyens ou non, de ce pays.
Nécessité d’une politique volontariste
Le dispositif proposé par Martine Aubry le 22 octobre dernier, risque, toutefois, de méconnaître l’ampleur des problèmes et de manquer ses objectifs. L’implication des services publics, essentiellement limitée au rôle des agents de l’ANPE, est très insuffisante. Les mesures concernant le logement ignorent les processus de ségrégation qui produisent les quartiers de relégation. Quant à la création d’un groupe d’étude des discriminations et au rapport confié à Jean-Michel Belorgey sur l’adaptation des dispositifs publics à la lutte contre les discriminations, ils suscitent surtout des interrogations. Ne s’achemine-t-on pas vers un simple effet d’annonce suivi de la création d’un énième « Machin » servant d’alibi à l’inaction ? La portée symbolique de la déclaration de la ministre de la solidarité n’est certes pas à négliger. Mais si un dispositif volontariste de correction des inégalités et de lutte contre les effets pratiques du racisme n’est pas mis en place, ces mesures ne feront qu’aggraver la faillite d’une politique qui se prétend « d’intégration » des immigrés et de leurs enfants, mais qui a pour effet de concourir à leur marginalisation. Car il ne suffit déjà plus de « reconnaître » l’existence des discriminations, même si leur étude est encore nécessaire après une si longue ignorance volontaire. Il faut d’emblée engager l’action.
Il convient, d’abord, de reconnaître que la législation actuelle est inefficiente parce qu’elle est à la fois inappliquée et inadaptée. Deux modifications, à tout le moins, doivent être mises en chantier d’urgence : la charge de la preuve ne doit plus incomber aux seules victimes, lesquelles ne peuvent presque jamais l’apporter ; la définition légale de la discrimination doit inclure les pratiques qui, sans intention de nuire, engendrent des inégalités « raciales » ou ethniques plus ou moins systématiques, voire structurelles.
Mais il faut aussi rompre avec les sempiternelles justifications des inégalités par la fatalité des effets de « la crise » ou par les caractéristiques des victimes elles-mêmes, généralement soupçonnées d’utiliser l’accusation de racisme pour masquer leurs propres insuffisances. Il faut cesser de considérer comme anecdotique le récit des exclusions, des humiliations, des plaisanteries et des multiples formes de harcèlement « racial » quotidien. Il faut, enfin, accepter de prendre au sérieux les témoignages des victimes, aujourd’hui systématiquement suspectées de mensonge, d’exagération ou de paranoïa.
Des effets sociaux catastrophiques
On sous-estime les effets sociaux catastrophiques que la tolérance résignée à l’égard des discriminations ethnistes et racistes provoque chez leurs victimes, souvent nées ou élevées dans un pays dont elles épousent les idéaux proclamés. Il a fallu tout l’attrait moral du « modèle » républicain égalitaire, et sa puissance d’intimidation, pour que n’éclate pas jusqu’ici plus violemment le rejet d’un ordre social raciste de fait. Renvoyées à leur sort individuel, ces victimes ressentent leur oppression comme une contradiction intolérable ou elles l’intériorisent comme un destin. Ceci tend à les conduire soit au renoncement et au repli, que l’on a beau jeu de condamner aussitôt comme « communautaire », soit aux comportements de révolte ou de rupture (violences « urbaines », délinquance, voire terrorisme) traités par l’appel à la répression.
De même, il faut mesurer l’étendue du malaise qui saisit aujourd’hui nombre d’agents des services publics (enseignants, éducateurs, formateurs, agents de l’ANPE. ou des missions-emploi…). Ils se trouvent démunis de moyens pour combattre les discriminations qui sapent leur action quotidienne et frappent de jeunes Français que rien – sauf la couleur ou l’origine réelle ou supposée – ne distingue de leurs congénères avec lesquels ils vivent et qui, eux-mêmes, sont déjà pour partie privés de formation, d’emploi, de sécurité, d’avenir, de dignité… (ce qu’on appelle confusément l’« exclusion »).
Enfin, est méconnue la dégradation des relations professionnelles qu’induisent les comportements racistes dans les administrations et les entreprises. Bien des agents des services publics et des militants syndicaux se retrouvent isolés lorsqu’ils veulent protester contre des comportements discriminatoires. Ceux qui en appellent au droit et à l’ethos républicain endurent railleries et marginalisation au sein de leur collectif de travail et parfois jusqu’à l’intérieur de leur section syndicale. Cette pression s’apparente, toutes proportions gardées, à celle subie par les victimes directes du racisme, qu’elles soient leurs collègues, leurs clients ou leurs interlocuteurs. Eux aussi sont confrontés à la dépréciation personnelle et au doute sur leurs propres capacités.
Des enquêtes menées en France et des comparaisons européennes sur la lutte contre les discriminations, il ressort que seule une autorité officielle, pluraliste et indépendante, pourrait répondre aux exigences d’une nécessaire « action positive » en faveur de l’égalité des chances. Quatre missions essentielles, complémentaires et articulées entre elles, pourraient définir le champ d’intervention d’un tel organisme.
L’une de ces fonctions, qui semble presque acquise, concerne l’étude et l’analyse des discriminations. Il s’agirait de rassembler les connaissances et de susciter des recherches : pour inventorier les modalités et évaluer l’ampleur et les effets des discriminations directes ; pour analyser les effets des discriminations indirectes qui résultent de comportements non-intentionnels ; pour traiter des formes de racisme dites « institutionnelles » (inscrites dans la routine des administrations ou des institutions) ou « systémiques » (héritées du passé, notamment colonial, et transmises de génération en génération).
Rendre les inégalités visibles et illégitimes
Une deuxième mission consisterait à recueillir les témoignages des victimes, jusqu’ici disqualifiés, et des témoins, jusqu’ici abandonnés à leur impuissance. Cette fonction de recueil et d’écoute est essentielle. C’est elle qui manifesterait clairement la reconnaissance de l’injustice et participerait à l’illégitimation sociale des comportements discriminatoires. Il faut donc envisager la création d’un réseau de « bureaux des plaintes », comme il en existe dans différentes villes de Belgique, et d’un « téléphone vert ». Quel que soit son coût, un tel dispositif conditionne la crédibilité d’une politique de lutte contre les discriminations, tout comme les dispositifs du type « SOS femmes battues » ou « enfance en danger » manifestèrent clairement la volonté politique de lutter contre les violences domestiques. Mais la collecte de ces expériences est aussi essentielle pour l’étude du racisme, étude qui a entièrement négligé, jusqu’alors, ce pan de la réalité du rapport social raciste.
Le recueil des témoignages implique un relais juridique. Les victimes et leurs défenseurs devraient pouvoir recevoir le conseil et l’assistance qu’ils vont chercher auprès des associations anti-racistes et de solidarité qui croulent sous la demande, alors qu’il s’agit d’une mission de service public. Mais cet organisme devrait aussi pouvoir saisir directement la justice, voire se porter partie civile, seul ou aux côtés des victimes, associations, syndicats… Cette fonction juridique enrichirait la réflexion, nécessaire et reconnue comme urgente par le gouvernement français lui-même, sur le problème de la preuve et, au besoin, conduirait à des propositions de modifications législatives.
Enfin, cet organisme devrait être directement engagé dans la formation et l’éducation. Il ne suffit pas de former les agents des services de l’emploi ou les syndicalistes, il faut aussi agir en direction des bailleurs, des magistrats, de la police et des agents de tous les services publics, des entreprises (patrons, maîtrise et encadrement…). Parallèlement, il serait nécessaire d’introduire à l’école, une véritable éducation anti-raciste qui ne s’arrête pas aux dénonciations du passé ou aux grands principes idéologiques. L’élaboration d’un tel programme pourrait revenir à cet organisme.
L’expérience des luttes contre les discriminations faites aux femmes a montré la nécessité d’une conjonction de moyens pour rendre visibles et illégitimes des inégalités qui paraissaient naturelles : luttes sociales, travaux de recherches, intervention et mobilisation des pouvoirs publics… Aujourd’hui, en matière de racisme, l’essentiel reste à faire.
Notes
(1) Confère, par exemple, la circulaire adressée en juillet 1998 par la garde des sceaux aux procureurs, reconnaissant que « la traduction judiciaire [des infractions inspirées par le racisme] reste très en-deçà de la réalité », notamment du fait du « faible nombre de plaintes enregistrées par la police ou la gendarmerie et transmises au Parquet ». Madame Guigou y soulignait que cet état de fait « ne permet pas à notre dispositif juridique d’apporter les résultats escomptés ».

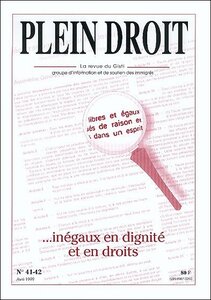
![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)










Partager cette page ?