Article extrait du Plein droit n° 76, mars 2008
« Hortefeux, acte 1 »
Talbot-Poissy, du « printemps syndical » à l’affrontement racial (1982–1984)
Daniel Richter
Ancien secrétaire du syndicat CFDT de la métallurgie des Vallées de la Seine et de l’Oise.
Avec la crise américaine, Chrysler se sépare de ses filiales européennes. Peugeot, après avoir repris avec succès Citroën, rachète Simca qui va devenir Talbot en 1978. Les ventes de Talbot se tassent. La décision est alors prise de fusionner les réseaux commerciaux Peugeot et Talbot. Cette opération de rationalisation voulue par Peugeot va avoir de lourdes conséquences.
La gauche est aux commandes depuis 1981. Mais les divergences au sein de l’exécutif, tant parmi les socialistes eux-mêmes qu’entre communistes et socialistes, rendent vaine toute prise de décision en amont. Aussi, tacitement, est-il admis en haut lieu qu’il vaut mieux s’en tenir au règlement des crises au coup par coup. Cependant, depuis 1981, les grèves, très majoritairement portées par les OS immigrés, se succèdent dans le secteur. Renault (Sandouville, Billancourt, Flins), Peugeot (Sochaux), Maubeuge Carrosserie Automobile, Citroën (Aulnay, Levallois, Saint-Ouen), Talbot (Poissy), Chausson (Gennevilliers, Asnières) et Fiat-Unic (Trappes) sont touchés par des épreuves de force souvent longues, dures et victorieuses [1].
Déjà certaines questions commencent à émerger dans les médias et l’opinion publique : « Comment se fait-il que les travailleurs immigrés de l’automobile bougent alors que leurs camarades français restent passifs ? », « Le blocage de chaînes ne révèle-t-il pas un aspect spécifique d’une violence portée par les immigrés ? » Des inquiétudes sont montées en épingle ; le numéro de Paris Match du 10 septembre 1982 ne titre-t-il pas « L’automobile française en danger de mort » ?
Plus grave peut-être, Gaston Deferre, ministre de l’intérieur, répondant à une question sur les grèves de Renault-Flins, lance sur Europe 1, le 26 janvier 1983 : « Il s’agit d’intégristes chiites ». Le lendemain, Pierre Mauroy déclare au journal Nord-Éclair : « Les principales difficultés qui demeurent sont posées par des travailleurs immigrés dont je ne méconnais pas les problèmes mais qui, il me faut bien le constater, sont agités par des groupes religieux et politiques qui se déterminent en fonction de critères ayant peu à voir avec les réalités sociales françaises. » Jean Auroux, alors ministre des affaires sociales, martèle : « Il y a à l’évidence une donnée religieuse et intégriste dans les conflits que nous avons rencontrés » [2] (L’Alsace, 10 février 1983).
Chape de plomb
Le « système Simca » mis en place depuis les années soixante, s’appuyant d’un côté sur un comité d’établissement très bien doté pour jouer sur le clientélisme, d’un autre côté sur le suivi des salariés dès leur pré-embauche, permet d’exercer un contrôle sur l’ensemble du personnel et notamment sur les ouvriers de production immigrés. Les multiples permanents de la Confédération française du travail (CFT) devenue ensuite la Confédération des syndicats libres (CSL), aux pratiques réputées musclées, sont garants de la chape de plomb qui pèse sur les ouvriers.
Néanmoins, depuis la reprise par Peugeot, le système CSL-Direction se fissure progressivement, du fait notamment des réductions d’effectifs imposées par la direction (il y avait 27 000 salariés en 1977, il n’y en a plus que 16 800 en mars 1983 dont 7 328 immigrés, Marocains à 60 %). S’y ajoutent des augmentations salariales très faibles, des jours chômés (pour mévente des voitures fabriquées) alors faiblement rémunérés et l’alignement sur le statut de la nouvelle maison-mère, nettement moins avantageux. Aux élections prud’homales de décembre 1979 qui se déroulent dans des bureaux de vote extérieurs à l’usine, la CSL perd la moitié de son influence (passant de 80 % à 40 % environ). Aux élections de mai 1980, surveillées par des observateurs et des huissiers nommés par la Cour de cassation, elle reste majoritaire, mais de justesse.
La grève de Talbot-Poissy, en juin 1982, sur une plate-forme revendicative qui comprend 400 francs d’augmentation mensuelle de salaire pour tous, l’établissement des libertés individuelles et syndicales, la cinquième semaine de congés au libre choix, l’augmentation des temps de pause, l’affichage des cadences et des effectifs…, débute avec des heurts violents, mais ce sont les membres de la CSL qui doivent plier bagage. Le conflit dure cinq semaines, il fait sauter les carcans. En quelques jours, la CGT intègre 4 000 nouveaux adhérents, la CFDT un millier. Les ouvriers de production ont basculé. Deux cent vingt délégués de chaîne [3] CGT sont désignés, une soixantaine pour la CFDT. Cependant ni la direction, ni la CSL ne renoncent à reprendre l’avantage. Dès le retour des vacances fin août 1982, Talbot veut licencier huit ouvriers, la plupart délégués de chaîne. Il s’ensuit une grève illimitée. Dès le lendemain, les licenciements sont transformés en mise à pied. La CSL contre-attaque en appelant l’encadrement à la grève. Un comité des « Talbot qui veulent travailler » est mis sur pied. Le directeur central fustige « les délégués de chaîne, cette invention diabolique ». L’apparition des jours chômés, par les craintes qu’ils entraînent sur l’avenir du site et l’inutilité des grèves qui arrangent, dans ces moments-là, l’employeur, va diminuer la conflictualité ouverte. Par dignité et fierté de travailler sans les chefs, les ouvriers viennent cependant à l’usine deux jours chômés à l’appel de la CGT et de la CFDT.
En juillet 1983, un plan de réduction d’effectifs est présenté par PSA : 3 081 préretraites FNE (Fonds national de l’emploi) chez Peugeot, 1 225 préretraites chez Talbot et 2 905 licenciements économiques à Poissy. Les premières manifestations sont organisées dans les semaines qui suivent. Fin novembre, la CFDT-Talbot, reçue à sa demande par le directeur départemental du travail, apprend que les licenciements, refusés dans un premier temps, sont finalement acceptés. La CGT et la CFDT, chacune de leur côté, appellent à la grève pour le 8 décembre. Dès le 7 au soir, tous les engins de manutention sont rassemblés au cœur du bâtiment d’assemblage B3 ; l’usine est paralysée.
Du 8 au 16 décembre, le B3 est occupé jour et nuit, y compris le week-end. Mais la direction étend le chômage partiel, puis annonce qu’elle suspend le paiement des salaires à partir du 19 décembre, invite le personnel à rester chez lui et supprime les cars de transport des travailleurs. Le gouvernement accepte 1 905 licenciements (80 % sont des immigrés et, parmi les Français, la majorité est originaire des territoires d’outre-mer). La CFDT-Talbot décide de continuer la grève jusqu’à leur annulation.
L’épreuve de force se poursuit, la CFDT tenant ses positions quand la CGT serait prête au compromis et que le gouvernement offre sa médiation sur l’accompagnement social. Les premières lettres de licenciements tombent. Elles seront symboliquement brûlées, le 22, devant le siège de PSA, avenue de la Grande Armée à Paris. La direction annonce qu’elle souhaite remettre l’usine en état pour une réouverture en janvier ; les militants CFDT refusent l’entrée du B3 aux équipes d’entretien. Le 31 décembre, à minuit, les forces de l’ordre évacuent les 100 occupants de l’usine. Des procédures judiciaires sont intentées contre plusieurs militants CFDT pour « atteinte à la liberté du travail, incitations à la violence et voies de fait ».
Le 2 janvier 1984, l’usine est officiellement fermée. Cinq mille personnes sont convoquées pour préparer l’ouverture. La grève reprend dès le lendemain malgré les appels au compromis de la CGT. Les engins de manutention sont à nouveau regroupés dans le B3, mais le soir, après que la grande majorité des grévistes soient partis des ateliers au cours de la journée, il ne reste que 200 occupants. La CFDT décide de quitter l’usine pour la nuit et de reprendre le conflit le lendemain. Les affrontements se multiplient devant les médias. Le 5 janvier, des membres de la CSL de Poissy et d’autres usines du groupe Peugeot, secondés par le Parti des forces nationales, organisation d’extrême-droite, décident de « libérer » l’usine. Les 2 000 occupants se barricadent dans le B3. Pour éviter une bataille rangée particulièrement dangereuse, la CFDT demande au préfet d’intervenir. Les forces de l’ordre prennent position dans l’usine pendant que les propos racistes fusent. Aux manifestations « pour la liberté de travailler », soutenues par la CSL, répondent les marches des licenciés, dont celle du 14 janvier organisée par plusieurs collectifs de la « marche pour l’Égalité » [4] et les militants immigrés dissidents de la CGT-Talbot.
Tout le monde a pu noter le coup de colère des OS immigrés qui savent que seule la production est visée par les licenciements à Talbot-Poissy. Au départ, la réaction est largement majoritaire, même si, à l’extérieur, les ouvriers interrogés préfèrent dire qu’ils soutiennent la grève plutôt que d’affirmer qu’ils en sont directement acteurs. Le matin, aux meetings, l’effet de groupe soudé joue à plein, y compris à des moments où l’on pourrait attendre un affaiblissement significatif en raison par exemple des divergences syndicales. Cependant dès le départ, l’organisation de l’occupation n’est pas simple. Dès que les lettres de licenciement nominatives tombent, les ferments de division commencent à s’installer. Les ouvriers licenciés et le noyau le plus convaincu des grévistes n’acceptent plus que d’autres OS immigrés viennent à l’usine et se mettent en tenue de travail. Ils sont soupçonnés d’attendre que le vent tourne pour rejoindre leur poste. Il s’ensuit des incidents dans les vestiaires et les ateliers.
Sur le registre de la division, les délégués immigrés de la CSL ne restent pas inactifs. Plus le conflit dure, plus ils fréquentent les foyers et les lieux d’habitation pour dénoncer « les fanatiques qui se rangent derrière la bannière d’extrémistes », avec parfois une certaine efficacité. Lorsque la CFDT, dans les premiers jours de la grève, propose de manifester hors de l’usine pour gagner en visibilité auprès de l’opinion publique, la majorité des OS immigrés est réticente ; ils ne veulent pas donner l’impression qu’il n’y a qu’eux dans la lutte et se voir transformer en « boucs émissaires ». La réaction aux revendications n’est pas forcément simple. La plus populaire est « zéro licenciement ». La réduction du temps de travail à trente-cinq heures n’a, elle, jamais été prioritaire pour les travailleurs immigrés. Ils préfèrent des congés annuels plus longs pour pouvoir retourner au pays.
Ignominie
Tous celles et ceux qui ont suivi le conflit Talbot à la télévision ou à la radio gardent en mémoire les vociférations haineuses et racistes qui émanaient le 5 janvier 1984 des commandos CSL. Les slogans tels que « les Arabes au four, les Noirs à la Seine » franchissent une étape dans l’ignominie. Certes la réprobation de tels propos est forte, mais, dans le feu du récit des violences, elle ne s’est pas généralisée alors qu’un seuil vient d’être franchi dans le rejet des immigrés. Un tract du Parti des forces nationales est significatif à cet égard : « (…) Nous avons aidé les militants de la CSL de Poissy et de tout le groupe Peugeot (…) à entreprendre une vaste opération de nettoyage à l’usine de Poissy (…) Les arabes et les noirs encadrés par la CFDT entravaient la liberté du travail (…) Après avoir épuré Talbot, nous allons épurer Poissy des fainéants, des émigrés et des casseurs. »
Les images télévisées relatives aux affrontements du 4 janvier provoquent un choc parmi les ouvriers grévistes de Talbot. Pour eux, les immigrés ont été présentés comme lanceurs de boulons tandis que leurs opposants CSL n’apparaissent que très peu. Tout aussi orientée est la façon dont est établi le bilan des violences durant le conflit : « 121 blessés (57 immigrés, 64 Français) dont 6 hospitalisés » comme s’il s’agissait d’un match entre les uns et les autres alors qu’il y a aussi bien des délégués CSL immigrés, des syndicalistes français CFDT, voire CGT, des ouvriers grévistes français parmi les blessés. Étonnant également l’affichage par l’antenne reclassement ANPE à Poissy, spécialement mise en place pour les licenciés, d’offres d’emplois ainsi libellées : « tourneur-outilleur P2-P3, nationalité française exigée » ou bien « fraiseur P2-P3, mécanique de précision, quotas étrangers atteints » (Le Matin du 18 janvier 1984).
Par effet de miroir face au déroulement d’un conflit à l’issue bien vaine, surgit la revendication du retour au pays dans de bonnes conditions avec tous ses droits. La presse bondit sur le sujet, notamment Libération (21/12/83) qui croit pouvoir affirmer : « Le retour au pays pour la première fois dans l’histoire centenaire de l’immigration française apparaît comme une volonté individuelle indépendante de toute politique d’incitation du gouvernement. » Les titres accrocheurs se succèdent : « On veut nos droits, retourner au pays et je te le jure le plus rapidement possible » (Libération 19/12/83), « Talbot, prends vingt briques et tire-toi » (Les Nouvelles 11-18/01/84).
Surtout, la revendication est portée par des militants immigrés dissidents de la CGT déçus de l’attitude de leur organisation. Ils n’hésitent pas à apparaître comme tels et accordent des entretiens recherchés par les médias. L’ATMF (association des travailleurs marocains en France) prend le contre-pied : « L’aide au retour n’est pas une revendication des travailleurs de Talbot. Elle a été formulée comme une colère, comme un dégoût vis-à-vis de la direction PSA… »
Les organisations syndicales sont embarrassées par la revendication du retour. La CFDT-Talbot l’intègre à sa plate-forme mais réduite au strict volontariat et avec possibilité de substitution si ce sont des salariés non licenciés qui choisissent cette option. La CGT considère tout juste « légitime le droit au retour dans les meilleures conditions. »
Un tournant
La violence des propos racistes à l’occasion du conflit Talbot produit un rapprochement a priori inattendu entre les dissidents de la CGT et une partie des associations qui ont porté la marche pour l’Égalité. « Il n’y a plus d’un côté les bons Beurs et de l’autre côté les Arabes, nous sommes tous des bougnoules ». Dès le 29 décembre 1983, la CGT s’inquiète : « De différents côtés, il est question d’initiatives diverses qui engagent les travailleurs immigrés à se battre seuls, voire à s’organiser exclusivement entre eux pour leurs droits et leurs revendications. En toute franchise, la CGT estime devoir vous mettre en garde contre de telles initiatives ».
Chez Renault, Talbot, Citroën, les dispositifs évoluent pour éviter les drames et les chocs frontaux, mais ils ne changent rien à la baisse drastique des effectifs et à la difficulté de retrouver un travail, tout particulièrement pour les immigrés. Un an après le conflit Talbot, en décembre 1984, les commissions de suivi dressent un bilan : cinquante personnes seulement ont trouvé un emploi par l’entremise de l’ANPE malgré la priorité à l’embauche décrétée pour les Talbot. Le paysage syndical de Talbot-Poissy a été profondément modifié par le conflit. L’exacerbation de la haine et de la violence raciste va convaincre une partie de la direction de Peugeot que la CSL peut, à terme, porter préjudice à l’image du groupe. Petit à petit, en s’appuyant sur les dissidents immigrés de la CGT qui l’ont rejointe, Force Ouvrière va accroître son influence, jusqu’à ce que, bien plus tard, une majorité des ex-CSL rejoigne ses rangs.
J’ai assumé avec d’autres militants CFDT le caractère porté au paroxysme du conflit Talbot. Nous avons pris une telle responsabilité parce que la réduction du temps de travail à trente-cinq heures nous apparaissait comme un combat essentiel face aux restructurations, aux dégâts humains de la productivité et aux licenciements. En ce sens, il peut nous être reproché d’avoir instrumentalisé la colère des ouvriers immigrés, mais celle-ci n’avait pas besoin de nous pour s’exprimer. Il valait mieux l’existence d’un cadre à la révolte plutôt que l’expression du seul désespoir. Le conflit Talbot a servi de révélateur des tensions et des contradictions sociales. L’acceptation par la CGT-Talbot du compromis entre le gouvernement et PSA était irrecevable par les ouvriers de production du fait de ses propres positions antérieures. Les objectifs de la CFDT-Talbot étaient inatteignables d’autant que des obstacles à l’élargissement de la mobilisation étaient dressés : isolement d’une marque considérée comme le « canard boiteux », divergences syndicales, divisions entre Français et immigrés selon les catégories professionnelles, attentisme induit par le chômage partiel dans les autres usines ou manque de solidarité entre travailleurs immigrés eux-mêmes. Pour parler brutalement, tout était réuni pour foncer droit dans le mur.
Incontestablement, le conflit Talbot, de par son déroulement et sa conclusion, constitue un tournant. Non seulement il casse net les grandes révoltes ouvrières immigrées de l’après-68 dans l’automobile, mais peut-être encore plus grave, il renvoie l’immigration à sa ghettoïsation croissante dans la société française et, puisqu’il y a rejet, ce sont les valeurs identitaires entre soi qui permettront de tenir le coup dans les quartiers de ces villes-dortoirs des Yvelines qui ont accueilli tant de travailleurs immigrés de Renault-Billancourt, Renault-Flins et Talbot-Poissy. Ce repli n’a cependant nullement affecté, lors de conflits ultérieurs significatifs dans l’automobile, l’unité entre ouvriers français et immigrés, entre anciens et jeunes issus de la deuxième génération qu’ils soient français ou qu’ils aient gardé la nationalité de leurs parents. Il en a été ainsi chez PSA à Sochaux en 1989 et à Aulnay en 2007, chez Renault à Flins en 1995 et 1999. De même à Poissy, depuis plus d’un an, des habitants de toutes origines se rassemblent pour tenter de s’opposer à la démolition de leur quartier.
Notes
[1] Daniel Richter, Fabienne Lauret, « Dix-huit mois de conflits à la chaîne » (été 1983), Travail, numéro spécial.
[2] L’Alsace, 10 février 1983.
[3] Les délégués de chaîne constituent une structure informelle de représentation des ouvriers destinée à renforcer le nombre de délégués du personnel, bien moins nombreux, prévus par la loi et à contrebalancer les « permanents » de la CSL.
[4] Pour une analyse de cette marche, sa signification, son déroulement, voir Plein droit n° 55, décembre 2002.

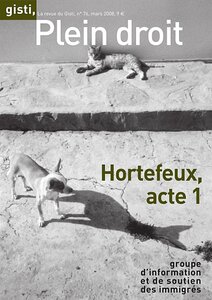
![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)










Partager cette page ?