Article extrait du Plein droit n° 22-23, octobre 1993
« De legibus xenophobis »
L’écume constitutionnelle
Jean-Michel Belorgey
C’est peut-être dans le domaine de l’éloignement que l’obstination du gouvernement s’est manifestée avec le plus de vigueur. Son attachement à édicter certaines règles condamnées par le Conseil constitutionnel a fini par l’emporter.
C’est ainsi que, empêché de prononcer une interdiction du territoire automatique d’un an dans tous les cas de reconduite à la frontière, le législateur prévoit que, désormais, la reconduite à la frontière pourra, dans un certain nombre d’hypothèses assez largement comprises, être assortie d’une interdiction du territoire d’une durée maximale d’un an.
De même, puisque le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article 31 de la loi, le législateur introduit la possibilité d’un tel recours en raccourcissant de surcroît la durée du sursis susceptible d’être décidé par le procureur ; mais l’essentiel du dispositif est maintenu.
De même encore, puisque c’est l’absence de définition des cas de figure dans lesquels la prolongation de trois jours de la rétention pourrait être décidée à l’encontre de l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, qui a entraîné la censure du Conseil constitutionnel, on énonce plus précisément les hypothèses dans lesquelles la prolongation envisagée peut prendre place ; tout en maintenant, bien sûr, la possibilité d’une telle prolongation.
Le Conseil constitutionnel, enfin, ayant estimé que la procédure de rétention judiciaire instaurée à l’égard des étrangers reconnus coupables du délit de non-présentation des documents de voyage ou de non-communication des renseignements permettant l’exécution d’une mesure d’éloignement ne pouvait être assortie de garanties moindres que celles accordées aux personnes placées en détention provisoire, on ne renonce pas pour autant au mécanisme envisagé, mais on met en place tout un ensemble de dispositions permettant aux personnes concernées de demander la levée de la mesure, en assignant aux juridictions des délais pour statuer.
Sans doute l’avis rendu par le Conseil d’État sur les conséquences à tirer de la décision du Conseil constitutionnel en ce qui concerne le droit d’asile exclut-il une réponse simplement législative aux objections soulevées par cette autorité ; du moins met-il en évidence les risques qui s’attacheraient à se contenter d’une telle réponse, tant sur le plan diplomatique que sur le plan constitutionnel, à moins que les autorités compétentes ne se résignent à n’être pas délivrées, en toute circonstance, de l’obligation d’examiner les demandes d’asile relevant, en vertu de la Convention de Schengen, de la responsabilité d’un autre État, mais figurant au nombre de celles entrant dans les prévisions du 4ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
« Est-on bien sûr que l’étranger soit un homme ? »
La perspective d’une réforme constitutionnelle qui se bornerait, sans porter atteinte aux principes du 4ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, à donner compétence, pour statuer sur des demandes d’asile, à des États avec lesquels la France a conclu des conventions et qui respectent en matière d’asile des engagements identiques aux siens, n’a pas été de nature, on le sait, à faire reculer le gouvernement.
Mais l’effort du Conseil constitutionnel restera surtout sans lendemain parce que le registre dans lequel se situent ses objections à l’encontre des choix législatifs opérés au printemps portent l’empreinte d’une tradition juridique qui répugne à faire de l’étranger un sujet de droit à part entière. « Est-on bien sûr que l’étranger soit un homme ? » interrogeait récemment Raymond Coulon [1] commentant la décision du Conseil constitutionnel du 9 janvier 1980 à propos de la loi Bonnet. Cette décision validait le principe de la double peine, au motif que l’expulsion d’un étranger n’a pas le caractère d’une sanction mais d’une mesure de police : de sorte que la présomption d’innocence n’empêche par qu’un arrêté d’expulsion soit fondé sur des faits de nature à justifier une condamnation pénale alors même qu’aucune condamnation définitive n’aurait été prononcée par l’autorité judiciaire, pas plus que le principe de non-rétroactivité applicable à la seule loi pénale n’empêche le prononcé d’une expulsion à l’encontre d’étrangers à raison de faits et de condamnations pénales antérieures à la loi en instaurant la possibilité.
Si le coup d’arrêt donné par la décision du 13 août dernier à une partie des excès de la loi Pasqua n’est pas négligeable - il concerne essentiellement, outre les dispositions déjà évoquées, l’exclusion de la possibilité de regroupement familial pour les étudiants étrangers et les étrangers remariés depuis moins de deux ans -, il se situe de fait très en deçà de ce qu’en attendaient, sinon les familiers de la jurisprudence du Conseil, du moins les défenseurs d’une conception élargie des droits de l’homme, et cela sur plusieurs terrains, notamment le certificat d’hébergement délivré par les mairies, les libertés individuelles, les droits sociaux et, bien sûr, le droit d’asile.
Plus qu’en tout autre domaine, le mode de raisonnement retenu par le Conseil constitutionnel en ce qui concerne le droit d’asile laisse sur leur faim ceux des défenseurs des libertés qui, plutôt qu’une satisfaction symbolique, attendaient une réaffirmation de la portée des engagements internationaux souscrits par la France en ce domaine, et de leur validité. À la vérité, ce mode de raisonnement porte à lui seul des conséquences, et des conséquences négatives, d’une telle gravité qu’on peut s’étonner qu’il n’ait pas suscité des protestations plus véhémentes, et qu’il ait même réussi à emporter, de la part de quelques juristes, une adhésion aussi fervente.
Comment ne pas s’inquiéter, en effet, de la réduction drastique infligée, par le jeu de cette décision et pour une bonne part implicitement, à la notion de droit d’asile ? Est-il si évident qu’entre « l’homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté » du 4ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et « l’homme craignant, avec raison, d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques » - ce qui constitue les termes de la Convention de Genève de 1951 ratifiée par la France en 1954 - il y ait une différence ? Que le constituant ait entendu en établir une ou qu’on puisse le faire sans priver de toute portée les engagements souscrits à Genève, comme toutes sortes de prises de position gouvernementales y tendent depuis près d’une décennie ? N’a-t-on, en 1946, entendu viser que les Garibaldi, Mazaryk, Soljenitsyne, passés ou à venir, mais dont le nom n’est souvent connu qu’a posteriori, quand ils ont survécu aux persécutions dont ils étaient l’objet, et entendait-on, ce faisant, détourner les yeux de l’expérience récente du génocide, de celle des résistants allemands à l’hitlérisme, de celle des Français libres ? Ou bien entendait-on manifester que ce sont ces expériences-là qu’on avait en tête ?
Une subtile combinaison de dispositions restrictives
Plus profondément encore, les lois Pasqua ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Il faut, pour ne pas s’en aviser, n’avoir dans son entourage aucun étranger ou étrangère, même pas du personnel de maison - ce qui est rare, en particulier dans la bonne société - ou faire preuve, à l’égard des problèmes littéralement vitaux que l’aggravation récente des pratiques administratives pose à ceux-ci, d’une splendide indifférence.
Que constate-t-on en effet aujourd’hui par le jeu de la combinaison systématique des dispositions restrictives anciennes ou récentes ? Toutes les catégories d’étrangers placés dans des situations qui s’y prêtent se trouvent progressivement - au fur et à mesure qu’on les débusque - exposées d’abord à un refus de renouvellement de leur titre de séjour, ensuite à une mesure d’éloignement du territoire.
Sont dans ce cas des hommes et des femmes ayant réussi à se maintenir, souvent pendant de très nombreuses années, sur le territoire au bénéfice des dispositions reconnaissant ce droit aux parents d’enfants français, sous condition qu’ils exercent sur eux l’autorité parentale et pourvoient à leurs besoins, mais qui, parce que leurs enfants sont devenus majeurs, ne remplissent plus cette dernière condition.
Sont aussi dans ce cas des adolescents ayant normalement vocation au regroupement familial mais qui, victimes de la dissuasion clandestine de règle en ce domaine, se sont, de guerre lasse, introduits en France hors de ce cadre. Ces derniers bénéficiaient, antérieurement, quand ils songeaient à saisir la juridiction administrative, de la jurisprudence de celle-ci relative au droit de vivre en famille ; encore fallait-il qu’ils prennent l’initiative de plaider et que l’autorité compétente consente à tirer les conséquences de droit des jugements qui avaient été prononcés, jugements au fond ou jugements de sursis à exécution - ce qui n’allait pas de soi, eu égard au vide juridique existant de longue date dans les systèmes légaux et réglementaires ou conventionnels applicables.
Nul doute qu’en proscrivant toute régularisation, les nouvelles lois n’aient entendu avoir raison de cette jurisprudence indûment bienveillante aux yeux de l’administration.
Parodie de justice à la Commission de recours
Dès avant le vote des nouveaux textes et dans le même esprit, les enfants d’origine étrangère auxquels la loi ouvrait cette possibilité se sont vu systématiquement refuser d’accéder à la nationalité française sur demande de leurs parents : l’autorité compétente, soucieuse de ne pas reconnaître un droit au séjour aux parents des intéressés, n’entendait pas, en effet, en donnant satisfaction aux requêtes dont elle était saisie, se mettre dans le cas d’avoir ultérieurement à leur reconnaître ce droit.
Mais qu’adviendra-t-il, dès lors, de ces Français en puissance qui ne pourront le devenir pour de bon qu’à condition de résider encore à leur majorité sur le territoire national, et à qui il sera bien difficile de satisfaire à cette condition si on éloigne autoritairement leurs parents ?
Plus grave encore. Si considérablement amputé que se révèle, au terme de quelques campagnes législatives et diplomatiques, le champ du droit d’asile, il est en général systématiquement fait état, en vue de rassurer les bonnes âmes, du caractère incontestable des garanties que constituent l’intervention de l’Ofpra, et plus encore celle de la Commission de recours des réfugiés. Or, les imperfections de l’Ofpra sont connues ; celles de la Commission de recours le sont moins, mais elles sont nombreuses. D’où vient-il qu’on n’ose pas articuler que cette instance a, de longue date, cessé de fonctionner comme une juridiction digne de ce nom, et que les règles les plus élémentaires de la procédure contradictoire y sont fréquemment violées ; que certaines de ses formations sont connues pour ne jamais donner satisfaction à un requérant ; que, jusque dans le style de l’énoncé des verdicts, se lit l’obsession d’un « containment », le mépris du requérant ou des témoignages qu’il fournit.
Quelques affaires récentes, dont la presse s’est fait l’écho mais avec une précision insuffisante, concernant des islamistes algériens ayant fait l’objet de condamnations à mort, ou de mauvais traitements et de tortures - les premières publiées dans les journaux, les seconds précisément relatés par des organisations non gouvernementales dont les rapports ont, à cet égard autorité, sauf auprès de la Commission des recours - sont emblématiques.
On peut pardonner aux pouvoirs de manquer de générosité, aux juristes de faire une trop large place aux mots et aux mythes dans la construction des systèmes logiques sur lesquels ils fondent leurs décisions, de s’abandonner à leur subjectivité, ou de succomber à la pesée de l’opinion dominante ; on ne peut pardonner aux juges de continuer à revendiquer la sérénité juridictionnelle quand ils l’ont abjurée ; et quand ils ont choisi d’apporter leur pierre, qui n’est juridique qu’en apparence, à la disqualification, par l’exécutif et les médias, d’une catégorie humainement estimable, et des individus qui la composent. Mieux vaudrait peut-être, à ce compte, la brutalité nue que la parodie. Qui sait si elle ne déclencherait pas un sursaut des consciences ?
Du large consensus apparemment suscité par les lois Pasqua, il faut cependant constater que, s’il procède pour partie de l’euphémisation des stratégies et des procédés qu’elles consacrent, de la caution apportée à cette euphémisation par toutes sortes de rites juridiques, saisine et verdict du Conseil constitutionnel compris, il n’est pas seulement marqué au coin de la naïveté. Et que, si ce dont il est question, sous les mots, échappe à une partie du public, une autre y adhère largement, les mots ne la trompant pas, mais l’aidant, en cachant les choses, c’est-à-dire en l’espèce les hommes, à consentir un ralliement qui lui apparaîtrait, n’était le précieux secours de la religion juridique, plus difficile.
Légaliser la démesure
« Légiférer pour mieux tuer des droits », s’inquiétait le Gisti. « Légaliser la démesure » suggérerais-je moi-même. C’est bien cela qui est en cause. Légitimer par le droit - et cela à un double niveau : le martèlement législatif, les timides remontrances du gardien de la constitutionnalité validant en quelque sorte ce qu’il n’invalide pas - un régime éthiquement contestable, aussi longtemps au moins qu’on n’a pas débattu de son bien fondé - selon d’autres critères que ceux mis en avant et par le débat politique et par le débat juridique. Et si bien le légitimer que quiconque se désolidarisera des choix opérés en viendra à être soupçonné de manque de loyalisme civique.
Comment rendre compte, si ce n’est pas cela qui est en cause, du climat de cet étrange après-midi du mois d’octobre consacré, dans le cadre d’un colloque sur « L’état de droit au quotidien » organisé par l’association des membres et anciens membres du Conseil d’État et l’association du corps préfectoral au « cas du droit des étrangers » ? On n’a pas, ou presque pas, au cours de cet après-midi, entendu percer chez les juristes cette singularité qu’on était en droit d’attendre de leur part face aux hommes de réglementation et de police. On n’a, malgré la suavité convenue du ton de la plupart des intervenants, pas senti des hommes, des hommes porteurs d’affectivités, d’expériences et de projets, sujets à des déceptions et à des souffrances, se profiler derrière l’évocation des contentieux de masse appelant des solutions « non classiques » des circuits courts, des jugements sans instruction, des juges uniques, des rejets rapides.
Aussi bien, de toutes les déclarations, la moins vaine a-t-elle peut-être été celle, calculée ou non, d’un responsable administratif se demandant s’il fallait traiter de l’immigration à partir de considérations juridiques. Propos à première vue surprenant au lendemain d’aussi splendides campagnes sur le terrain du droit. Propos d’une sincérité cependant plutôt rafraîchissante et, à tout prendre, plus empreint d’humanisme que d’autres. Le droit ne peut être que répressif ou principalement répressif, ou son crédit risque d’en souffrir ; quand bien même quelque chose comme l’état d’urgence le justifierait. En est-on là ? Est-ce, si c’est le cas, légitime ? En débattra-t-on ? Qu’on en débatte ou non, si on s’en tient là, à quand l’objection de conscience en matière d’immigration ? L’insoumission est déjà qualifiée. Qui aide des étrangers en situation irrégulière à régulariser celle-ci s’expose, il faut le savoir, aux rigueurs de la loi.
Notes
[1] Raymond Coulon, « Mots, mythes et logique dans la construction des réalités juridiques et sociales », Droit et société, février 1992.

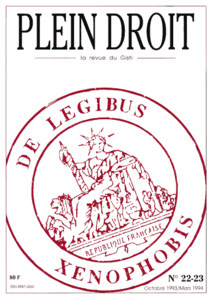
![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)










Partager cette page ?