Édito extrait du Plein droit n° 107, décembre 2015
« Les expulsés, leur voix, leurs droits »
Les périls de l’urgence
ÉDITO
Il est trop tôt, à l’heure où s’écrit cet éditorial, pour tirer un bilan des mesures décidées au lendemain du très noir 13 novembre 2015. Pas trop tôt cependant pour poser un certain nombre de questions.
Face aux critiques – peu nombreuses – qui ont pu se faire entendre à propos de l’instauration même de l’état d’urgence, la réplique a été immédiate : une telle menace justifie le plus haut niveau possible de sécurité. « La France est en guerre », a-t-il été répété… « La riposte de la République sera d’ampleur. Elle sera totale », proclame le ministre de l’intérieur.
Vouloir neutraliser les assassins et s’employer à ce que d’autres ne se lancent pas dans de nouvelles équipées criminelles du même ordre sont des objectifs incontestables. Mais les moyens de parvenir à ces objectifs ont été décidés très vite, sans concertation, sans débat : état d’urgence, rétablissement des contrôles aux frontières… Décider avec une telle célérité, sur la base d’arguments d’autorité, est en soi toujours périlleux. Même en temps dit « de guerre ».
On s’est ainsi privé de réfléchir à la véritable utilité de l’état d’urgence : quelles investigations policières, quelles poursuites, quels moyens de recherche des coupables des tueries du 13 novembre et de prévention d’autres attentats n’auraient pas pu être engagés sans l’état d’urgence ? En quoi le rétablissement des contrôles aux frontières est-il susceptible d’empêcher les coupables de quitter le territoire, et d’autres criminels d’y pénétrer ?
La privation durable de libertés fondamentales induite par la décision de prolonger l’état d’urgence a vite été justifiée par des adages du type « qui veut la fin veut les moyens » : la mise entre parenthèses d’un certain nombre de droits et libertés serait le prix à payer pour assurer la sécurité, de même que le pouvoir exorbitant donné, sans réel contrôle, à l’administration et aux forces de police. Sans compter la surenchère de propositions complémentaires : déchéance de nationalité pour les criminels, enfermement préventif des personnes suspectes, réforme de la légitime défense pour les policiers, surveillance accrue d’internet.
Dans les jours qui ont suivi, on a assisté à un nombre record d’interpellations, de gardes à vue, de perquisitions administratives, d’assignations à résidence, de placements en centre de rétention et de notifications d’obligation de quitter le territoire français. Avec quels résultats ? Là encore il est trop tôt pour le dire, mais on ne peut qu’être frappé par le grand nombre de personnes finalement relâchées, de témoignages de violences ou d’humiliations injustifiables, de récits d’interrogatoires portant sur des engagements politiques n’ayant aucun rapport avec des activités terroristes, de perquisitions sans sommation chez des personnes pourtant disposées à laisser ces opérations se dérouler, et par la rigueur des conditions d’assignation à résidence dont on peine à comprendre l’utilité.
On reste tout autant dubitatif devant le décalage manifeste entre des autorisations données à des manifestations sportives ou des marchés de Noël et l’interdiction de manifester dans le cadre de la COP21 ou d’autres mobilisations sociales, sans oublier les poursuites et les condamnations de personnes ayant bravé ces interdictions. Et comment comprendre l’absence de soutien aux habitants du quartier de la ville de Saint-Denis qui ont eu la malchance de vivre dans un immeuble où s’étaient retranchés des terroristes et qui, pour certains, ont même été traités comme des terroristes ou des complices ? Des bavures ? Des erreurs ? Ou bien des illégalités d’ordre systémique ? Comment ne pas ressentir un profond malaise face à un débordement d’actes frénétiques qui relèvent davantage d’une posture politicienne que de l’action raisonnable d’un État soucieux de la sécurité et du bien-être de sa population ?
À la différence de l’après-attentats de janvier 2015, aucune voix ne s’est fait entendre au sommet de l’État pour dire : « Pas d’amalgame » Au contraire, depuis le 13 novembre, on a vu se développer une stigmatisation bien réelle de l’islam et une logique de « guerre des civilisations » qui conduisent à multiplier les déclarations sur les phénomènes de « radicalisation de l’islam », à sommer les musulmans de se prononcer clairement – comme si, en France et ailleurs, ils ne luttaient pas contre la haine, l’intolérance et les dérives meurtrières commises sous couvert de la foi –, à réclamer une plus grande sévérité dans les poursuites de femmes portant burqa ou niqab, à opérer une série de perquisitions dans des mosquées, à arrêter des imams, à fermer des lieux de prière…
Que s’est-il passé pour que l’« amalgame » ne soit plus considéré comme un danger ? Est-on si certain d’avoir pris la mesure des phénomènes qui sont à la racine des attentats ?
À défaut de mener une véritable réflexion sur les causes des attentats, on peut être certain que les étrangers - qu’ils soient résidents de longue date ou récemment arrivés à la recherche de sécurité - vont être, au travers de réformes, de décisions politiques et d’évolution des pratiques de l’administration, d’autres victimes collatérales de ces drames.
Rien ne nous garantit que les mesures prises dans l’urgence soient de nature à assurer la sécurité. Tout nous laisse à penser, en revanche, que ces mesures sont dangereuses à moyen et long termes. En décidant de passer outre les règles de l’État de droit, c’est une boîte de Pandore que l’on ouvre. Quand et comment se refermera-t-elle ? Combien de nouvelles violences les plus pauvres et les plus discriminés auront-ils encore à subir ?

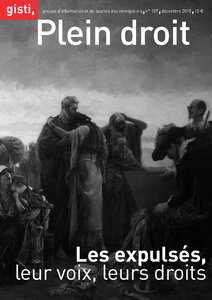
![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)










Partager cette page ?