Article extrait du Plein droit n° 76, mars 2008
« Hortefeux, acte 1 »
L’intégration à rebours
Danièle Lochak
Professeur de droit public à l’Université Paris X-Nanterre
C’est avec la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration que la notion d’intégration a fait son entrée dans la législation concernant l’entrée et le séjour des étrangers, ce que le promoteur de cette loi, Nicolas Sarkozy, n’avait pas manqué de souligner pour s’en féliciter, avant d’intituler la seconde loi adoptée à son initiative et promulguée le 24 juillet 2006, « loi relative à l’immigration et à l’intégration ». La loi « Hortefeux » du 20 novembre 2007, relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile s’inscrit dans cette continuité puisqu’elle vise, si l’on en croit l’exposé des motifs, à permettre aux étrangers membres de famille « de mieux réussir leur parcours d’intégration en le préparant dès avant leur venue en France ».
Faut-il en déduire que l’intégration des immigrés serait (enfin) devenue la préoccupation de ceux qui nous gouvernent ? Non, bien sûr, et pour deux raisons au moins. D’abord, parce que l’intégration n’a jamais cessé, depuis 1974, de faire partie des objectifs officiels de la politique d’immigration, même si les réalisations concrètes n’ont pas suivi et si elles ont été entravées par la multiplication des dispositions répressives destinées à « maîtriser les flux migratoires ». Ensuite, parce que ce qui caractérise la situation actuelle, c’est que l’effort d’intégration, dont la responsabilité doit normalement incomber aux pouvoirs publics, est rejeté sur les immigrés et converti en injonction de s’intégrer, sous peine de conserver à jamais leur statut précaire.
Compte tenu de ce qui se joue – politiquement et idéologiquement – autour de l’intégration, il n’est pas sans intérêt de jeter un regard rétrospectif sur ces enjeux depuis le milieu des années 1970 : c’est le moment où l’on a pris conscience que l’immigration de travailleurs, perçue comme temporaire, avait progressivement évolué vers une immigration durable et où l’intégration des immigrés est entrée dans le champ des préoccupations des pouvoirs publics avant de devenir un sujet de débat politique.
L’intégration est d’abord un objet de discours – un discours qui a souvent fait figure de substitut à une action publique défaillante. Sur le terrain des mots, l’« intégration » a été pendant un certain temps en concurrence avec l’« insertion », tandis que l’assimilation lui servait de repoussoir. Le terme d’« intégration » s’est finalement imposé. Amalgamé à la thématique du « modèle républicain », il a donné naissance au concept d’« intégration à la française », puis à celui d’« intégration républicaine ».
On a tendance à situer ces trois modalités d’entrée des immigrants dans la communauté française sur une sorte d’échelle allant de l’attitude la plus « impérialiste » de la société d’accueil à l’attitude la plus respectueuse de l’autre. L’assimilation, qui suppose l’abandon de l’identité originelle pour se fondre dans la communauté d’adoption, est depuis longtemps taboue, sinon dans la législation (l’accès à la nationalité exige une condition d’assimilation) du moins dans le discours politiquement correct qui en a abandonné l’usage aux partisans d’une France ethniquement et culturellement homogène. L’insertion, à l’inverse, est perçue comme un objectif minimaliste tourné vers l’accueil d’individus ayant vocation à retourner chez eux, d’où l’accent mis sur la préservation des liens de l’immigré avec sa culture d’origine, voire sur le retour.
Des « marqueurs idéologiques »
Enfin, l’intégration reposerait sur une dynamique d’échange telle que « chacun accepte de se constituer partie du tout et s’engage à respecter l’intégrité de l’ensemble » [1]. Pour le Haut Conseil à l’intégration, elle serait « un processus dynamique et inscrit dans le temps d’adaptation à notre société de l’étranger qui a l’intention d’y vivre [postulant] la participation des différences à un projet commun et non, comme l’assimilation, leur suppression ou, à l’inverse, comme l’insertion, la garantie protectrice de leur pérennisation ».
Ces débats sémantiques ne sont compréhensibles que si l’on se rappelle que les mots ne sont pas neutres et qu’ils ont pendant longtemps servi de « marqueur idéologique » entre la droite et la gauche. Tandis qu’à la fin des années 1970, la droite commence à utiliser le terme d’« intégration » comme un substitut à l’« assimilation », la gauche prône en revanche l’« insertion sociale des travailleurs immigrés ». Une fois au pouvoir, elle finira par se rallier à l’« intégration » : la prise de conscience de la sédentarisation durable de la population immigrée explique que l’intégration, plus exigeante que la simple insertion, soit érigée en objectif de l’action publique. Cette conversion sera plus tard confortée par l’affaire du foulard, à l’automne 1989, qui achèvera de discréditer toute revendication d’un droit à la différence, et mettra au premier plan le respect par tous de certaines valeurs, à commencer par la laïcité. De fait, cette affaire va provoquer « le passage du discours à l’institutionnalisation » [2] avec la nomination d’un secrétaire général à l’intégration, la création d’un Comité interministériel à l’intégration et d’un Haut Conseil de l’intégration.
Le contexte dans lequel l’« intégration », qui semble faire désormais consensus au sein de la classe politique, est consacrée officiellement dans les textes et les institutions est marqué par la dénonciation des « communautarismes » qui menacent la tradition républicaine. Cet élément aide à comprendre les torsions ultérieures du discours. La lecture des rapports du Haut Conseil à l’intégration est particulièrement instructive à cet égard, car elle permet de repérer le moment où le discours sur l’immigration et l’intégration, subissant la contagion du discours politique et savant ambiant, intègre la « République » à son lexique.
Le premier rapport, publié en 1991, s’intitule déjà Pour un modèle français d’intégration. Le concept d’« intégration à la française » se voit consacré deux ans plus tard, avec la parution sous ce titre d’un ouvrage qui synthétise la réflexion des trois premières années de fonctionnement du Haut Conseil. Le modèle français d’intégration y est décrit comme opposé à la « logique des minorités » et à la reconnaissance des communautés, sans toutefois faire référence ni à la République ni au modèle républicain. C’est en 2001 que la République fait véritablement son apparition lorsque, s’intéressant à L’islam dans la République, le Haut Conseil s’interroge sur la compatibilité entre la religion musulmane et les valeurs républicaines.
La République omniprésente
Un pas supplémentaire est franchi avec la publication, en 2004, du rapport intitulé Le contrat et l’intégration. Sur fond de République omniprésente (il est question de « philosophie républicaine », d’« instruction authentiquement républicaine », de « régime républicain », d’« ambition républicaine »…), il est proposé que chaque étranger venant en France pour y travailler et y vivre soit invité à signer un « contrat d’intégration » avec « l’État républicain ».
En liant « la République » à « l’intégration », on laisse entendre que ce qui est républicain est nécessairement intégrateur et, réciproquement, que l’intégration ne peut être que républicaine. D’où l’expression « modèle républicain d’intégration », désormais couramment utilisée, éventuellement pour déplorer qu’il soit en crise. La consécration, par la loi du 26 novembre 2003, de l’« intégration républicaine » s’inscrit dans le prolongement de cette évolution. La notion est là pour signifier la double obligation de s’intégrer et de respecter les principes républicains : liberté, égalité… laïcité !
L’insertion, puis l’intégration, ont été érigées dès 1974, on l’a dit, en objectif officiel de la « nouvelle politique d’immigration ». Une politique censée marcher sur deux pieds : la maîtrise des flux migratoires et la lutte contre l’immigration clandestine, d’un côté, l’intégration de la population immigrée en situation régulière, de l’autre. Cet objectif s’est notamment concrétisé par l’assouplissement, en 1975, des conditions d’éligibilité aux fonctions de représentation du personnel dans l’entreprise ou encore par l’officialisation, en 1976, du droit au regroupement familial.
Il faut toutefois attendre l’arrivée de la gauche au pouvoir pour que cette préoccupation soit plus nettement prise en compte. Ce qui caractérise la politique menée à cette époque, c’est l’approche territoriale et – les deux vont de pair – la préférence pour des mesures qui ne soient pas ciblées spécifiquement sur la population immigrée. C’est, par exemple, la mise en place des zones d’éducation prioritaires (ZEP), qui donnent des moyens supplémentaires aux établissements accueillant une proportion importante d’élèves d’origine étrangère. C’est aussi la politique de développement social des quartiers (DSQ) qui vise à lutter globalement contre l’exclusion et la ghettoïsation des quartiers défavorisés et qui inclut des actions en faveur des populations immigrées. Ce sont encore les contrats d’agglomération, passés entre l’État et les villes petites et moyennes pour les inciter, grâce à des moyens financiers supplémentaires, à mieux prendre en compte les besoins de la population immigrée.
La politique de la ville s’essouffle, reçoit un coup d’arrêt en 1986, reprend timidement au début de l’année 1988 avec la relance des contrats d’agglomération. C’est l’affaire du foulard qui va contribuer à inscrire durablement l’intégration sur l’agenda gouvernemental. Le spectre volontiers agité de l’intégrisme islamique, les incidents répétés dans les banlieues et la poussée du Front national incitent le gouvernement à réagir. Des mesures en faveur de l’intégration sont annoncées et de nouvelles structures mises en place : un comité interministériel à l’intégration, chargé de « définir, d’animer et de coordonner la politique du gouvernement en matière d’intégration des résidents étrangers ou d’origine étrangère », un secrétaire général à l’intégration, un Haut Conseil de l’intégration, enfin, composé d’experts et d’hommes politiques de différentes sensibilités, investi d’une tâche de réflexion. On décide de financer, dans soixante sites pilotes, des programmes d’intégration tous azimuts : soutien scolaire, assistance administrative pour les étrangers primo-arrivants, animation sportive, aide linguistique, services de proximité, permanences juridiques, etc.
La période 1993-1996 est une période creuse pendant laquelle l’expression publique sur l’intégration se limite en gros à la parution – irrégulière – des rapports du Haut Conseil à l’intégration. En mars 1997, toutefois, le ministre délégué à la ville et à l’intégration, Éric Raoult, présente un « programme d’action en faveur de l’intégration » : remise aux nouveaux arrivants d’un « contrat d’intégration » (conçu à l’époque simplement comme un guide bilingue des droits et devoirs et des règles de vie en France) ; encouragement de l’apprentissage du français ; accompagnement scolaire ; restructuration des foyers de travailleurs migrants ; parrainage pour l’emploi des jeunes ; lutte contre les discriminations ; amélioration des procédures de naturalisation. La défaite de la droite aux législatives de 1997 ne permettra pas de tester si, au-delà de l’effet d’annonce auquel fait penser cet inventaire de mesures hétérogènes, il y avait une réelle volonté d’agir.
La vraie histoire du contrat d’accueil et d’intégration commence avec une note de Yves Jego, député UMP de Seine-et-Marne, divulguée le 9 octobre 2002 et intitulée Pour une nouvelle politique d’intégration. Prônant « une nouvelle logique de contractualisation entre le nouvel arrivant et la République », elle propose un « contrat d’arrivée » de trois ou quatre ans fixant un certain nombre d’obligations, suivi d’un « contrat d’enracinement » de quinze ans conférant des droits nouveaux, dont le droit de vote – aussitôt oublié – et l’acquisition plus rapide de la nationalité. L’idée est reprise par Jacques Chirac dans son discours de Troyes, puis par Jean-Pierre Raffarin lors de l’installation du nouveau Haut Conseil à l’intégration. En janvier 2003, le Comité interministériel à l’intégration, en sommeil depuis 1990, est réactivé, et, dès le mois d’avril, il présente un programme de cinquante-cinq mesures dont la mesure-phare est le contrat d’accueil et d’intégration proposé aux primo-arrivants. S’emparant à son tour du concept, le Haut Conseil, dans son rapport de 2004 déjà cité, relève, non sans emphase, qu’on touche ici « aux principes même de notre pacte républicain : les notions de contrat et d’intégration » et que son mérite serait de nous amener à « réfléchir ensemble au contrat et à la citoyenneté ».
On connaît la suite. Expérimenté dès 2003, consacré par la loi de cohésion sociale de 2005, le contrat d’accueil et d’intégration est rendu obligatoire par la loi de 2006 pour tout étranger qui souhaite s’installer en France. La signature et le respect du contrat conditionnent le renouvellement de la carte de séjour et sont érigés en critères d’appréciation de la « condition d’intégration républicaine » à laquelle est désormais subordonné l’accès au statut de résident.
La loi Hortefeux poursuit dans le même sens. Au motif que l’intégration des membres de famille dans la société française passe « par la connaissance de la langue et des valeurs de la République », que la maîtrise de la langue française « peut favoriser, dans certains cas, l’égalité entre les hommes et les femmes », que « le français, langue de la République [sic], est associé dans notre culture aux valeurs fondatrices de celle-ci, parmi lesquelles la liberté et l’égalité », elle impose aux candidats au regroupement familial et aux conjoints de Français de se soumettre, dans leur pays de résidence, à l’évaluation de leur « degré de connaissances de la langue et des valeurs de la République » et, si l’évaluation en démontre le besoin, de suivre une formation qui conditionnera l’obtention d’un visa long séjour.
Par ailleurs, le contrat d’accueil et d’intégration se voit adjoindre une version familiale : pour « préparer l’intégration républicaine de la famille dans la société française », les parents d’enfants venus dans le cadre du regroupement familial devront passer un contrat d’accueil et d’intégration familial par lequel ils s’engagent à suivre une formation sur « les droits et les devoirs des parents » en France et à respecter l’obligation scolaire. Le non respect du contrat pourra déboucher sur la mise en œuvre du « contrat de responsabilité parentale » prévu par le code de l’action sociale et des familles en cas de carence de l’autorité parentale, la suspension du versement de certaines prestations familiales, voire le non-renouvellement de leur carte de séjour.
Une précarisation engagée depuis 1993
En supprimant l’accès de plein droit à la carte de résident pour la quasi-totalité des étrangers, en subordonnant cet accès à une condition d’intégration, les réformes récentes prennent donc l’exact contre-pied de la philosophie qui avait inspiré la réforme de 1984 : alors que la garantie de stabilité du séjour avait été considérée alors comme un facteur favorisant l’intégration, il faut désormais prouver que l’on est intégré pour obtenir un droit au séjour stable ; et aussi longtemps qu’on n’a pas donné des gages suffisants d’intégration, on est maintenu dans une situation précaire.
Ce faisant, on parachève également le mouvement de précarisation du droit au séjour engagé depuis 1993 pour aboutir à l’inversion de la hiérarchie des titres instaurée en 1984. La carte de résident avait vocation à être le titre de séjour de droit commun, la carte de séjour temporaire étant réservée aux étrangers venant en France pour une durée limitée. Désormais, c’est la carte de séjour temporaire qui devient comme le titre de droit commun, tandis que l’accès à la carte de résident est de plus en plus étroitement contrôlé et soumis à l’appréciation discrétionnaire du préfet.
On en revient, d’une certaine façon, à la philosophie initiale de l’ordonnance de 1945, lorsque, sur la base d’un contrat de travail qui seul donnait droit au séjour, l’étranger était systématiquement mis en possession d’une carte valable un an, avec la perspective d’obtenir après quelques années une carte de « résident ordinaire » valable trois ans et des chances plus restreintes d’obtenir un jour le statut de « résident privilégié ». À cette différence près qu’à l’époque, la précarité était la contrepartie d’une liberté de circulation et d’installation qui existait en fait, sinon en droit. Il est vrai que les pouvoirs publics n’affichaient pas non plus hypocritement la prétention d’intégrer les immigrés…
Notes
[1] Jacqueline Costa-Lascoux, « De l’immigré au citoyen », Notes et études documentaires, Paris, La Documentation française, 1989, pp. 9-12.
[2] Françoise Gaspard, « Assimilation, insertion, intégration : les mots pour “devenir français” », Hommes et migrations, mai 1992.

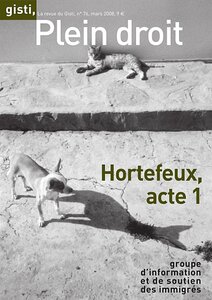
![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)










Partager cette page ?