Article extrait du Plein droit n° 27, juin 1995
« Dénoncer et expulser »
Délit d’humanité
Benoît Mercuzot
Prise au pied de la lettre, cette disposition vient heurter la conscience de quiconque considère qu’un étranger même en séjour irrégulier reste un être humain à part entière et ne peut, à ce titre, se voir refuser toute aide. Au point qu’on en arrive à se demander comment un texte aussi ambigu et dangereux a pu être introduit tout à fait légalement dans notre ordre juridique.
La violation des principes fondamentaux de notre droit est manifeste au moins à un double titre. Depuis que la Déclaration de 1789 a reçu valeur constitutionnelle, il est d’abord constant que le législateur doit définir avec précision les agissements qu’il entend sanctionner pénalement. Cette obligation, directement induite des termes de l’article 8 de la Constitution qui pose le principe de la légalité des délits et des peines, est constamment rappelée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Or, le législateur n’a manifestement pas respecté cette obligation. Les termes mêmes de l’infraction l’attestent : « Toute personne qui, par aide directe ou indirecte, aura facilité ou tenté de faciliter… ».
Ainsi définie, l’infraction peut viser de nombreuses catégories de personnes : des « passeurs » ou organisateurs de filières de travail clandestin ; des associations humanitaires qui sont amenées à soigner et héberger dans leurs structures des clandestins ; des personnes qui, en raison d’un lien familial ou autre qui les unit à un clandestin, lui fournissent une aide matérielle ; ou encore, puisque le caractère extensif de la définition n’interdit pas l’absurde, quiconque aura simplement fait l’aumône à un étranger en situation irrégulière. Tous ces cas, relevant de comportements pourtant bien différents, sont susceptibles de tomber sous le coup de l’infraction définie par l’article 21 de l’ordonnance du 2 novembre 1945. Aussi, une telle infraction ne répond pas aux exigences de précision posées par le principe de légalité des délits et des peines tel qu’il est interprété par le Conseil constitutionnel. Une telle loi, dont il est impossible de définir le contenu, est par nature source d’arbitraire aux mains du pouvoir et d’insécurité pour les justiciables.
L’article 21 porte ensuite atteinte au principe à valeur constitutionnelle, dégagé récemment par le Conseil constitutionnel, de « sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation ». Certes, il peut paraître disproportionné de mentionner un principe aussi fondamental du droit constitutionnel alors même que le contenu qu’entend lui donner la Haute instance n’est pas encore précisé par sa jurisprudence. Pourtant, dans la mesure où la rédaction particulièrement large de l’article 21 permettrait de sanctionner pénalement des agissements qui ne relèvent pas d’un souci lucratif, mais tout simplement d’un sentiment d’humanité à l’égard d’étrangers se trouvant dans une situation inextricable, c’est bien le principe de « sauvegarde de la dignité humaine » qui serait bafoué, et cela tout autant à l’égard des étrangers en situation irrégulière que de ceux qui, « par aide directe ou indirecte », auraient facilité leur séjour.
La « sauvegarde de la dignité humaine » bafouée
L’étranger se verrait en effet contraint de vivre hors de tout contact humain qui ne manquerait pas de constituer potentiellement une « aide indirecte » qui « faciliterait » son séjour irrégulier. La rédaction de la loi est telle que même l’aide mutuelle que s’apporteraient des étrangers en situation irrégulière pourrait être sanctionnée, aggravant pour chacun d’eux la sanction qu’ils encourent pour l’irrégularité de leur séjour. Cette disposition, interprétée extensivement, contraint donc bien l’étranger irrégulier à se placer en dehors de la société humaine.
A l’égard de ceux – nationaux ou étrangers en situation régulière – qui apporteraient une aide sans but lucratif, la violation est tout aussi patente. Le délit défini par la loi leur interdit potentiellement de porter quelque attention que ce soit à un étranger en situation irrégulière parce que, d’une manière ou d’une autre, elle constitue une aide indirecte qui facilite son séjour. Pour prendre un exemple extrême, un médecin pourrait se voir interdire – sauf à se mettre en infraction avec la loi – de soigner un étranger en situation irrégulière. Une telle interdiction constituerait non seulement une violation du code de déontologie et du serment d’Hippocrate, mais surtout une atteinte à la dignité humaine de ce médecin.
Si on accepte cette interprétation extensive, il est clair que les principes fondamentaux de notre droit sont bafoués par l’article 21 de l’ordonnance du 2 novembre 1945. Il faut dès lors s’interroger sur les conditions qui ont pu permettre l’introduction d’un texte aussi ambigu dans l’ordre juridique. Et cette question devient douloureuse car elle oblige à relever l’inertie ou la complicité de l’ensemble des acteurs politiques.
Il faut d’abord souligner que ce délit a été institué dans son principe par le texte initial de l’ordonnance. Ses auteurs sont donc directement responsables de la généralité des termes utilisés pour définir l’infraction. Mais pour évidente qu’elle apparaisse, cette responsabilité reste très difficile à évaluer. Les conditions historiques et juridiques exceptionnelles qui ont entouré l’élaboration de ce texte rendent aléatoire un tel exercice. Au demeurant, il ne revêt qu’un intérêt limité dès lors que le législateur a par deux fois, en 1991 et en 1994, étendu l’infraction créée en 1945. Les acteurs politiques de 1991 et de 1994 endossent ainsi la pleine responsabilité de cette infraction et leur responsabilité peut être précisée.
En 1991, le législateur a voulu lutter contre l’immigration clandestine et le travail clandestin. Il a donc visé particulièrement ceux qui organisent les filières de l’immigration clandestine et les « manœuvriers » qui utilisent à peu de frais cette main-d’œuvre corvéable à merci. Pour ce faire, il a modifié les termes de l’article 21 de telle sorte que non seulement « tout individu » mais également « toute personne » – y compris morale – qui aurait aidé à l’entrée irrégulière d’un étranger en France soit sanctionnable pénalement.
Aussi, la majorité de 1991 a-t-elle une responsabilité équivoque. D’un côté, elle intègre cet article 21 dans un texte de loi qui vise à lutter contre les filières de l’immigration clandestine. Elle limite ainsi la probabilité qu’un juge sanctionne un individu qui aurait aidé, dans un souci d’humanité, un étranger en situation irrégulière. Mais d’un autre côté, elle fait preuve tout à la fois d’aveuglement, de lâcheté politique et d’imprévoyance.
L’aveuglement résulte de ce que personne n’a évoqué en 1991 ce qui pourtant saute aux yeux du lecteur le moins averti : l’inadéquation entre la lettre du texte et les agissements que le législateur entendait effectivement punir. Cette inadéquation est tellement évidente que son occultation ne peut s’expliquer que par une certaine lâcheté politique. En effet, pour y mettre fin, il aurait fallu recomposer le texte de l’article 21 et prendre le risque de se voir accuser par l’opposition de l’époque de mettre en cause gravement un texte fondateur en matière de contrôle de l’immigration. Le caractère politiquement sensible de l’immigration explique sans doute que la majorité ait refusé d’envisager un remaniement en profondeur de l’article 21. Mais un tel renoncement est coupable d’imprévoyance. En effet, la protection que constituait le titre de la loi de 1991 n’était d’évidence que très fragile et risquait d’être remise en cause lors d’un changement de majorité.
Duplicité des uns…
C’est précisément ce qui est arrivé en 1994. Sous prétexte de mettre la législation française en conformité avec la Convention de Schengen, le législateur a étendu l’infraction de l’article 21. La majorité a alors fait œuvre de duplicité, et l’opposition, une fois encore, de lâcheté.
La duplicité de la majorité saute aux yeux. La Convention de Schengen, dans son article 27, prévoit effectivement de sanctionner l’aide apportée aux étrangers irréguliers, mais seulement lorsqu’elle est apportée « à des fins lucratives ». Or cette mention restrictive, si elle avait été intégrée dans l’article 21, aurait permis de régler en grande partie la question de sa non-conformité aux droits fondamentaux.
Mais plutôt que de profiter de cette occasion, le ministre de l’Intérieur a exclu cette restriction de l’infraction au motif qu’elle interdirait la poursuite « des agissements qui relèveraient par exemple de l’infiltration en France d’éléments appartenant à des réseaux islamistes, terroristes ou d’espionnage ». Du coup, l’ambiguïté du texte de l’article 21 s’est renforcée. Ainsi, lors du débat, une sénatrice socialiste, Françoise Séligmann, a enfin pris publiquement la mesure du danger introduit par cette disposition et a demandé si l’aide apportée à un étranger en situation irrégulière, « par amitié ou tout simplement parce que c’est normal », était susceptible d’être poursuivie pénalement. Un sénateur de la majorité a rétorqué tout aussitôt : « Mais c’est uniquement des passeurs qu’il s’agit ! ».
Pourtant, en répondant à cette question, le rapporteur de la commission a réactivé le doute. Il a en effet rappelé avec fermeté que la loi française ne distingue pas entre l’aide apportée « à des fins lucratives » et celle apportée « dans un but idéologique » (sic). Sauf à considérer que dans l’esprit du rapporteur, une aide fournie par simple sentiment d’humanité est assimilable à « un but idéologique », la réponse ainsi donnée ne permet pas de savoir si une telle aide tombe sous le coup de l’article 21.
…lâcheté des autres
Si la majorité a fait preuve de duplicité, l’opposition a une fois de plus fait preuve de lâcheté politique. En effet, elle aurait pu saisir le Conseil constitutionnel mais elle y a renoncé. Il faut se demander pourquoi.
Avait-elle des doutes sur la probabilité d’une censure de l’article 21 ? Vraisemblablement, non. Il serait certes présomptueux de prétendre pouvoir dire avec certitude ce qu’aurait été la décision du Conseil. Toutefois, sa jurisprudence, connue de l’opposition, fait penser qu’il était possible d’obtenir sinon une censure en bonne et due forme de l’article 21, du moins une déclaration de conformité sous réserve qui aurait interdit une lecture extensive de l’infraction. L’opposition, une fois de plus, a-t-elle été aveugle ? Là encore, les débats parlementaires obligent à répondre négativement. La menace d’une saisine du Conseil constitutionnel a été explicitement formulée au Sénat et ce n’est certainement pas la teneur des propos du ministre de l’Intérieur ou du rapporteur de la commission qui ont pu rassurer l’opposition.
Aussi faut-il chercher les raisons de cette non-saisine dans des motifs d’ordre politique : vraisemblablement, l’opposition a craint que la contestation de la constitutionnalité d’une loi luttant contre l’immigration clandestine ne soit perçue par l’opinion publique comme une remise en cause de la lutte contre cette immigration. L’opinion publique, même si on la suppose incapable de comprendre les nuances, fait loi, surtout en période préélectorale. Le président de la République n’ayant apparemment pas envisagé de saisir lui-même le Conseil, ni même estimé que le contenu de la loi était suffisamment grave pour justifier une nouvelle délibération du Parlement, la loi a été promulguée et s’applique sans que l’on puisse désormais la contester.
Le droit français sauvé de la honte
La menace que l’article 21 fait peser sur les droits fondamentaux a été – momentanément ? – écartée par le tribunal correctionnel de Paris. Devant se prononcer sur le sort d’une jeune femme poursuivie pour avoir hébergé son futur époux, étranger en situation irrégulière, et refusé de restituer à la police son passeport, le tribunal a refusé, dans son jugement du 10 février 1995, de considérer que l’infraction prévue par l’article 21 était constituée. Fondé sur une interprétation restrictive de l’infraction (qui ne pourrait donc servir qu’à poursuivre ceux qui profitent de l’immigration clandestine), ce jugement a sauvé le droit français de la honte qui le menaçait. Certes, il pourrait à l’occasion être démenti par un autre juge pénal qui aurait à appliquer non plus la loi de 1991 en vigueur à l’époque des faits poursuivis, dont l’objet est mieux défini, mais la loi de 1994 beaucoup plus ambiguë. Mais ce jugement montre que la protection la plus efficace des droits fondamentaux réside, bien plus que dans des procédures toujours contournables, dans le refus de ceux qui appliquent le droit d’en oublier les valeurs fondamentales.
Aussi, au moment où les juristes français commencent à se demander avec horreur comment les lois anti-juives du régime de Vichy ont pu être appliquées sans états d’âme apparents et quelquefois avec zèle, ce jugement du tribunal correctionnel de Paris est doublement exemplaire. Il ne répond certes pas à la question posée pour la période de Vichy, mais il montre d’abord que le danger d’une banalisation des lois inhumaines est toujours présent. Il montre ensuite qu’il est possible d’éviter qu’une génération future de juristes n’ait à se poser la même question douloureuse à propos de cette fin de siècle et de la manière dont elle a traité les étrangers.
La seule solution consiste en ce que chacun affirme et applique, à la place qu’il occupe, les valeurs fondamentales du droit. Ainsi, l’« air du temps », les petits calculs, les intérêts mal compris auront plus de difficultés à occulter les droits fondamentaux des individus.

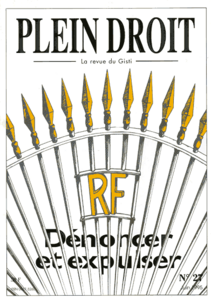
![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)










Partager cette page ?