Article extrait du Plein droit n° 62, octobre 2004
« Expulser »
Le poids des consulats
Alexis Spire
Sociologue, Centre d’études et de recherches administratives et politiques (CERAP)
L’éloignement d’un étranger qui réside sur le territoire français est une mesure qui se situe à l’intersection du droit des personnes et de celui des États [1]. Les autorités françaises sont en principe les seules à intervenir puisque l’éloignement d’un étranger relève de la souveraineté de l’État. Mais, pour que la mesure soit effectivement réalisée, il faut aussi que l’État d’origine de l’étranger accepte de le reconnaître comme l’un de ses ressortissants.
Pendant longtemps, le problème ne s’est guère posé car les mesures d’éloignement d’étrangers ne constituaient pas une priorité politique. Durant les « Trente Glorieuses », par exemple, les préfets se contentaient le plus souvent de remettre à l’étranger un bon de transport jusqu’à la frontière par laquelle il avait choisi de quitter le territoire. Il était même fréquent qu’à défaut de pouvoir financer la reconduite, le ministère de l’intérieur décide de laisser l’étranger se maintenir sur le territoire en situation irrégulière. En pratique, la mesure d’éloignement n’était mise en œuvre que dans les cas où l’expulsion sanctionnait une condamnation pénale. Quelques accords bilatéraux ont alors été signés avec des pays limitrophes afin d’organiser la réadmission de leurs nationaux [2]. Mais, dans la plupart des cas, les étrangers en instance d’éloignement n’étaient pas ressortissants de ces pays. Le plus souvent, l’escorte policière s’arrêtait donc à la frontière et n’allait jamais jusque dans le pays de départ.
Depuis la fin des années 1970, l’effectivité des mesures d’éloignement est devenue un objectif prioritaire de l’administration française. C’est la loi Bonnet de 1980 qui a d’abord légalisé la privation de liberté pour un étranger en instance d’expulsion, puis la loi du 29 octobre 1981 qui a généralisé le principe de la rétention administrative [3]. Pour l’étranger placé en rétention, il est bientôt apparu que le seul moyen d’échapper à la reconduite était de ne pas présenter son passeport aux autorités préfectorales. Dès lors, l’issue de la procédure dépend du consulat du pays dont il se réclame. Si le consulat le reconnaît comme l’un de ses ressortissants, plus rien ne s’oppose à l’exécution de la reconduite à la frontière. En revanche, si le consulat ne répond pas ou s’il refuse de délivrer un laissez-passer, l’étranger est remis en liberté au terme de la période de rétention.
L’étranger, la préfecture et le consulat
Toute mesure d’éloignement fait donc intervenir trois protagonistes qui n’ont ni les mêmes intérêts ni les mêmes ressources pour les défendre : l’étranger, la préfecture et le consulat du pays d’origine.
L’étranger tout d’abord. Une fois qu’il a épuisé toutes les voies de recours et qu’il se trouve en rétention, la non présentation de son passeport aux autorités de police apparaît souvent comme l’ultime espoir d’échapper à la reconduite, même si, en réalité, les chances sont très minces. A cet égard, tous les étrangers ne sont pas logés à la même enseigne car la probabilité d’être identifié comme le ressortissant d’un pays varie fortement selon les pratiques des consulats concernés.
Dans les couloirs des centres de rétention, il se dit par exemple qu’il vaut mieux se prétendre soudanais ou camerounais pour les uns, irakien ou égyptien pour les autres car les consulats de ces pays ont la réputation de ne pas délivrer de laissez-passer. La probabilité de ne pas être reconnu dépend aussi de l’histoire de chaque pays et de la genèse des découpages territoriaux. Le rayonnement de l’ancien empire ottoman permet par exemple à certains de se déclarer de nationalité irakienne ou iranienne ; s’ils ne sont pas reconnus par le consulat de Turquie, ils ont alors toutes les chances d’échapper à la reconduite à la frontière.
Depuis peu, ce rôle des consulats a également été pris en compte par le mouvement des sans-papiers. A la suite des arrestations intervenues lors de l’évacuation du square Séverine, à Paris, au début du mois de juillet 2004, seuls trois des vingt-six sans-papiers interpellés avaient sur eux des titres de voyage et pouvaient donc être éloignés immédiatement. Pour les autres, la Coordination nationale des sans-papiers a tenté d’empêcher leur éloignement en appelant ses sympathisants à intervenir auprès des consulats (par téléphone ou par fax) pour exiger que les laissez-passer ne soient pas délivrés.
De leur côté, les autorités préfectorales mettent en œuvre tous les moyens pour que l’éloignement puisse avoir lieu. C’est d’ailleurs pour leur faciliter la tâche que la durée de rétention, fixée initialement à sept jours, est passée à dix, puis à douze, puis à trente-deux jours avec la dernière loi Sarkozy. En réalité, cet allongement continu de la durée de rétention est un moyen de faciliter l’éloignement par « vols groupés » mais ne résout pas la question de la délivrance des laissez-passer qui dépend davantage du degré de « coopération » des autorités consulaires. En effet, dès que l’étranger est placé en rétention, la préfecture envoie par fax le dossier de l’intéressé au consulat du pays dont il est supposé être le ressortissant (elle se fonde en général sur la nationalité déclarée à l’entrée en France ou sur la langue parlée lors de l’audition). Deux cas de figure se présentent alors : soit le consulat accepte de « coopérer » et l’étranger y est conduit sous escorte policière pour un entretien visant à déterminer s’il est bien ressortissant de ce pays ; soit le consulat refuse d’apporter son concours aux autorités préfectorales et ne délivre aucun laissez-passer, ni au bout de sept, ni au bout de douze, ni au bout de trente-deux jours [4].
Depuis quelque temps, les pouvoirs publics français agissent sur tous les fronts pour mettre fin à ces résistances et augmenter les taux de reconduite à la frontière. A l’échelle internationale tout d’abord, l’imposition de clauses de réadmission dans les accords de coopération est désormais monnaie courante : au niveau français comme au niveau communautaire, les questions d’aide au développement et d’échanges commerciaux sont de plus en plus systématiquement liées à la gestion des flux migratoires [5].
Depuis la récente visite de Nicolas Sarkozy au Mali par exemple, le consulat de ce pays se montre beaucoup plus « coopératif » : alors qu’il ne délivrait jusque là aucun laissez-passer, il accepte maintenant de se déplacer jusqu’au centre de rétention pour procéder à l’identification de ses ressortissants. De même, depuis la dernière visite des autorités françaises, le consulat de Tunisie de Marseille se rend jusqu’à la maison d’arrêt pour identifier les détenus, de telle sorte que la police de l’air et des frontières puisse les conduire directement à l’aéroport, sans passer par le centre de rétention.
A l’échelle nationale, le ministère de l’intérieur consacre également beaucoup de moyens pour favoriser un « rapprochement » avec davantage de consulats. Dans une circulaire du 16 avril 2002 relative à la délivrance des laissez-passer consulaires, il avertit les préfectures que des entretiens bilatéraux ont eu lieu avec les représentants des principaux pays destinataires des reconduites, afin de « contribuer à l’établissement d’un climat de compréhension mutuelle » plus propice à l’aboutissement des démarches préfectorales [6]. De façon moins officielle, les services de police chargés de l’éloignement proposent même parfois de monnayer les laissez-passer pour inciter les consulats à davantage de « coopération ».
Taux de délivrance de laissez-passer des vingt-quatre principaux consulats
* Ces chiffres ne comprennent pas les données pour les centres de Paris-Dépôt et Paris-Vincennes et uniquement des données partielles pour le centre de Lyon.
De leur côté, les consulats sont partagés entre plusieurs injonctions contradictoires. Ils sont en principe tenus par le droit international de réadmettre leurs ressortissants mais ils sont également censés protéger leurs nationaux et défendre leurs intérêts face à un État tiers. Cette contradiction donne lieu à des pratiques de délivrance de laissez-passer très variables d’un consulat à l’autre. Elles dépendent tout d’abord de la position diplomatique du pays concerné vis-à-vis du gouvernement français, comme en témoigne le tableau des taux de reconnaissance des vingt-quatre principaux consulats.
Dans son rapport, la Cimade souligne d’ailleurs que les deux pays les plus « coopératifs » sont la Roumanie et la Turquie, tous deux candidats à l’entrée dans l’Union européenne. Un constat similaire pouvait être dressé en 2002 : parmi les sept pays présentant le plus fort taux de reconnaissance de leurs ressortissants, on trouvait cinq pays candidats : la Roumanie, la Bulgarie, la Lituanie, la Pologne et la Turquie [7]. Pour prouver leur volonté de « coopération », certains consulats vont jusqu’à délivrer des laissez-passer pour des étrangers qui ne sont pourtant pas leurs ressortissants. Il n’est pas rare, par exemple, que la Roumanie reconnaisse des étrangers qui se sont déclarés moldaves, sans même avoir procédé à leur audition et il semble que l’Algérie fasse de même avec des Marocains. Certains étrangers peuvent ainsi être reconduits dans des pays qu’ils ne connaissent pas.
Pour les consulats qui ne répondent pas systématiquement aux injonctions des autorités préfectorales, il est parfois difficile d’établir avec certitude que l’étranger sous le coup d’une mesure d’éloignement est bien l’un de leurs ressortissants. Les représentations consulaires des pays de l’ex-Union soviétique (Georgie, Ukraine, Russie…) délivrent par exemple assez rarement de laissez-passer, non pas par volonté d’obstruction mais parce qu’elles ne parviennent pas toujours à savoir avec certitude s’il s’agit de l’un de leurs ressortissants. Au consulat de Turquie, en revanche, une enquête est systématiquement instruite avant que l’étranger n’arrive sous escorte policière pour l’entretien de reconnaissance. Les responsables du consulat se plaisent à expliquer qu’il y a des techniques pour reconnaître un Turc d’un Iranien ou d’un Irakien, « des expressions, des manières de parler, un regard, un accent particulier… » sont autant de signes qui les aident à prendre leur décision.
En violation de la Convention de Genève
Depuis 1998, ces techniques empiriques d’identification sont doublées d’une procédure de reconnaissance à partir des fichiers de l’état civil qui ont été informatisés mais qui comportent encore aujourd’hui une part d’incertitude. Plus généralement, le flou qui pèse sur les modalités d’identification des étrangers par les consulats engendre des pratiques très fluctuantes d’un pays à l’autre (voir tableau). Pour quelques pays comme l’Inde, l’Égypte, l’Iran, l’Irak ou la Palestine, le refus de délivrer le laissez-passer est la règle. Dans ces cas-là, le ministère de l’intérieur demande aux services préfectoraux de saisir le ministère des affaires étrangères, sans doute dans l’espoir de faire « basculer » ces derniers récalcitrants.
Les efforts déployés par les gouvernements successifs pour rendre plus effectives les mesures d’éloignement ont donc fini par porter leurs fruits. Les récents voyages de Nicolas Sarkozy en Chine, en Roumanie et au Mali n’ont pas été vains. Les consulats faisant preuve de « coopération » sont de plus en plus nombreux et les taux de reconduite à la frontière augmentent au fil des années. Une telle obstination à vouloir augmenter les taux de reconduite à la frontière s’effectue bien souvent au détriment des engagements pris par la France en matière de protection des réfugiés. On sait, par exemple, que certains demandeurs d’asile dont la première demande a été rejetée sont présentés au consulat de leur pays d’origine avant même d’avoir épuiser tous les recours auxquels ils ont droit. On est alors tenté de se demander si les étrangers éloignés vers certains pays comme l’Albanie, l’Algérie ou le Nigeria ne l’ont pas été en violation de la Convention de Genève qui impose en principe aux États signataires de ne pas refouler ceux qui demandent l’asile vers des frontières dangereuses [8]. ;
Les biais d’une enquête délicate
|
Notes
[1] Je tiens à remercier Lionel Claus, Ingeborg Verhagen et Jean-Claude Beba, intervenants pour la Cimade aux centres de rétention de Toulouse et de Nice, pour les précieux renseignements qu’ils m’ont fournis.
[2] Caroline Intrand, « La politique du « donnant-donnant » », Plein droit, n° 57, juin 2003, p. 26-28.
[3] Alexis Spire, « Une indignation oubliée », Plein droit, n° 50, juillet 2001, p. 20-23.
[4] Lorsqu’il n’existe pas de consulat en France comme pour le Surinam, l’étranger est retenu dix-sept jours en rétention puis est remis en liberté, faute de laissez-passer.
[5] Caroline Intrand, « La politique du « donnant-donnant » », Plein droit, n° 57, juin 2003, p. 26-28.
[6] Cf. Circulaire de la DLPAJ du 16 avril 2002 relative à la délivrance des laissez-passer consulaires, http://www.interieur.gouv.fr/ rubriques/b/b5_lois_decrets/02-00098/02- 00098.pdf.
[7] CIMADE, Centres et locaux de rétention administrative, Rapport 2003, p. 18.
[8] François Crépeau, Droit d’asile. De l’hospitalité aux contrôles migratoires, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1995, p. 142.

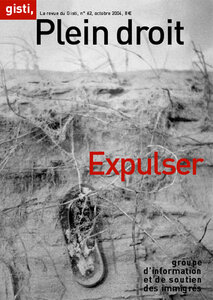
![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)










Partager cette page ?