Article extrait du Plein droit n° 44, décembre 1999
« Asile(s) degré zéro »
De la Bosnie au Kosovo
Mathieu Oudin
Juriste
En 1996, lors de son audition par la commission d’enquête sur l’immigration clandestine de l’Assemblée nationale(1), l’ancien directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), déclarait que la Convention de Genève « ne répondait en rien au conflit rwandais ni au drame du Burundi. Elle n’a servi à rien dans la guerre de Yougoslavie ».
Pourtant, conformément à l’article premier de la Convention de 1951, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui, « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut, se réclamer de la protection de ce pays ».
Ce bégaiement de l’histoire et l’amnésie qui l’accompagne ont eu pour réponse au Kosovo la répétition d’une politique d’accueil des réfugiés marquée par la même réticence et la même obsession du temporaire qui masquent une logique d’endiguement et de contrôle des flux migratoires. Or, une politique d’accueil des réfugiés ne peut se baser sur le principe du retour. C’est d’ailleurs pourquoi l’octroi de la qualité de réfugié entraîne la délivrance d’une carte de dix ans et la protection quasi absolue contre un renvoi dans le pays d’origine. Mais les réfugiés qui le souhaitent peuvent à tout moment renoncer à ce statut pour rentrer chez eux.
L’affirmation du directeur de l’OFPRA illustre bien le dilemme des autorités – OFPRA et Commission des recours des réfugiés – chargées d’accorder la protection aux réfugiés en application de la Convention de Genève de 1951. En effet, pour certains, comme M. Myard, membre de la commission d’enquête parlementaire déjà citée, la Convention de Genève aurait été conclue à un moment où il s’agissait de traiter les cas des personnes prises individuellement avec en mémoire les persécutions nazies. Les relations internationales ayant aujourd’hui changé de nature, surtout depuis la fin de la guerre froide, il n’y aurait plus que des migrations de peuples. La Convention de Genève serait donc un monolithe inadapté aux conflits actuels.
Le temps de l’accueil massif des victimes des régimes communistes du Sud-Est asiatique semble en effet bien loin. Or, le nombre de réfugiés accueillis par la France durant la première guerre de Yougoslavie puis celle du Kosovo n’a rien de massif et n’explique donc pas en quoi il serait incompatible avec un examen individuel des craintes.
Les craintes de persécutions
L’inadaptation alléguée de la Convention de Genève relève plus de l’interprétation qui en est faite que du texte lui-même ou du contexte du conflit. En effet, appliquées à la lettre au conflit des Balkans, les interprétations restrictives de la Convention de Genève qui ont été développées dans les années passées auraient abouti à rejeter les requêtes de bien des ex-Yougoslaves. La Commission des recours a donc été conduite à modifier partiellement sa jurisprudence pour pouvoir reconnaître leurs craintes de persécutions. Elle a ainsi été amenée à aller parfois au-delà du texte même de la convention. Mais cette souplesse dont a su faire preuve, non sans difficulté, la Commission ne peut que nous faire regretter la rigidité qu’elle a manifestée à l’égard des Algériens avant, finalement et tardivement, de reconnaître le caractère vain de leurs demandes de protection auprès de l’État algérien.
La situation de « guerre civile » qu’a connue l’ex-Yougoslavie est caractérisée par l’absence d’autorités publiques. La Commission des recours ne pouvait donc, d’une manière générale, appliquer sa célèbre jurisprudence qui considère que pour qu’une personne soit reconnue réfugiée, il faut que « l’agent de persécution » soit étatique, ou apporter la preuve de « la tolérance volontaire » des autorités.
Assouplissements de la jurisprudence
La Commission n’a pas non plus qualifié la situation qui régnait alors de « climat généralisé d’anarchie » comme elle l’avait fait pour exclure les demandeurs d’asile somaliens de la protection de la Convention de Genève. Elle a donc eu recours à la notion d’autorité de fait pour définir l’emprise exercée par les groupes qui contrôlaient des parties du territoire fédéral comme la République serbe autoproclamée de Krajina, celle de Bosnie ou encore celle de Croatie avec le Conseil de défense croate (HVO). En effet, la référence au pays dont la personne « a la nationalité » était devenue obsolète en raison de l’éclatement de la Fédération.
On voit donc bien que la Commission a dû et su adapter sa jurisprudence à la particularité de ce conflit. A cet égard, le conflit du Kosovo est plus simple et n’exige pas de telles constructions juridiques puisque l’agent persécutant est clairement identifié : l’État yougoslave et les milices paramilitaires qui lui sont affiliées. Le problème réside plutôt dans la définition de l’autorité qui protège et de son effectivité.
La nécessité de rattacher le demandeur du statut de réfugié à une nationalité, donc à un État qui le protège, a obligé la Commission des recours à des contorsions juridiques pour ne pas rejeter massivement les demandes de protection des requérants. En effet, un requérant serbe de Bosnie cherchant à échapper à l’enrôlement forcé dans les milices serbes ou aux menaces de la communauté musulmane devait démontrer l’impossibilité d’obtenir une protection des nouvelles autorités en Bosnie-Herzégovine et en Yougoslavie. Ainsi, à cause de l’éclatement de la Fédération, certains requérants devaient démontrer une double impossibilité, multipliant les risques de rejet de leur demande.
La Commission a, par la suite, assoupli sa jurisprudence pour considérer, comme elle l’a fait par exemple pour une femme bosniaque d’origine serbe, que, du fait de la partition entérinée par les accords de Dayton de 1995, elle ne pouvait retourner s’établir dans sa ville d’origine en Bosnie (« peuplée majoritairement par des Bosniaques musulmans ») ni en Republika Srpska où elle n’avait aucune attache.
Ainsi était substitué au lien national la notion bien floue « d’attache », non prévue par la Convention. Dès lors, cela signifiait que le fait, pour un requérant, d’avoir des membres de sa famille séjournant sur un territoire qui n’était pas le sien était un motif suffisant de rejet. Cette aberration fut rectifiée par la Commission qui considéra par la suite qu’il n’y avait pas lieu « de rechercher si le requérant aurait eu la possibilité de s’établir durablement » sur une autre partie du territoire.
Si cette jurisprudence ne s’applique pas aux Kosovars albanais, on peut néanmoins se demander dans quelle mesure des Serbes qui auraient été persécutés au Kosovo ne pourraient pas se voir opposer qu’ils pouvaient demander protection aux autorités yougoslaves. S’il est correct, sur un plan juridique, que les Serbes du Kosovo sont toujours juridiquement liés à l’État yougoslave, la garantie de leur accueil par Belgrade est autre.
La Commission a aussi été conduite à assouplir sa jurisprudence concernant les déserteurs qui ont été légion dans ce conflit. La question se posait de savoir si l’acte d’insoumission ou de désertion était politique par nature, et dans quelle mesure les condamnations pour désertion (cinq à vingt ans de prison en temps de guerre) et insoumission (un à dix ans de prison en temps de guerre d’après le code criminel yougoslave) étaient assimilables à des persécutions.
Le Conseil d’État a considéré que « quelle que fût la situation politique de l’ex-Yougoslavie en 1992, toute désertion n’y était pas nécessairement révélatrice de motif politique ou de conscience, et que si elle exposait les intéressés à des sanctions graves, celles-ci ne sauraient être regardées comme constituant des persécutions au sens de la Convention de Genève ».
On voit donc combien la désertion ou l’insoumission sont entourées d’un a priori négatif, alors que le refus de porter les armes est un acte politique essentiel qui porte directement atteinte à l’autorité de l’État(2). Cette lecture restrictive de la Convention a été partiellement assouplie par l’ajout d’un nouveau motif, à savoir les raisons de conscience qui concernent les personnes issues d’une famille mixte et dont l’enrôlement aurait pour conséquence de devoir combattre contre des compatriotes.
Pas d’asile pour les déserteurs serbes
En 1998, la Commission a élargi sa position sur le motif de conscience en admettant que si la désertion « est dictée par des raisons de conscience […] interdisant [à l’intéressé] de participer à des actions relevant du champ d’application de l’article 1 F de la Convention de Genève » – article qui concerne les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies –, la qualité de réfugié peut lui être reconnue. Cette jurisprudence, qui a été établie à propos d’un déserteur algérien, devrait pouvoir s’appliquer aux déserteurs serbes. Toutefois, jusqu’à aujourd’hui, la Commission des recours a rejeté toutes les demandes des déserteurs serbes liées au conflit du Kosovo au motif que les causes de leur désertion ne relevaient pas de la Convention de Genève. Leurs demandes d’asile territorial ont été aussi rejetées par le ministère de l’intérieur au motif que leurs craintes de persécution invoquées provenaient de l’État yougoslave et non d’agents non étatiques…
Mais le point essentiel de la jurisprudence ne repose pas tellement sur les causes de persécutions qui, en dehors de la question des déserteurs, sont souvent évidentes, mais beaucoup plus sur la question de la protection. En effet, dès lors que le requérant a réussi à apporter la preuve de son appartenance à la communauté Kosovare, le cœur du problème sera déplacé sur l’actualité de ses craintes.
On peut donc se demander si la présence d’une force internationale au Kosovo ne sera pas utilisée par la Commission pour justifier une absence de craintes en cas de retour, et dans quelle mesure elle admettra que les requérants peuvent « se prévaloir utilement de la protection de la communauté internationale ». A ce sujet, il est intéressant de remarquer que, pour les Yougoslaves, la Commission ne se contente pas de mentionner l’existence d’une protection mais s’interroge sur son efficacité.
La Convention de Genève permet donc bel et bien d’assurer la protection des réfugiés issus du déchirement de la Yougoslavie. Le principal obstacle réside plutôt dans l’interprétation restrictive qui en est faite. La Commission des recours et le Conseil d’État ont toutefois été amenés à assouplir leur position du fait de l’ampleur des crimes contre l’humanité qui ont été commis et qualifiés comme tels par la communauté internationale.
Jouer avec le temps
Quelle qu’ait été l’horreur du conflit yougoslave (de 150 000 à 300 000 victimes, 3 millions de personnes déplacées), le symbole de Sarajevo, la découverte des camps de détention en Bosnie ou la chute de Srebrenica, aucun élément de cette situation générale n’est suffisant pour être reconnu réfugié, comme l’a rappelé le Conseil d’État pour justifier le rejet de la requête d’une Bosniaque de Sarajevo en 1997(3).
Il faut donc s’inquiéter du sort qui sera réservé à de nombreux Kosovars demandeurs d’asile, maintenant que l’intensité du conflit est retombée(4). Il y a fort à craindre qu’un certain nombre d’entre eux, victimes d’un conflit généralisé, n’obtiennent pas une protection qui paraissait évidente au plus fort du conflit. En effet, sauf à examiner leurs craintes au regard des autorités yougoslaves dont ils sont toujours des nationaux, il est à prévoir que ces craintes ne seront plus considérées comme actuelles compte tenu de la présence de la force internationale au Kosovo.
La clause prévue dans la Convention de Genève (1C5) pour les rescapés de l’Holocauste qui ne voulaient plus retourner dans leur pays d’origine malgré le changement de contexte politique n’est appliquée aux requérants qu’avec beaucoup de parcimonie et de réticence par la Commission. L’exemple du Rwanda a été particulièrement éclairant à cet égard. En effet, suite au renversement du pouvoir en place par le Front patriotique rwandais en août 1994, la Commission a commencé à rejeter les demandes de statut des Tutsis ayant échappé au génocide au motif qu’ils n’avaient plus de craintes actuelles. Après certaines tergiversations elle a fini par leur appliquer la clause de l’article 1C5 de la Convention de Genève.
La lenteur du traitement de ces dossiers par l’OFPRA n’est pas entièrement étrangère à l’ensemble de ces interrogations. Plus le temps passe, plus le conflit s’apaise et plus le rejet des demandes de statut de réfugié des Kosovars sera facile à justifier.
(1) Assemblée nationale, commission d’enquête, Rapport sur l’immigration clandestine et le séjour irrégulier des étrangers en France, 1996, n° 2699, p. 263.
(2) Objecteurs de conscience, insoumis et déserteurs des pays issus de l’ancienne Yougoslavie ; un statut indéterminé, 1995, Bureau européen de l’objection de conscience, Bruxelles.
(3) « que si la situation générale régnant alors à Sarajevo pouvait relever des craintes de persécutions au sens des stipulations de l’article 1, A, 2) de la Convention de Genève, Mlle S. n’alléguait pour ce qui la concerne aucune crainte de persécution de caractère personnel, mais fondait ses craintes uniquement sur la situation générale régnant dans cette ville » (CE, SSR, 12 mai 1997 STRBO).
(4) Débuté en mars 1998 par le déclenchement, par les autorités serbes, du plan « Fer à cheval », ce conflit a provoqué la déportation de 800 000 Kosovars albanais en quelques mois et l’instauration d’une politique de terreur et de violence attestée par la découverte, au fur et à mesure des investigations du tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), de très nombreux charniers.

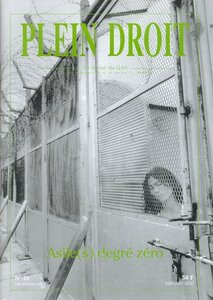
![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)










Partager cette page ?