Article extrait du Plein droit n° 64, avril 2005
« Étrangers devant l’école »
Etudiants : un difficile accès à l’emploi
Lou Moulin
Membre du Gisti.
Une thèse soutenue en 1899 en plein débat sur la « protection du travail national » relevait : « Le nombre énorme d’étrangers qui se livrent à [des] études désintéressées est le meilleur argument qu’on puisse produire en faveur de notre enseignement national : ces jeunes gens savent (…) qu’ils ne pourront arriver à aucune position rétribuée officiellement, que même certaines carrières libérales ne leur seront pas accessibles (…) » [1]. Cette vision va régir la politique française d’accueil des étudiants étrangers pendant la majeure partie du XXe siècle, avec néanmoins, selon les périodes, des oscillations entre une politique strictement protectionniste et une tendance davantage tournée vers l’ouverture.
Les circulaires ministérielles visant à assouplir les conditions d’accès des étudiants étrangers au travail en France qui se sont succédé ces dernières années s’inscrivent dans une logique en tous points comparables : l’étudiant étranger est autorisé à travailler en France, y compris au-delà de ses études, si cela présente un « intérêt » pour les entreprises « françaises » et le prestige de l’enseignement supérieur français face à la concurrence anglo-saxonne. Ces instructions ministérielles ont certes assoupli les modalités d’accès des étudiants étrangers à une activité salariée, notamment en cours d’études, et viennent écorner à la marge le sacro-saint principe – affirmé par tous les gouvernements depuis vingt-cinq ans – suivant lequel « l’étudiant étranger a vocation à mettre ses compétences au service de son pays d’origine à l’issue de ses études » [2]. Mais prime toujours l’approche utilitariste de « l’intérêt de la France ».
Pour pouvoir travailler tout en poursuivant ses études, l’étudiant étranger doit déposer une demande d’autorisation provisoire de travail (APT) auprès des services de la main-d’œuvre étrangère de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) de son lieu de résidence [3]. Cette autorisation pourrait légalement être refusée si le niveau de chômage dans l’emploi visé était trop important dans le bassin d’emploi ou le département concerné. C’est ce qu’on appelle « l’opposabilité de la situation de l’emploi ». Néanmoins, depuis 1998, le ministre a recommandé aux directions du travail de n’opposer la situation de l’emploi que « dans des cas exceptionnels » et d’autoriser les étudiants à travailler dès leur première année d’études [4]. L’emploi doit cependant rester accessoire aux études, en pratique ne pas dépasser vingt heures en moyenne par semaine.
Par ailleurs, une procédure allégée de délivrance des APT, prévoyant notamment la remise d’une attestation provisoire dès le dépôt de la demande afin de permettre à l’étudiant de travailler immédiatement a été mise en place. Ce dispositif constitue un succédané au fait que, débordées, les DDTE ne peuvent instruire les demandes dans des délais satisfaisants. Il préconise aussi que le renouvellement de l’APT intervienne « rapidement » afin d’éviter que l’étudiant soit obligé d’interrompre son travail et se retrouve, de ce fait, « dans une situation de précarité préjudiciable à la poursuite de ses études » [5]. Mais, faute d’avoir renforcé les moyens des services de main-d’œuvre étrangère qui font souvent figure de « dernière roue du carrosse », ce dernier souhait est très souvent resté un vœu pieux. Pourtant, pour alléger la charge de ces services, on pourrait au moins assouplir la durée légale maximale des APT, qui est actuellement de neuf mois et qui contraint l’étudiant – ou le travailleur temporaire – même lorsqu’il présente à la direction du travail un contrat de travail couvrant l’année universitaire, de solliciter en cours d’année le renouvellement de l’autorisation provisoire de travail. Le risque que court alors cet étudiant est que le délai d’instruction de la demande ne l’oblige à interrompre son activité salariée avant que cette autorisation soit renouvelée. Et s’il travaille, ne serait-ce que temporairement, sans autorisation, il s’expose à un refus de renouvellement de l’APT pour violation de la réglementation du travail.
Des démarches longues et inutiles
D’ailleurs, dans la pratique, il n’est pas rare de voir des étudiants étrangers qui exercent nécessairement une activité en parallèle de leurs études (médecins attachés associés, allocataires de recherche ou ATER, etc.), être munis, par les directions du travail, d’autorisations de travail d’une durée d’un an, en dérogation de la réglementation. Preuve supplémentaire que cette restriction n’est pas opportune.
Déjà, en 1997, le rapport Weil critiquait la procédure de délivrance des autorisations provisoires de travail qui entraîne des « démarches longues » pour l’étudiant et du « travail inutile » pour les services, pour l’instruction de plusieurs dizaines de milliers de demandes qui sont quasiment toujours accordées [6]. Dans la mesure où les instructions elles-mêmes ne prévoient de refuser qu’« exceptionnellement » les APT aux étudiants, la solution la plus simple – et la plus rationnelle administrativement – serait de supprimer purement et simplement le système des autorisations provisoires de travail et de permettre ainsi l’accès libre des étudiants étrangers aux emplois à mi-temps. Il n’y a nulle impossibilité à instituer un tel régime puisque c’était celui qui était applicable aux étudiants algériens jusqu’au 1er janvier 2003, en application des accords franco-algériens. L’argument de la « responsabilisation » de l’étudiant étranger par l’existence de cette procédure ne tient pas : l’activité salariée doit rester accessoire aux études. Si tel n’est pas le cas, il peut se voir opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour par la préfecture par la remise en cause de la réalité de ses études. Et, en la matière, la meilleure sanction – et la seule qui vaille pour tous les étudiants – c’est celle des examens universitaires.
D’improbables régularisations
Le parcours à suivre pour passer du statut « étudiant » (carte de séjour temporaire pour études) à un statut salarié (carte de séjour temporaire « salarié » ou délivrance d’une autorisation provisoire de travail avec une carte de séjour « travailleur temporaire ») est semé d’embûches. Certes, rien n’interdit à l’étudiant de solliciter cette régularisation. Mais, compte tenu du fait que la situation de l’emploi lui est en principe opposable, sa demande a peu de chances d’aboutir. Un examen des statistiques en témoigne : alors que les préfectures ont délivré, en 2002, près de 147 000 cartes de séjour temporaire portant la mention « étudiant », la même année, seuls 1913 ont obtenu un changement de statut vers une carte de séjour « salarié » ou non salarié [7]. Dans les faits, les directions départementales du travail – et les étudiants étrangers eux-mêmes – ont tellement intégré cette donne que tout un processus d’éviction, de sélection et de renoncement se met en place en amont de la demande et à l’occasion des premières démarches aux guichets des DDTE ou des préfectures.
Malgré ces filtres, le nombre de demandes rejetées demeure non négligeable, qu’elles soient motivées par l’opposition de la situation de l’emploi ou après un contrôle pour non-respect de la réglementation du travail par l’employeur. Les instructions ministérielles visant à infléchir la position jugée « trop restrictive » d’opposabilité de la situation de l’emploi ne semblent pas avoir réellement modifié les pratiques. Elles devraient tout juste permettre à l’étudiant étranger, dans des conditions très encadrées, d’obtenir un changement de statut lorsqu’il présente une proposition d’embauche émanant d’une entreprise « française » « qui trouverait dans ce recrutement le moyen de satisfaire un intérêt technologique et commercial ».
A travers les étudiants rencontrés, le Gisti a constaté une certaine variabilité des pratiques selon les départements franciliens. En théorie, les dossiers devraient tous suivre une procédure standardisée sur la base d’un formulaire « CERFA » comprenant un contrat de travail et un engagement de l’employeur à verser la contribution forfaitaire. L’étudiant doit d’abord déposer son dossier rempli à la préfecture qui examine sa recevabilité au regard de la condition de régularité du séjour et d’absence de trouble à l’ordre public. A ce stade, d’une préfecture à l’autre (et même parfois entre sous-préfectures d’un même département), les pratiques et les pièces demandées varient.
Mais les différences existent surtout après transmission du dossier aux directions départementales du travail. On constate d’abord des délivrances fréquentes du statut de « travailleur temporaire » en lieu et place de la carte de séjour « salarié ». Cette pratique semble, là encore, ignorer la circulaire qui mentionne uniquement la délivrance d’une carte « salarié ». Mais cette pratique s’affranchit surtout des conditions légales d’octroi du statut de « travailleur temporaire », pourtant strictement définies par le code du travail. Ce statut est en effet destiné au travailleur étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé, « pendant une période dont la durée initialement prévue n’excède pas un an », une activité qui « par sa nature ou les circonstances de son exercice » présente un caractère temporaire.
Seul le caractère précaire du CDD initial devrait donc conduire les DDTE à n’octroyer à l’étudiant que le statut de travailleur temporaire. Il s‘agit en effet, dans l’esprit de la réglementation applicable à la main-d’œuvre étrangère, d’un statut carentiel, par défaut de celui de « salarié ». Dès lors que le CDD initial est supérieur à un an ou, même s’il est inférieur à un an, n’a pas de caractère précaire (comme c’est le cas par exemple des médecins attachés associés dans les hôpitaux publics qui font l’objet chaque année d’une nomination pour un an pour des périodes de plusieurs années), le demandeur devrait bénéficier d’une carte de séjour « salarié ».
Or, il apparaît que la plupart des DDTE octroient le statut de « travailleur temporaire » dès lors que le contrat présenté est à durée déterminée, et celui de « salarié » s’il est à durée indéterminée. Il apparaît même que certaines DDTE accordent systématiquement une carte « travailleur temporaire », même en cas de CDI, à tous les étrangers sollicitant un premier changement de statut, ce qui implique, au renouvellement de l’APT, de reprendre toute la procédure, et permet à la direction départementale du travail d’effectuer un contrôle de la réglementation du travail.
La stratégie administrative consistant à « régulariser » un étudiant étranger en lui délivrant une carte de séjour « travailleur temporaire » plutôt qu’une carte « salarié » a d’importantes conséquences pratiques pour le demandeur et le place dans de véritables impasses. D’abord, à la différence du statut « salarié », le statut de « travailleur temporaire » n’ouvre pas droit au régime de l’assurance chômage et au maintien du droit au séjour pour en bénéficier [8].
Ensuite, le statut de « travailleur temporaire » permet aux pouvoirs publics de précariser le séjour de ces étrangers en les plaçant dans une plus grande situation de subordination à leur employeur (si le CDD initial n’est pas renouvelé, l’étranger perd tout droit au séjour et à indemnisation chômage) et de dépendance à l’égard du pouvoir discrétionnaire de l’administration (tout renouvellement de l’APT tous les neuf mois, tout changement d’employeur sont de nouveau soumis au contrôle et à l’appréciation de la préfecture – au regard des règles de séjour et d’opposabilité de l’ordre public – et de la DDTE – au regard de l’examen du respect de la réglementation du travail et d’opposabilité de la situation de l’emploi, cette dernière pouvant varier dans le temps, pour un même emploi, suivant la conjoncture et les statistiques du chômage). Ce développement du statut de « travailleur temporaire » au détriment d’un statut plus stable s’inscrit dans la tendance générale du droit des étrangers visant à privilégier les statuts juridiques dérogatoires et précaires conditionnés à l’emploi et assujettissant davantage l’étranger à l’employeur [9]. Une tendance utilitariste confirmée par les annonces du ministre de l’intérieur Dominique de Villepin, courant décembre 2004, en faveur d’une « immigration régulière choisie » par le biais de « contrats à durée déterminée ».
Enfin, troisième conséquence, le fait d’accorder le statut de travailleur temporaire au lieu du statut « salarié » n’est pas sans incidence financière. Lui ou son employeur se voient en effet contraints, à chaque renouvellement de l’APT, de s’acquitter de redevances et contributions forfaitaires, alors que celles exigibles des travailleurs « salariés » ne le sont qu’une seule fois, au moment de la première délivrance. Les pratiques semblent en outre variables en ce qui concerne les sommes exigibles des « travailleurs temporaires », aussi bien lors de la première délivrance que lors des renouvellements, ce qui a pour effet de dissuader l’employeur de prolonger le contrat de travail.
Dissuader d’éventuels employeurs
Cet effet dissuasif est aussi renforcé lorsque certaines DDTE ont une politique de contrôle quasi-systématique des entreprises qui veulent recruter un étudiant étranger à l’occasion d’un changement de statut. Un contrôle qui s’étend au respect des règles de déclaration d’embauche, d’hygiène et sécurité, de temps de travail ou de représentation du personnel… De quoi faire réfléchir tout employeur voulant embaucher à plein temps un étudiant qui a déjà travaillé ou fait un stage en son sein. Et pour peu que l’étudiant ait eu la « mauvaise » idée d’accepter de travailler à temps plein, et non plus à mi-temps, sans attendre l’autorisation de travail qui n’est souvent délivrée qu’après de longs mois, la DDTE opposera un refus de changement de statut pour… non respect de la réglementation du travail.
On peut aussi constater que les critères dérogatoires à l’opposabilité de la situation de l’emploi peuvent être utilisés à rebours, c’est-à-dire en défaveur de l’étudiant étranger. Les instructions ministérielles de janvier 2002 ont posé différents critères « indicatifs » permettant aux DDTE de se prononcer sur la demande et d’accorder – ou non – l’autorisation de travail, en dérogation de l’examen « strict » de la situation de l’emploi. Outre la « motivation de l’entreprise » (détaillée dans une lettre de motivation) visant à justifier de « l’apport » du jeune diplômé étranger à l’entreprise, notamment eu égard à sa maîtrise des langues étrangères ou sa connaissance du tissu industriel et commercial voire des structures administratives de son pays d’origine, les DDTE sont invitées à effectuer un contrôle très attentif de l’adéquation entre le niveau de diplômes et l’emploi postulé.
Il s’agit-là d’un contrôle d’un type nouveau pour les DDTE qui, jusque là, avaient pour seules missions de veiller au respect de la réglementation du travail et d’examiner la situation de l’emploi à travers le niveau de chômage dans l’emploi postulé dans le département, mais sans avoir à connaître le cursus ou les diplômes de l’étudiant. Ainsi, un étudiant étranger titulaire d’un 3e cycle pouvait très bien obtenir un changement de statut comme cuisinier dans un restaurant, dès lors que les statistiques ANPE étaient favorables. Mais, alors même que le critère de l’adéquation du niveau de diplôme à l’emploi postulé devrait constituer uniquement une « grille de lecture » pour déroger favorablement à la situation de l’emploi lorsque cette dernière est mauvaise pour le type d’emploi demandé, il est parfois utilisé, sans fondement légal, pour opposer un refus de changement de statut si les études ne correspondent pas à l’emploi. Ainsi, un ingénieur télecom étranger ne pourra obtenir une autorisation pour un simple emploi de « technicien » ; une sagefemme ne pourra pas prétendre à un emploi de « simple » assistante à domicile ou d’aide soignante.
Les instructions ministérielles appelaient à plus de mansuétude, mais la lecture qui en a été faite a stérilisé toute avancée. Dès lors, on comprend qu’elles n’aient eu apparemment aucun effet sur le nombre de changements de statut [10]. Mais était-ce le but poursuivi ? L’objectif n’était-il pas plutôt, après des années de discours négatifs sur l’immigration et de sacralisation de la préférence nationale puis communautaire à l’emploi, d’envoyer un ballon d’essai en direction des services et de l’opinion publique pour tester la recevabilité d’un nouvel argument utilitariste sur le besoin de travailleurs pour les entreprises françaises ? ;
Notes
[1] R. BERNARD de JANDIN, Des professions que les étrangers peuvent exercer en France, Thèse Faculté de droit de Paris, Pédone, 1899, n°138, p.132 et n°192, pp.176-177.
[2] Suite au rapport « Dischamps » (Rapport sur l’accueil des étudiants étrangers et les échanges avec les universités des autres pays, Conférence des Présidents d’Université, 1977), ce credo est posé pour la première fois dans la circulaire du ministre de l’Intérieur du 12 décembre 1977, dite circulaire « Bonnet ».
[3] Pour le détail de cette procédure cf. GISTI, « Les droits des étudiants étrangers en France », Les Cahiers juridiques, 2ème édition à paraître en 2005.
[4] Circulaire du 9 juillet 1998 du ministre de l’Emploi et de la solidarité relative à la délivrance des APT aux étudiants étrangers, BO min. Emploi, n°32/98.
[5] Circulaire n°2002-25 du 15 janvier 2002 relative à la délivrance et au renouvellement des autorisations de travail aux étudiants étrangers, BO du Travail, Emploi et de la Formation professionnelle, n°2002-5.
[6] P. WEIL, Mission d’étude…, op. cit., p.94.
[7] Source : ministère de l’intérieur, AGDREF.
[8] En application de l’article R. 341-1-3 du code du travail, l’étranger bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire « salarié » a le droit, s’il perd involontairement son emploi à une prolongation de son titre de séjour d’un an et ce jusqu’à ce qu’il soit en fin de droits. Or, un tel mécanisme n’est pas prévu au bénéfice des « travailleurs temporaires ». Saisi de cette difficulté, le Conseil d’État n’a pas jugé utile de constater que ce régime constitue une discrimination, alors même qu’ils cotisent à l’assurance chômage (CE 29 décembre 2000 Gisti, n°210231, au Recueil)
[9] Voir Plein droit « Immigrés, mode d’emploi » n° 61, octobre 2004.
[10] Le nombre de changements de statut (ou « régularisations »), toutes catégories confondues, est passé de 4485 en 2001 à 3266 seulement en 2003 (source : OMI)

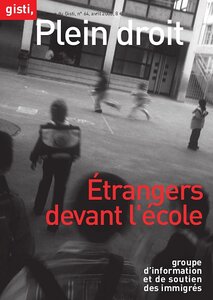
![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)










Partager cette page ?