Article extrait du Plein droit n° 28, septembre 1995
« Les nouvelles batailles de Poitiers »
La voie de l’exil
Xavier Creach et Jean-Pierre Alaux
La politique française de maîtrise des flux migratoires et son arsenal de mesures sécuritaires foudroient les Algériens dans leur recherche d’un pays d’accueil. Il ne faut pas y voir le résultat d’une discrimination particulière à leur encontre. Ces obstacles sont dressés au devant de tous ceux qui voient dans la France un port d’attache pour les « exclus des droits de l’homme ».
La volonté du gouvernement français de prévenir toute migration clandestine s’est traduite, ces dernières années, par la multiplication des mesures susceptibles d’interdire l’accès au territoire. De telles dispositions s’avèrent particulièrement cruelles pour les réfugiés, puisque la procédure tendant à la reconnaissance de leur statut ne peut être entamée que s’ils se trouvent déjà en France.
La première et la plus dissuasive de ces mesures est l’imposition d’un visa d’entrée pour les ressortissants de presque tous les pays hors Union européenne. Jusqu’en 1986, les Algériens en étaient pourtant dispensés, mais le décret du 30 octobre 1986 est venu leur imposer cette condition. Les candidats à l’exil doivent donc obtenir un visa des autorités françaises.
Alors qu’en 1989, quelque 800 000 de ces « billets d’entrée » avaient été délivrés, leur nombre est tombé à 500 000 en 1990, à 300 000 en 1993, pour atteindre 100 000 environ en 1994. De surcroît, à la suite de l’attentat du 3 août 1994 qui a coûté la vie à trois agents consulaires français en poste à Alger, les consulats d’Alger, d’Oran et d’Annaba ont été fermés. Pour pallier cette fermeture, un Bureau des visas algériens (BVA) a été ouvert le 6 octobre dernier à Nantes.
Les candidats au voyage doivent donc désormais quêter la délivrance de ce document par courrier après s’être préalablement procuré l’un des formulaires de demande en principe disponibles dans les wilayas (préfectures), les services sociaux, les universités, les agences d’Air France ou d’Air Algérie, et la compagnie de navigation SNCM. En réalité, pour cause de pénurie réelle ou artificielle, c’est souvent au marché noir qu’on trouve aujourd’hui ces documents, contre des sommes d’argent non négligeables. Le formulaire standard ne prévoit ni l’exil ni le besoin de protection parmi les motifs préétablis. Les victimes de persécutions cocheraient-elles la case correspondante si elle existait, dans un pays où le courrier est surveillé par la police comme par les islamistes ? Rien n’est moins sûr. Dans ces conditions, l’adjonction d’une lettre explicative au dossier paraît plus encore périlleuse.
De ce fait, les motifs des demandes de visas sont d’une extraordinaire banalité au regard de la situation dans le pays, ce qui facilite grandement les refus [1].
Des conséquences mortelles
Les soixante-dix fonctionnaires du service des visas de Nantes traitent quotidiennement entre 1 000 et 3 000 demandes. La majorité des dossiers essuient des refus pour défaut de pièces justificatives, sans que les intéressés sachent lesquelles, quand ils ont la chance de recevoir une réponse.
Selon des données invérifiables, environ 250 visas seraient délivrés chaque jour, principalement à des hommes d’affaires et à des chefs d’entreprise ou à des cadres. Autrefois, en temps de paix civile, on en comptait 2 500, quotidiennement attribués par les agents consulaires en poste sur place.
Les refus de visas peuvent avoir des conséquences dramatiques quand ils concernent des personnes menacées dans leur vie et dans leurs libertés. Pour n’être pas le seul, le cas d’Abderrahmane Fardeheb reste exemplaire : professeur à l’Institut des sciences économiques d’Oran, il était invité à venir enseigner à l’université de Grenoble à partir du 1er octobre 1994. Après une première demande de visa infructueuse en août 1994, il réitère sa démarche en septembre. Mais la lenteur du BVA n’ayant d’égale que la promptitude des tueurs du GIA, il est abattu le 26 septembre [2].
Pour les plus aventureux, il reste la voie de l’immigration clandestine pour gagner la France et y solliciter l’asile. Toutefois, atteindre la frontière ne saurait suffire. Parmi les 57 000 étrangers refoulés en 1993 aux frontières terrestres, aériennes et maritimes figuraient 5 300 Algériens. Il n’y aurait eu que trois demandes d’asile d’Algériens enregistrées aux frontières françaises cette année-là, et le même nombre au cours du premier semestre 1994.
18% de statuts de réfugiés en 1994…
Initialement peu nombreux à solliciter le statut de réfugié, les Algériens hésitent moins à demander à bénéficier de la protection définie par la Convention de Genève de 1951 au profit des persécutés.
Ils ont été 619 à saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en 1992 ; 1 099 en 1993 ; et 2 303 en 1994, mais très peu se sont vu accorder une protection : 15 ont été reconnus réfugiés en 1992 sur 504 décisions rendues, soit un taux reconnaissance de 2,98 % en 1993 ; 14 statuts pour 879 décisions (2 %) ; en 1994, 18 statuts pour 1 451 décisions (1,24 %). Ces résultats sont la conséquence d’une interprétation restrictive de la Convention de Genève.
Les demandeurs d’asile algériens appartiennent à deux catégories politiques distinctes : ceux qui craignent des persécutions de la part de l’État algérien et ceux qui fuient les groupes islamistes armés. Les premiers, généralement des membres actifs ou des sympathisants de partis islamistes, sont susceptibles d’être reconnus réfugiés en application de l’article I A de la Convention de Genève, sous réserve qu’ils n’aient pas commis de crimes graves de droit commun, c’est-à-dire qu’ils ne tombent pas sous le coup de la clause d’exclusion de l’article I F (b) ou d’une autre de ces clauses contenues dans l’article I F.
On peut présumer que si, pour la plupart, les membres actifs de l’Armée islamique du salut (AIS), du Groupe islamique armé (GIA) ou du Mouvement islamique armé (MIA) sont visés par les clauses d’exclusion, il n’en est pas de même pour leurs sympathisants. De fait, un membre du Front islamique du salut (FIS) a été reconnu réfugié par la Commission des recours des réfugiés (CRR) le 20 juillet 1993, alors qu’un membre du bureau exécutif du même parti a été débouté le 29 juin 1994 pour avoir couvert des actes susceptibles d’être regardés comme des crimes graves de droit commun.
Quoi qu’il en soit, les demandes émanant d’islamistes constituent l’infime partie des demandes algériennes.
Quant à ceux qui ont été persécutés ou craignent de l’être par des groupes islamistes, ils sont presque systématiquement rejetés par l’OFPRA et par la CRR au motif que leur demande n’entrerait pas dans le champ d’application de la Convention de Genève, les craintes qu’ils éprouvent ne mettant pas en cause les autorités étatiques algériennes.
Pendant longtemps, la CRR a déduit de l’article 1 A (2) que les persécutions qui n’émanent pas des autorités publiques du pays d’origine ne peuvent ouvrir droit à la qualité de réfugié. Néanmoins, dans l’arrêt Duman de la CRR du 3 avril 1979 et surtout dans l’arrêt Dankha du Conseil d’État du 27 mai 1983, ce dogme a été infléchi puisque aujourd’hui des persécutions émanant de groupes privés peuvent être prises en considération pourvu qu’elles aient été « encouragées ou tolérées volontairement par l’autorité publique, de sorte que l’intéressé n’est pas effectivement en mesure de se réclamer de la protection de celle-ci ».
…au moyen d’une interprétation isolée
Il ne s’agit cependant pas là d’une exception à la règle selon laquelle les persécutions doivent émaner des autorités gouvernementales car, dans de telles hypothèses, l’État se rend complice et peut dès lors être assimilé à l’auteur des persécutions par son abstention. C’est sur ce fondement que les sections réunies de la CRR ont reconnu réfugiée, dans la décision Elkebir du 22 juillet 1994, une jeune femme occidentalisée. Le même raisonnement a été appliqué dans deux décisions du 17 février 1995 à une avocate – Dalila Meziane – qui s’était illustrée dans la défense de la condition de la femme, et à un magistrat dont l’indépendance déplaisait à la fois au pouvoir en place et aux mouvements islamistes. De telles décisions restent exceptionnelles et ne s’appliquent pas aux policiers algériens lassés des méthodes que leur imposent leurs supérieurs. L’État français leur refuse toute protection.
Par crainte d’un afflux massif, la CRR n’ose pas aller au bout de son raisonnement et admettre que devraient être reconnus réfugiés tous ceux dont l’État ne peut assurer la protection, conformément à la lettre de la Convention de Genève qui n’opère aucune distinction parmi les auteurs de persécutions. L’esprit de la Convention de Genève pousse également à une telle interprétation. La protection internationale qu’elle définit correspond à un palliatif à l’absence de protection dans le pays d’origine. Dès lors, il importe peu que la carence de protection étatique soit ou non due à une volonté délibérée de nuire.
Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) préconise du reste une telle interprétation, dans son Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié. Il y est stipulé au paragraphe 65 que l’« on entend normalement par persécution une action qui est le fait des autorités d’un pays. Cette action peut également être le fait de groupes de la population qui ne se conforment pas aux normes établies par les lois du pays. À titre d’exemple, précise ce guide, on peut citer l’intolérance religieuse, allant jusqu’à la persécution, dans un pays par ailleurs laïc mais où d’importantes fractions de la population ne respectent pas les convictions religieuses d’autrui. Lorsque des actes ayant un caractère discriminatoire grave ou très offensant sont commis par le peuple, ils peuvent être considérés comme des persécutions s’ils sont sciemment tolérés par les autorités ou si les autorités refusent ou sont incapables d’assurer une protection efficace ». Le HCR a réaffirmé sa position dans un document du 23 janvier 1995 où il est indiqué que « les demandeurs d’asile qui affirment de façon crédible être menacés par des militants de groupes islamiques devraient normalement obtenir le statut de réfugié » [3].
Onction juridique pour décision politique
Dans son avis du 11 janvier 1995, la Commission nationale consultative des droits de l’homme demande qu’une telle interprétation soit adoptée par les autorités françaises. La CRR et l’OFPRA restent pourtant sourds à tous ces appels et s’enferment dans une interprétation restrictive, dont l’apparence juridique ne suffit pas à dissimuler le caractère politique et diplomatique. La CRR, qui feint de vouloir appliquer scrupuleusement la Convention de Genève et semble regretter de ne pouvoir protéger les Algériens en raison de contraintes juridiques, dispose pourtant d’autres moyens légaux pour les reconnaître réfugiés. Il lui suffirait, par exemple, d’admettre que les femmes en Algérie constituent un « groupe social » au sens de l’article premier de la Convention, comme le font notamment le Canada et les Pays-Bas qui voient en elles « un groupe particulièrement exposé ». De même, pour les fiefs islamistes dans lesquels les forces gouvernementales ne sont plus à même d’assurer le moindre contrôle, la CRR pourrait appliquer la notion d’« autorité de fait », comme cela avait été le cas pour le Liban, l’Afghanistan et la Yougoslavie. Une telle notion permet de regarder comme réfugiées les personnes persécutées par ces autorités de fait quand bien même l’État ne tolérerait pas ou n’encouragerait pas ces persécutions.
Enfin, dans la recommandation E. de l’acte final de la Convention de Genève, les plénipotentiaires exprimaient l’espoir que les États accorderaient « aux personnes se trouvant sur leur territoire en tant que réfugiés et qui ne seraient pas couvertes par les dispositions de la présente convention, le traitement prévu par cette convention ». On en est loin.
Un asile territorial fantomatique
Il reste aux déboutés à solliciter l’« asile territorial », en principe également accessible à ceux qui ne souhaitent pas obtenir la protection de la Convention de Genève. Pour des raisons historiques et psychologiques, beaucoup d’Algériens renâclent à bénéficier du statut de réfugié, notamment parce qu’ils veulent conserver la possibilité de se rendre dans leur patrie. Or, les modalités de cet asile territorial – protection purement nationale des persécutés – n’ont jamais été définies. Il semble que les préfectures se soient vu accorder une certaine marge de manœuvre par la très secrète circulaire du 23 décembre 1993, qui n’a jamais été publiée (lire également « Ces circulaires qui ne tournent pas rond » dans ce même numéro).
Selon toute vraisemblance, les préfectures pourraient transmettre le dossier des Algériens qu’elles estiment relevables de l’asile territorial à un comité interministériel tripartite (ministères des affaires étrangères, de l’intégration et de l’intérieur) qui donnerait son feu – vert ou rouge – à la délivrance d’un titre de séjour, pour peu que la personne soit entrée régulièrement en France. La solution, volontairement précaire, reste très provisoire puisque les titres de séjour les plus couramment délivrés ne sont valables que trois mois, renouvelables. Dans de rares cas, ils sont de six mois avec droit au travail, si l’intéressé peut produire un certificat d’embauche. Le nombre d’Algériens ayant pu bénéficier d’une telle clémence reste inconnu. En septembre 1994, l’ancien ministre de l’intérieur, Charles Pasqua, avait avancé le nombre de 10 000 puis de 18 000, chiffres à prendre avec précaution. Quelques mois plus tôt, le 29 janvier, à « L’heure de vérité », le même avait affirmé que 500 Algériens avaient été reconnus réfugiés en 1994, alors que l’OFPRA n’en dénombrait que dix-huit…..
Pour les Algériens déboutés du droit d’asile et pour ceux auxquels les préfectures ont refusé de délivrer un titre de séjour, reste à affronter la dernière procédure, celle de la reconduite à la frontière. Quelque 2 673 Algériens ont ainsi été rapatriés de force dans leur pays en 1993, et environ 3 500 en 1994. Cette procédure est facilitée par l’existence, dans une annexe confidentielle des nouveaux accords franco-algériens modifiés en 1994, d’une clause selon laquelle les autorités françaises peuvent apporter elles-mêmes la preuve de la nationalité algérienne des condamnés à l’éloignement [4].
Notes
[1] Sur la nouvelle procédure : « Comment demander un visa en Algérie ? », in « Face à la fermeture des frontières aux Algériens », Plein droit, n° 25, juillet-septembre 1994.
[2] « Algérie, tous complices ? », Plein droit, n° 26, octobre-décembre 1994.
[3] Ce texte du HCR figure dans la brochure récente du Gisti À propos du droit d’asile, septembre 1995, 52 pages, 50 F (+ 8 F de frais de port).
[4] Le Monde, 22 octobre 1994. Lire également Nouvelles modifications de l’accord franco-algérien, Collectif pour l’accueil en France des demandeurs d’asile et exilés d’Algérie, novembre 1994, 31 pages (à commander au Gisti, 40 F + 8 F de port).

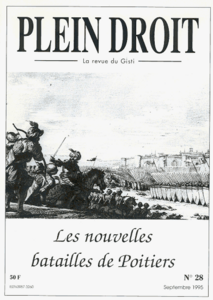
![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)










Partager cette page ?