Article extrait du Plein droit n° 28, septembre 1995
« Les nouvelles batailles de Poitiers »
A propos des deux derniers rapports de la Commission nationale consultative des droits de l’homme : Vérités et ambiguïtés
Alain Morice
Anthroplogue au Centre d’études africaines – CNRS
Disons-le d’emblée, aussi clairement que les ambiguïtés des deux derniers rapports le permettent : si cette institution est, dans son principe, un exemple que beaucoup de pays devraient suivre et un bienfait pour la démocratie en général, ses méthodes autant que ses hésitations politiques laissent souvent perplexe le lecteur soucieux des droits de l’homme.
La presse française a souvent insisté sur la virulence de ces rapports, qui « épinglent » le gouvernement français sur les manquements à l’égalité dont il est coupable ou complice vis-à-vis des populations susceptibles de discriminations de toutes sortes. De fait, malgré un ton d’ensemble très diplomatique, certains passages des rapports de la Commission consultative sont assez accablants pour les responsables du pays dit « des droits de l’homme ». D’une certaine façon, cette sévérité se trouve accrue par une nouvelle formule instaurée en 1995 (rapport 1994), selon laquelle désormais les ministres concernés répondent aux accusations lancées l’année précédente : on y trouve en effet des déclarations où, malgré eux, les pouvoirs publics français ne sont pas à leur avantage.
Ainsi, à propos de certains établissements scolaires qui prétendent contrôler les titres de séjour des parents étrangers d’enfants de moins de 16 ans (âge limite de la scolarité obligatoire), le ministre de l’éducation répond que c’est illégal mais que ce n’est pas sa faute : c’est celle des maires des communes concernées. L’autorité des préfets de l’État sur les maires serait-elle donc tombée en désuétude ? Quant aux élèves de 16 à 18 ans, ces contrôles – pourtant contraires, rappelle la Commission, à la Convention de l’ONU sur les Droits de l’Enfant – ne le choquent « nullement », mais il dit avoir toujours pensé « que ce n’était pas à l’école de le faire ». À qui donc alors ? Et, si cette pratique était légitime, pourquoi s’en décharger ?
Ainsi encore, quant aux étrangers irréguliers mais « protégés » contre l’éloignement du territoire, les réponses du ministre de l’intérieur sont proprement kafkaïennes, dans le contenu comme dans le style : « Ce n’est pas parce qu’une personne figure parmi les étrangers protégés contre le prononcé d’une mesure d’éloignement pour séjour irrégulier, qu’elle devrait être aussi protégée contre la possibilité de prononcer un refus de séjour à son encontre et devrait être même régularisée ». En bref, le gouvernement nie son propre état de droit en créant une nouvelle catégorie d’étrangers : interdits de séjour mais inexpulsables ; et le ministre précise sans rire qu’en aucune manière il y a là une incitation au travail clandestin. Certains employeurs, eux, ne s’y trompent pas : ces contradictions fabriquent pour eux un gibier comme ils l’aiment, c’est-à-dire docile par nécessité.
Ainsi toujours, sur la lancée de toutes ces justifications ambiguës, et très logiquement, apparaît sous un sceau officiel une nouvelle notion : celle de « risque migratoire ». Concernant les immigrants, la métaphore médicale du « risque » est malheureusement en phase avec les thèses xénophobes que les parrains des rapports de la Commission consultative prétendent combattre. De quelle manière un migrant est-il en soi un « risque » ? Les dirigeants français de clubs de football, pas plus que les entrepreneurs français du bâtiment, n’ont, eux, jamais craint de contaminer leurs affaires avec l’emploi d’étrangers. On remarquera que la notion de « risque migratoire » est appliquée notamment aux Algériens demandeurs de visas, triplement victimes des effets à retardement d’une ancienne migration de Français sur leur sol, de la pression répressive de leur gouvernement et des menaces des opposants extrémistes : qui court un « risque » majeur, dans cette affaire ?
Ainsi enfin, couronnant le tout, dans une courte lettre d’une notable froideur, le premier ministre accuse réception du rapport 1993 et répond au président de la Commission consultative dans le rapport 1994 : « Il n’a pas été possible de donner satisfaction à l’ensemble de vos demandes dès lors qu’il ne peut être envisagé de changer la politique en matière de lutte contre l’immigration clandestine et de régulation des flux migratoires que j’ai déterminée et que la représentation nationale a inscrite dans la loi ».
On ne saurait énoncer plus clairement que la politique migratoire de la France est contraire aux droits de l’homme, sauf à contester le bien-fondé des « demandes » de la Commission – ce que le premier ministre, qui en est le tuteur officiel, ne fait évidemment pas. On n’avouerait pas mieux, finalement, que la Commission consultative, pourtant chargée officiellement d’« assister le premier ministre », ne sert à rien quand elle est en désaccord avec ce dernier. Il semble hélas qu’elle se soit bien pliée à ce message de paix, comme nous le verrons plus loin.
Virulence des associations
De quelles « demandes » s’agissait-il ? (On notera l’euphémisme seigneurial : sous la plume du premier ministre, les droits de l’homme ne sont pas des droits, mais des « demandes ».) Le rapport 1993 touche bien d’autres sujets – la lutte contre le racisme et la xénophobie, qui met tout le monde formellement d’accord, est le prétexte à d’interminables développements consensuels – mais nous nous en tiendrons ici essentiellement à la question de l’immigration. Toute la deuxième partie traite de l’application des mesures propres aux étrangers : demandes d’asile ; délivrance des visas, autorisations de séjour et situation des irréguliers ; recours juridiques, relations avec l’administration et acquisition de la nationalité ; zones d’attente, rétention et expulsion. L’essentiel est assorti de propositions et d’« avis », sur lesquels les ministres compétents répondent plus ou moins dans le rapport 1994.
Les observations présentées dans le rapport 1993 proviennent de l’émotion créée, dans le milieu associatif, chez les juristes et dans la presse, par les lois renforçant le contrôle des étrangers. Les passages les plus virulents sont constitués par les communications des ONG et syndicats concernés. On y dénonce, pêle-mêle : les difficultés et l’humiliation constantes des étrangers pour se faire régulariser ; la loi qui légifère pour « mieux tuer le droit d’asile » ; l’amalgame « plus ou moins entretenu » entre la religion musulmane et l’intégrisme religieux ; la « régression spectaculaire de la condition des étrangers en France », ainsi que la « dénégation des droits les plus fondamentaux » et le « renforcement de l’État policier » ; « l’amalgame trop communément fait entre insécurité et immigration » et « les mesures tendant à exclure des soins médicaux les étrangers » ; la « banalisation de plus en plus flagrante des idées et de l’enracinement de l’extrême droite » ; la généralisation des « contrôles au faciès » ; et, couronnant le tout, le désir du nouveau gouvernement de faire « des populations immigrées un instrument symbolique et central de sa politique » en créant « tout un arsenal juridique qui a déjà pour conséquence de fragiliser l’ensemble des populations immigrées en réduisant de manière drastique les droits qu’elles avaient acquis sous l’impulsion des mouvements antiracistes ».
Les contributions des représentants d’associations au rapport 1994 ne sont pas moins offensives. On y trouve notamment l’idée que, désormais, « l’étranger immigré est un suspect », ainsi que la dénonciation des « connotations racistes et xénophobes » de certains textes officiels ; la lutte contre l’emploi clandestin est aussi qualifiée de « priorité » dans les discours, pas dans la pratique ; enfin, le rapport cite un texte accablant d’Amnesty International (daté du 12 octobre 1994), intitulé « Coups de feu, homicides et allégations de mauvais traitements de la part d’agents de la force publique », et l’assortit d’une longue réponse dilatoire des ministres concernés (justice et intérieur), d’où le lecteur est amené à penser que de tels abus sont à la fois accidentels, administrativement répréhensibles et protégés par le secret judiciaire. On connaît l’impunité des agents en question, qui n’émeut pas outre mesure la Commission consultative des droits de l’homme…
Ne pouvant pas non plus omettre cette autre question – la presse française en ayant fait publiquement état –, le rapport 1993 évoque longuement le centre moyenâgeux de « rétention » (aussi nommé « dépôt des étrangers ») de la préfecture de police de Paris, unanimement considéré comme une honte de la politique migratoire française. Cette honte semble également partagée par les pouvoirs publics, qui ont toujours eu bien soin de ne pas laisser les observateurs curieux en faire la visite librement. Dans le rapport 1994, le gouvernement passe sous silence les exactions dont sont victimes les prisonniers de ce centre, et se contente d’indiquer qu’il procédera à des travaux d’amélioration. (On sait que, depuis lors, le centre a été fermé sous la pression de l’opinion publique). La Commission consultative se contente de prendre note.
Silences ambigus
Et comment se fait-il, plus généralement, que certaines réponses ou déclarations gouvernementales ne fassent pas à leur tour l’objet d’un commentaire critique dans le rapport qui leur offre l’hospitalité de ses pages ? On pense notamment aux propos tenus par le ministre de la coopération lors de la réunion de la Commission consultative du 5 mars 1994, louant sa propre activité « dans un domaine parfois méconnu (sic), la construction de l’État de droit en Afrique ». Quand on sait les efforts déployés par la France pour maintenir sur le trône certains dictateurs de ce continent, la remarque ne manque pas de sel, et cela aurait mérité d’être relevé. D’ailleurs, significativement, à l’avis émis dans le rapport 1993 sur les violations des droits de l’homme au Togo, le gouvernement n’a pas jugé utile de répondre dans le rapport 1994, ni la Commission de se formaliser de ce silence.
De la complaisance à la compromission
Ne marchandons certes pas notre bonheur : c’est un grand privilège que nous avons de disposer, en France, d’un tel outil de connaissance que nous pouvons mettre au service de la lutte contre la xénophobie et le racisme, comme ce compte rendu le prouve. Mais on ne peut de bonne foi ignorer la frilosité, sinon parfois le silence objectivement complice de la Commission qui, bien souvent, se contente de transcrire les témoignages sans prendre parti.
L’attitude, quant aux principes que l’on défend, de se mettre sous une autorité gouvernementale dont on conteste par ailleurs les choix fondamentaux, cette attitude est lourde de dangereuses contradictions. Décernés par la Commission, les « Prix des Droits de l’Homme » sont remis par les ministres, ce qui limite peut-être le choix. Les réunions plénières de cette Commission se tiennent dans les ministères, ce qui n’est guère propice à son indépendance. On apprend au passage que celle qui s’est tenue au ministère de l’intérieur s’est passée cocassement : après avoir menacé, à mots à peine couverts, la Commission de rupture de dialogue au cas où elle se livrerait à « des polémiques nuisibles au dialogue », le ministre quitta juste après la réunion « sans pouvoir établir un dialogue avec les membres de la Commission » !
On voit donc que ladite Commission n’a pas toujours sa langue dans sa poche, mais on se demande, en fin de compte, si cela ne fait partie du jeu inégal qu’elle pense pouvoir jouer avec les pouvoirs de l’État. Certaines organisations — et non des moindres — ne s’y sont pas trompées : entre mai 1993 et février 1994, successivement la Ligue des droits de l’homme, le GISTI, la Fondation France libertés et Médecins sans frontières allaient quitter la Commission nationale consultative, marquant ainsi qu’il leur paraissait impossible de cautionner plus longtemps la politique officielle en matière d’immigration.
Évoquant divers problèmes graves, tels la suppression du droit au travail pour les demandeurs d’asile ou la création de « zones d’attente » pour les étrangers jugés indésirables, le GISTI s’indigne, dans sa lettre de démission datée du 18 novembre 1993 – que le lecteur cherchera en vain dans ces rapports (pourquoi ?) –, de voir qu’« au moment où des atteintes de plus en plus caractérisées sont portées aux droits de l’homme », la Commission consultative perd « sa capacité d’indignation et ne réagit plus qu’avec une extrême mollesse à ces atteintes ». Pour compléter ce scepticisme, on se doit de remarquer que cette « mollesse » prend bien souvent la forme d’une adhésion pure et simple aux thèses et pratiques gouvernementales.
Toute la deuxième partie, déjà évoquée, du rapport 1993 sur les « mesures propres aux étrangers » disparaît totalement dans le rapport 1994, au profit d’un insipide développement consacré à l’harmonisation européenne de la lutte contre le racisme et la xénophobie. Cela peut s’expliquer, puisqu’aucun texte nouveau n’est venu, en 1994, compléter fondamentalement le dispositif réglementaire antérieur.
On s’explique moins bien cependant que la Commission, alors que tous les problèmes des étrangers, sans exception, se sont aggravés en 1994, croie bon de publier complaisamment, dans son dernier rapport, les justifications du gouvernement sans apporter le dernier mot. À celles, déjà évoquées, qui concernent les sinistres « centres de rétention », elle ne trouve rien à redire, alors qu’il est clair que les protestations ministérielles d’innocence sont de nature dilatoire. Et que, plus clairement encore, l’autorité publique française a intérêt à ce qu’on fasse de la publicité sur ces centres carcéraux ignominieux, de sorte à dissuader les candidats à l’immigration clandestine.
Racisme ou xénophobie ?
On ne comprend pas plus pourquoi la Commission consultative accorde à plusieurs reprises, et pesamment, son satisfecit à la lutte des pouvoirs publics contre toutes les formes de racisme et de xénophobie, alors même que les témoignages dont elle se fait l’écho tendent à montrer que ces mêmes autorités sont les initiatrices actives de telles dérives – on ne trouve dans ces rapports aucune allusion aux dérapages verbaux du personnel politique, comme celui qui attribuait aux étrangers des « odeurs » gênantes, ni même au thème devenu récurrent du « seuil de tolérance ».
L’amalgame même des mots « xénophobie » et « racisme », qui est constant dans ces textes (malgré quelques communications très pertinentes de personnalités extérieures sur ce point sémantique), délivre les lois xénophobes d’une telle qualification : si la xénophobie est assimilable au racisme – ce qu’elle n’est évidemment pas, quoique chacun soit porté à le croire puisque l’une et l’autre marchent souvent main dans la main –, alors, en effet, les mesures officielles sont exemptes de tout soupçon de xénophobie.
Dit plus simplement, en se conformant à l’étymologie : la xénophobie, c’est la crainte de l’étranger, donc le désir de se prémunir contre le « risque » (cf. plus haut) qu’il incarne. Si on la définit comme quelque chose de plus fort, soit la haine d’une autre race, on excuse de toute faute les xénophobes et leurs lois : c’est hélas ce que font à merveille les rapports de la Commission consultative, qui ne tarissent pas d’éloges sur les efforts de la nation française contre le racisme et la xénophobie. On pourrait faire des réflexions analogues à propos de l’étonnant mélange, visible dans le premier chapitre du rapport 1994, entre les notions d’antisémitisme et d’antisionisme, mais il dépasserait les limites que nous nous sommes imparties ici, qui sont celles de l’immigration.
Faux-fuyants, ambiguïtés ou simplement silences sont trop nombreux dans ces rapports pour qu’on les évoque tous. Ils alternent avec des propos offensifs dont on finit par se demander, au vu de la tonalité généralement conciliante de l’ensemble, s’ils n’ont pas pour fonction de faire avaler la pilule de la xénophobie officielle, plutôt que de la combattre. Un des procédés favoris de la Commission est de citer le point de vue officiel sans le commenter, quitte à citer aussi un avis contraire et à placer, dans un autre chapitre, son propre « avis » coupé de tout contexte. C’est ce qu’elle fait pour les candidats algériens au refuge évoqués ci-dessus – on connaît la situation dramatique, pour des milliers de personnes des deux sexes, qui prévaut en Algérie – dans le rapport 1994. Elle note (c’est bien le moins) le nombre dérisoire d’Algériens ayant obtenu le statut de réfugiés – même pas trois dizaines entre janvier 1993 et juin 1994. Mais elle en fait si peu un principe absolu et universel, pour toutes nations et origines, que la crédibilité de cette démarche formelle en est entamée.
Sondage-alibi
« Bouclant » l’essentiel de son rapport à la fin de l’année civile précédant la remise du rapport, la Commission consultative n’a peut-être pas eu le temps de s’émouvoir – encore que la dernière réunion préparatoire du rapport se soit tenue le 17 janvier 1995 – du gros danger que représente, pour les libertés publiques la loi n° 94-1136 du 27 décembre 1994, dont le titre I stipule : « Toute personne qui, alors qu’elle se trouvait en France, aura par aide directe ou indirecte facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 200 000 francs ». Déjà la justice a eu à traiter du cas d’une Française poursuivie pour ne pas avoir livré aux autorités son époux en situation irrégulière : il s’agit là d’une évolution juridique indigne d’une démocratie, outre qu’elle est particulièrement perverse puisqu’elle contredit les exigences du Code civil, qui énonce que « les époux doivent se prêter mutuellement assistance ». On attend d’autant plus impatiemment de voir ce qu’en dira le rapport 1995 que c’est l’activité même de nombre des membres de la Commission, engagés dans l’assistance aux étrangers en difficulté, qui se trouverait menacée par cette loi.
Les rapports de la Commission nationale consultative des droits de l’homme sont assortis de la publication et de l’analyse des résultats du sondage annuel : « Les Français et la lutte contre le racisme ». Cet exercice renforce le malaise du lecteur. La conclusion générale en est que le racisme et l’intolérance se répandent et se banalisent. C’est du moins ce qu’en retient la presse, qui titre par exemple : « Deux Français sur trois se disent racistes » (Le Monde, 22 mars 1995).
Tous les sociologues honnêtes (voir notamment les travaux de Pierre Bourdieu sur ce point) savent bien les dangers des réponses induites par des questions telles que : « Quels sont vos sentiments personnels à l’égard des différents groupes suivants. Avez-vous pour eux beaucoup de sympathie, plutôt de la sympathie, plutôt de l’antipathie ou beaucoup d’antipathie ? » En demandant au sondé de se déterminer affectivement par rapport à des « groupes » (les homosexuels, les Juifs, les beurs, les Tziganes, les Noirs, etc.), le sondeur ne va-t-il pas au devant du racisme en questionnant ainsi, et ne fabrique-t-il pas ce qu’il prétend combattre ? L’auteur de ces lignes, antiraciste convaincu et fervent, n’éprouve, justement à cause de ses convictions, aucune espèce de sympathie ou antipathie particulières a priori pour l’un quelconque de ces « groupes » en tant que groupe : il aurait été bien en peine de répondre à une question si insidieuse. Mais on décèle bien, hélas, le sens ultime d’un tel sondage, qui fait état notamment du refus des Français de voir s’instituer un « Islam de France », ou de leur désir de voir se renforcer la lutte contre les étrangers clandestins : apporter un renfort idéologique à la politique officielle de « maîtrise des flux migratoires ». Ce n’est certainement pas un sondage que l’on aurait organisé dans les années 1960, quand la France allait chercher les étrangers chez eux pour faire tourner son économie.
Sur ce point comme sur bien d’autres, il apparaît que l’indépendance de cette Commission dite « consultative » est sérieusement limitée par le statut qui l’attache au gouvernement. On prendra donc ses rapports pour ce qu’ils sont : un outil documentaire important mais biaisé, qui ne doit pas empêcher le citoyen de mener sa propre réflexion et ses propres combats pour les droits de l’homme.
* Commission nationale consultative des Droits de l’Homme : La lutte contre le racisme et la xénophobie — Exclusion et Droits de l’Homme, Rapports 1993 et 1994 au premier ministre, Paris, La Documentation française, 21 mars 1994 et 21 mars 1995, 536 p. et 436 p.

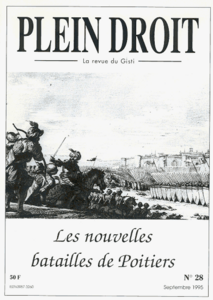
![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)










Partager cette page ?