Article extrait du Plein droit n° 29-30, novembre 1995
« Cinquante ans de législation sur les étrangers »
L’ordonnance du 19 octobre 1945 : affinement juridique
Patrick Weil
Les débats autour du code de la nationalité sont eux moins connus. La construction juridique de la majeure partie du code de la nationalité française s’est organisée au sein d’une Commission de la nationalité, instituée par arrêté du ministre de la justice du 14 juin 1945, qui va siéger et travailler parallèlement à la Commission interministérielle des naturalisations. Présidée par un président de section au Conseil d’État, elle comprend également un conseiller à la Cour d’appel de Paris, un professeur de droit de Toulouse, ainsi que deux représentants du ministère de la justice – le directeur des affaires civiles et du Sceau et un magistrat chargé du contentieux de la nationalité au ministère de la justice qui sera le rapporteur de la Commission. Le projet qui en est issu est transmis au garde des Sceaux, puis, légèrement modifié, au gouvernement, puis au Conseil d’État, enfin à nouveau au gouvernement avant sa promulgation le 19 octobre 1945.
L’objectif des rédacteurs n’est pas de modifier fondamentalement la législation en vigueur sous la IIIe République, à laquelle le régime de Vichy n’a d’ailleurs pas formellement touché : si les discriminations collectives imposées aux Français d’origine juive ont constitué une expulsion de fait de la nation, acte sans précédent dans l’histoire contemporaine de la France, souvent suivie de leur livraison à l’Allemagne, elles ont été introduites sans modification de la législation sur la nationalité française.
L’ambition de l’administration est surtout de profiter, en cette année 1945, de la fenêtre d’opportunité qu’offre cette courte période où le gouvernement peut agir par ordonnances, sans intervention d’un pouvoir législatif non encore désigné, pour faire aboutir une opération d’affinement juridique, préparée dès la fin des années trente. C’est ce qui ressort des propos du rapporteur de la Commission, Raymond Boulbès, qui peut être considéré comme le principal concepteur du texte : « Le législateur s’inspirant de la tradition qui remonte d’ailleurs à plusieurs millénaires (Code d’Hammourabi, 2000 ans avant J.-C.) s’est astreint à n’introduire dans chaque article qu’une disposition unique et concise, répondant à une seule idée. Les éléments disparates parfois confusément mêlés en chacun des articles de la loi de 1927 ont fait l’objet d’une sévère analyse et ont été classés suivant un ordre logique qui en facilite la lecture et l’application. » [1].
Des débats juridico-administratifs se développent donc au sein de cette commission de spécialistes sensible aux contradictions de jurisprudence, aux imperfections logiques. Les modifications de forme sont majeures ; celles de fond sont mineures.
Sous l’empire du nouveau code comme sous l’empire des lois précédemment en vigueur, l’enfant né d’un parent français sera français, quel que soit son lieu de naissance, de même que sera français l’enfant né en France d’un parent né en France, comme c’est le cas depuis la loi de 1851 ; et l’enfant né en France de parents étrangers continuera à acquérir la nationalité française sans formalité à sa majorité.
Après débat, on décide que la transmission de la nationalité par la mère française sera assurée même à l’enfant né à l’étranger : l’intérêt national et démographique et la réalité de l’éducation par la mère prévalent sur le risque de double nationalité. Les réformes vont parfois dans le sens d’une restriction de la liberté des individus face à l’État : ainsi la femme, sauf réserve expresse émise avant le mariage, se voit attribuer automatiquement la nationalité française, alors que la loi de 1927 lui laissait le choix [2]. On étend également la condition de stage à l’acquisition de la nationalité française par déclaration pour les enfants nés en France de parents étrangers qui ne sont pas eux-mêmes nés en France : selon la Commission, « la stabilité de l’établissement sur le sol français, pour le fils d’étranger né en France, est la garantie de son assimilation effective » [3]. Enfin, le contrôle du gouvernement sur tous les actes d’acquisition de la nationalité française est renforcé.
En ce qui concerne les naturalisations, le code n’apporte pas non plus de modifications sensibles au texte de la loi de 1927, sinon que la condition de stage passe de trois à cinq ans. Les conditions supplémentaires qu’il prévoit – de résidence effective, de moralité, d’assimilation, d’état de santé – ne sont pas véritablement une innovation, dans la mesure où ces éléments étaient déjà pris en compte par l’administration dans la phase de décision en opportunité.
On ne trouve finalement pas trace, dans le code de la nationalité promulgué par l’ordonnance du 19 octobre 1945, des débats qui, parallèlement au travail de refonte du code, étaient menés au sein de la Commission interministérielle des naturalisations [4].
(*) Sur ce point, voir Patrick Weil, « L’ordonnance du 2 novembre 1945 : l’aboutissement d’un long processus », Plein droit n° 22-23, mars 1994 ; et « Racisme et discriminations dans la politique française de l’immigration, 1938-1945/1974-1995 », Vingtième siècle, juil.-sept. 1995, p. 74-99. Voir aussi, dans ce numéro, « Qu’affluent les bras aux manches retroussées » et « Le rôle d’Alexandre Parodi ».
Notes
[1] Raymond Boulbès, Commentaire du Code de la nationalité française (ordonnance du 19 octobre 1945), Paris, Sirey, 1946, p. 5.
[2] R. Boulbès justifie ce retour en arrière de la façon suivante : « La réaction contre le principe traditionnel a paru trop brutale. On a voulu, en 1927, laisser la femme libre en raison du principe de l’autonomie de la volonté, de décider si elle voulait ou non suivre la nationalité de son mari. [...] Point n’était besoin pour cela de l’unité de nationalité qui est une donnée de notre civilisation à la fois latine et chrétienne ». (ibid. p. 17).
[3] Rapport sur les travaux de la Commission de la nationalité, archives du ministère de la justice.
[4] Voir « Naturalisations : le bon grain plutôt que l’ivraie ».

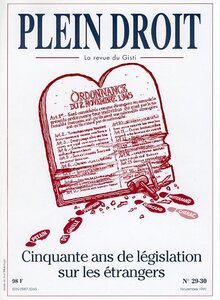
![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)










Partager cette page ?