Article extrait du Plein droit n° 21, juillet 1993
« Les étrangers sous surveillance policière »
De profundis... Vie et mort d’un « conseil moignon » de déontologie policière
Jean-Michel Belorgey
En avril dernier, Jean-Michel Belorgey nous envoyait l’article ci-dessous dans lequel il décrivait le contenu et le sort du projet qu’il avait présenté et défendu pendant onze ans concernant la création d’une Commission d’information sur les activités des services de police.
De sa conception en 1981 à l’annonce (au Journal officiel) de sa naissance, en février 1993, cette idée d’une structure indépendante de surveillance de la déontologie policière, qui déplaisait beaucoup à la droite et pas mal à la gauche, avait fini par se concrétiser, mais sous une forme telle que son géniteur ne la reconnaissait presque plus. C’est de cette métamorphose qu’il est question ici.
Ce récit a cependant valeur de témoignage posthume.
En effet, aussi dépouillé et contrôlé soit-il, ce Conseil supérieur de l’activité policière, comme il avait été baptisé, a dû être jugé bien gênant puisqu’à peine créé par la gauche, il était rayé d’un trait de plume par Charles Pasqua. Deux réunions ont suffi pour faire comprendre aux membres de ce Conseil que leur participation serait de courte durée : l’une pour constater que les moyens financiers prévus avaient été bloqués, l’autre pour se voir refuser d’enquêter sur les bavures de Paris, Chambéry et Wattrelos.
Ce « conseil moignon », comme l’appelait déjà Jean-Michel Belorgey, n’aura vécu que quelques semaines.
Par décret en date du 16 février 1993, a finalement vu le jour un « Conseil supérieur de l’activité de la police nationale », dont le principe et l’éventuelle définition étaient depuis onze ans en débat. L’affaire a plus pourri que mûri. Entre ce Conseil et la Commission d’information sur les activités des services de police, que proposait de mettre en place le pré-rapport sur les réformes de la police publié en 1982, il n’existe en effet que peu de points communs.
Les propositions du pré-rapport étaient en effet fondées sur le constat d’une demande, de la part de l’opinion, d’informations sur différentes catégories de dysfonctionnements des services de police, allant de l’incident de police - la « bavure » - localisé, à la grave défaillance dans l’organisation d’opérations de maintien de l’ordre, et d’une demande d’informations fiables, c’est-à-dire soustraites aux réfactions dont est coutumier le pouvoir quand il lui faut s’expliquer publiquement de tels dysfonctionnements, parce qu’ils ont pris une ampleur ou une notoriété telles qu’ils ne peuvent plus être tenus secrets.
Il était en conséquence suggéré que la Commission d’information sur les activités des services de police puisse être saisie par tout citoyen, y compris les policiers, de requêtes relatives à un fonctionnement défectueux de la police ; puisse bien sûr les instruire en procédant aux investigations nécessaires ; mais aussi soit rendue destinataire de tous documents ou rapports établis par les services compétents, singulièrement les inspections de la police, ayant trait au même sujet ; à charge pour elle de procéder à un filtrage convenable des informations obtenues en vue de faire la part de celles ne pouvant donner lieu à publication et de celles pouvant être utilisées au soutien d’avis publics ou de rapports publics.
La possibilité de saisine par les policiers était directement liée à la proposition concomitante de mise en place d’un système de récusation des ordres illégaux permettant de donner vie aux dispositions existant certes en ce domaine dans le code de procédure pénale et dans le code de déontologie, mais la plupart du temps condamnées à rester lettre morte pour cause de difficulté de leur maniement par des fonctionnaires pris dans le réseau des contraintes hiérarchiques ou des solidarités professionnelles.
La composition envisagée pour la Commission, enfin, était une composition résolument pluraliste, les représentants des pouvoirs publics n’y occupant qu’une place restreinte au côté des policiers de base, des usagers et des représentants de l’opinion. Ce pluralisme apparaissait comme le principal garant de ce que la Commission ne fonctionnerait comme boîte noire que dans la stricte mesure nécessaire à la protection des personnes et du secret légitime, s’attachant pour le reste à casser les liens pervers entre le pouvoir et « sa » police, et à renouveler la compréhension traditionnellement, elle aussi, perverse, des issues possibles aux différentes catégories d’incidents de police : couvrir ou punir, plus souvent couvrir que punir, quitte à mentir, et parfois punir à mauvais escient ; tout cela dans le vain espoir de se fidéliser ou de mieux tenir la police en général, ou tel ou tel fonctionnaire en particulier, et au risque, souvent vérifié par l’expérience, d’aller ainsi de concession en concession et de bavure en bavure à force de complaisance coupable, au point d’être plus tenu qu’on ne tient.
Une initiative mal accueillie
Manifestement, l’ambition d’assurer une transparence suffisante de l’activité policière ne faisait pas l’affaire du pouvoir et d’une fraction de la hiérarchie. La partie du rapport consacrée à la Commission d’information sur les activités des services de police est une de celles que, dès le printemps 1982, le ministre de l’Intérieur se déclarait publiquement décidé à tenir pour non avenue.
Les très nombreuses « bavures » survenues pendant la décennie 1990 - notamment, mais pas seulement, entre 1986 et 1988 - ont toutefois finalement emporté la conviction que, pour assainir le fonctionnement de la police, les réformes intervenues par ailleurs en vue de la moderniser et, pour partie, de la démocratiser, demeuraient insuffisantes, qu’à tout le moins c’est ce dont on gagnait à convenir face à l’opinion progressiste et aux groupes modernisateurs agissant au sein de la police elle-même. C’est ainsi que l’idée d’une commission s’intéressant aux activités des services de police a, quasi miraculeusement, refait surface au début des années 1990 et qu’un rapport en vue d’en profiler les contours a été demandé à un conseiller d’État en service extraordinaire, magistrat de formation, M. Bouchery.
Les conclusions du rapport Bouchery, étayées par une large consultation, se sont en fait révélées très proches de celles auxquelles était parvenu le pré-rapport de 1982. Soucieux, en bon juriste, d’éviter le démembrement de l’État, les empiétements de l’instance envisagée sur les pouvoirs du Parlement et sur ceux de l’autorité judiciaire, l’affaiblissement de l’autorité hiérarchique et de l’efficacité de la police, M. Bouchery n’en proposait pas moins la création d’une instance ayant un champ de compétences très vaste : toute action et tout acte pouvant présenter le caractère de faute pénale, disciplinaire ou déontologique, ou connotant une défaillance dans l’organisation du service. Sans doute soustrayait-il, à ce champ de compétences, les actions conduites sous la direction, la surveillance, ou le contrôle de magistrats de l’ordre judiciaire ; nul n’est parfait, et les conceptions classiques en ce domaine restent très prégnantes, même si elles reviennent à cautionner des formes de dialogue singulier entre police et magistrature, à qui il arrive de présenter des caractéristiques aussi perverses que celles marquant le dialogue police-pouvoir exécutif (on se souvient à cet égard des axiomes de Casamayor : la justice a besoin de la police, la police n’a pas besoin de la justice...).
S’agissant de la saisine, M. Bouchery se déclarait persuadé qu’elle devait être extrêmement ouverte et qu’en réalité, on ne pouvait, pour ce faire, qu’admettre tout citoyen à y procéder. De même était-il envisagé de donner à la Commission un pouvoir d’investigation très large, celle-ci pouvant faire appel à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) ou à d’autres intervenants. Les membres de la Commission, majoritairement recrutés hors des pouvoirs publics, étaient considérés comme devant être habilités au secret défense. Le souci de donner à la Commission les moyens de ses compétences conduisait M. Bouchery à proposer que celle-ci puisse apprécier les comportements de tout fonctionnaire, recevoir toute déclaration, avoir communication de tout document, se transporter sur place pour examiner toute pièce, et envisageait de recourir à la loi pour y pourvoir suffisamment en surmontant d’éventuels obstacles juridiques. Les avis, comme le rapport annuel de la Commission, devaient, dans l’esprit de M. Bouchery, être publics, et l’instance veiller aux suites données à ses recommandations.
Le Conseil issu du décret du 16 février 1993, à la lumière de ces réflexions préparatoires, fait manifestement figure de conseil moignon. On n’a, du rapport Bouchery, finalement retenu que la durée du mandat et le renouvellement par tiers des membres du conseil, ainsi que la limitation du champ de compétences de celui-ci à la police nationale, à l’exclusion par conséquent de la gendarmerie et des « polices municipales ». Le premier choix n’appelle pas de commentaires. Le second n’est en revanche pas sans inconvénient, même si on peut lui trouver des justifications techniques (appartenance de la gendarmerie à l’armée, existence de structures propres de contrôle ; inexistence d’un véritable statut des polices municipales). La Fédération autonome des syndicats de police (FASP) avait d’ailleurs, dans sa « déposition » auprès de M. Bouchery, pris position en sens contraire. Qu’on songe en effet aux problèmes auxquels se serait heurté le Conseil dans le cadre d’une telle définition de ses compétences, s’il avait existé lors des incidents de maintien de l’ordre à Paris liés aux difficultés de communication pour cause de différences de fréquences radio entre police et garde républicaine. Quant aux polices municipales, ce n’est un secret pour personne qu’elles apportent à la légende noire policière des violences liées à l’absence de nerfs, de formation ou de sélectivité du recrutement des fonctionnaires, aux ratonnades organisées, une contribution non négligeable.
Verrouillage
On a, pour le reste, tout fait pour que l’institution finalement créée ait les mains très largement liées :
- composition faisant une place écrasante aux représentants des pouvoirs publics ;
- saisine limitée aux ministres de l’Intérieur et de la Justice, aux parlementaires, aux syndicats de police et à différentes associations ayant le fonctionnement de la police dans leur objet social ;
- impossibilité d’entendre un fonctionnaire ou d’obtenir des rapports sans l’accord du ministre de l’Intérieur ;
- transmission du rapport annuel - il n’est plus question d’avis - à ce ministre, à charge pour celui-ci d’informer le Conseil des suites qu’il entend y donner ;
- absence d’habilitation au secret défense, ce qui, dans de nombreux cas, dès que la DST, par exemple, sera plus ou moins impliquée - on a vu le cas fréquemment dans le passé à l’occasion d’investigations ambiguës à l’encontre de militants tiers mondistes - risque de paralyser l’action du Conseil.
Nul doute, dès lors, que malgré la nomination, au sein du Conseil, de grandes figures du combat pour les libertés, l’action de celui-ci ne trouve promptement ses limites. D’ores et déjà, le passage obligé par les parlementaires pour saisir le Médiateur de la République, freine fortement le développement d’une institution qui, dans d’autres pays - l’Espagne - a, grâce à une saisine beaucoup plus ouverte, pris une tout autre stature. Ce qui vaut pour le Médiateur vaudra pour le nouveau Conseil, de façon redoublée s’agissant de problèmes dont les élus n’aiment guère se mêler, de peur de se rendre impopulaires auprès de l’exécutif ; à tort ou à raison, beaucoup trouveront divers motifs - la compétence judiciaire notamment - pour les éluder. On voit mal, au surplus, la victime d’une violence policière, à laquelle son député hésiterait à donner satisfaction, chercher son intercesseur parmi les autres députés ouverts à ce genre de cause, et quelques-uns « truster » le traitement des affaires de l’espèce. Les délais de transmission des requêtes risquent, de reste, d’affaiblir terriblement la pertinence des interventions du Conseil. Reste, il est vrai, les associations ; mais toutes les victimes d’incidents de police y songeront-elles et là encore, les délais ne risquent-ils pas d’être trop longs. Quant aux policiers, il est clair qu’ils devront passer par leurs syndicats, ce qui ne laissera pas de créer une certaine émulation - mais dans quel sens ? - entre les organisations intéressées, et peut donner lieu à des débats éclairants, mais aussi à des enlisements spectaculaires.
On voit bien, sur un autre plan, à quelles manœuvres dilatoires peut conduire l’interposition du ministre de l’Intérieur, d’une part entre le Conseil et les sources d’informations auxquelles il lui faudra faire appel pour instruire les requêtes dont il serait saisi, d’autre part entre les prises de position du Conseil et l’opinion.
De chaque réforme qui reste au milieu du gué, on peut penser qu’elle permet tout de même d’aller de l’avant ; on peut aussi penser qu’elle condamne pour un temps plus ou moins long la véritable réforme, dont elle constitue la parodie, à ne pas s’épanouir convenablement. Dans quel sens opiner, s’agissant du Conseil supérieur de la police nationale ? Seule l’expérience permettra d’en juger avec certitude, mais tous les éléments sont réunis pour que le rite et l’esquive l’emportent sur les mutations en profondeur et la quête ardente de la vérité.

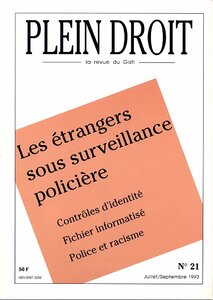
![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)










Partager cette page ?