Article extrait du Plein droit n° 29-30, novembre 1995
« Cinquante ans de législation sur les étrangers »
Des familles selon les besoins
Claire Rodier
Permanente au Gisti
À l’époque où s’élaborait ce qui allait devenir l’ordonnance de 1945, l’immigration n’était pas traitée en « problème » mais en nécessité nationale. Si elle faisait l’objet de débats chez les décideurs, c’était pour savoir s’il fallait privilégier la « quantité » ou la « qualité », en d’autres termes s’il était préférable d’accueillir, en raison d’impératifs démographiques, une immigration massive sans distinction d’origine pour contribuer au repeuplement de la France après la saignée de la guerre, ou d’opérer, pour répondre aux besoins urgents de main-d’œuvre, une sélection parmi les étrangers les plus à même, du fait de leurs supposées capacités à s’assimiler, d’intégrer à terme le corps social français [1].
L’ordonnance de 1945, dans sa version initiale, ne fait aucune allusion à l’immigration familiale. Mais les conditions dans lesquelles les travailleurs étrangers installés en France peuvent se faire rejoindre par les membres de leur famille font partie des préoccupations du gouvernement. Par un décret de décembre 1945, le ministère de la population se voit confier la mission de « faciliter l’établissement familial des étrangers », et l’Office national d’immigration (ONI), créé par l’ordonnance du 2 novembre 1945, a parmi ses tâches celle d’organiser l’introduction des familles des travailleurs. Aux arguments des natalistes qui militent pour l’installation de femmes étrangères en âge de procréer, s’ajoute le souci de fixer la main-d’œuvre immigrée : une circulaire de 1947 soulignera ainsi l’importance de l’immigration familiale comme facteur d’intégration des travailleurs étrangers. A l’égard de certaines nationalités, on ne se contente pas de mesures incitatives, puisqu’il est prévu que les travailleurs étrangers ont l’obligation de souscrire une demande d’introduction de leur famille [2].
Cette préoccupation ne se traduit cependant pas par une réelle maîtrise de l’arrivée des familles. De même qu’une grande partie de l’immigration de main-d’œuvre entre en France sans passer par l’ONI, l’installation des familles qui viennent la rejoindre échappe, la plupart du temps, à tout contrôle. Cette tolérance de fait va de pair avec la vision utilitariste qu’a des travailleurs étrangers la France de l’après-guerre : dans la mesure où l’économie nationale a besoin d’eux, on n’est guère regardant sur le respect des textes qui régissent les modalités de leur entrée et de leur séjour. On ne se préoccupe pas non plus, malgré la crise aiguë du logement (qu’ils contribuent – ironie du sort – à résorber, l’industrie du bâtiment étant grande consommatrice de main-d’œuvre étrangère), des conditions dans lesquelles ils vivent. Foyers prévus pour des célibataires, bidonvilles et cités de transit sont bien souvent le lot des familles d’immigrés.
Ce laisser faire, dont l’apogée se situe au début des années 1960, suscite toutefois quelques inquiétudes, et on va à cette époque tenter d’y remédier. Si la loi ne traite toujours pas de l’immigration familiale, c’est par voie de circulaires que les pouvoirs publics manifestent leur velléité de l’encadrer, à défaut d’être en mesure de la contrôler totalement. Elle est toujours souhaitée : une instruction du 17 mars 1965 du ministère de la Santé publique (sous-direction du peuplement...) rappelle que « de nombreuses considérations d’ordre humain, économique, démographique et social conduisent les pouvoirs publics à favoriser l’installation en France de familles étrangères », mouvement migratoire « hautement souhaitable dans son principe » ; seuls les effets de la crise du logement imposent, dans certains cas, d’y apporter un frein. Les règles fixées par cette directive sont significatives de l’intérêt que porte la France à ce qui est encore considéré comme une chance pour un pays en pleine expansion économique.
L’instruction de 1965 donne les règles de fond en fonction desquelles l’administration doit autoriser l’admission des familles. Formellement, ces règles ne diffèrent guère de celles qui sont applicables aujourd’hui : le travailleur rejoint doit être en situation régulière, être établi en France avec suffisamment de stabilité et justifier de ressources suffisantes et de conditions de logement considérées comme normales. Mais nombreux sont les aménagements qui en tempèrent les effets : une comparaison entre les arguments développés pour expliquer ces aménagements et l’exposé des motifs qui justifient, aux yeux du législateur de 1993, la rigueur de l’application des règles actuelles, démontre — s’il en est besoin — la façon dont, quand il s’agit d’immigration, l’État ajuste son discours en fonction de considérations bien éloignées de celles qui sont mises en avant.
À la bonne franquette
En premier lieu, l’instruction de 1965 concerne aussi bien l’admission au séjour de familles arrivées par leurs propres moyens que les regroupements de familles accompagnant le travailleur ou acheminées par les soins de l’ONI : la procédure de « régularisation » sur place, aujourd’hui prohibée sous prétexte qu’on ne saurait valider une immigration clandestine, est donc à l’époque parfaitement officielle.
S’agissant ensuite des conditions d’accueil, cette instruction précise que la pénurie de logement peut justifier dans certains cas l’échelonnement du regroupement familial. Si la crise du logement est aujourd’hui moins vive qu’il y a trente ans, on ne saurait sans hypocrisie affirmer que les étrangers connaissent pour autant moins de difficultés à se loger : la discrimination dont ils sont l’objet sur le marché locatif privé, l’absence de transparence qui caractérise les procédures d’attribution de logements sociaux font que, bien souvent, leurs demandes – alors même qu’ils seraient en mesure d’assumer la charge du loyer – restent vaines. Pourtant, la venue échelonnée des membres d’une famille au fur et à mesure des possibilités d’accueil, autorisée en 1965, est à présent prohibée par une législation réservant les cas de « regroupement partiel » à des circonstances très exceptionnelles.
Par ailleurs, la notion même de famille d’étranger a connu, en trente ans, une évolution inverse à celle des mœurs : l’instruction de 1965 invitait en effet les préfets à admettre au séjour les concubines si des présomptions sérieuses, telles que la naissance d’enfants ou l’empêchement juridique au mariage, attestaient de la réalité du couple. De même, les demandes de regroupement familial pour des fiancées étaient recevables. Si aujourd’hui l’union libre est en croissance constante dans la société française, elle n’est juridiquement pas reconnue lorsqu’elle est pratiquée par des étrangers : point de regroupement familial sans mariage.
Restrictions à l’encontre des Algériens
On s’aperçoit enfin que ce qui paraît évident est variable selon les époques : la législation en vigueur à la date de l’instruction sur le regroupement familial ne prévoyant pas explicitement le droit au séjour des membres de famille de Français, l’instruction invitait à une bienveillance particulière à l’égard des demandes émanant de nationaux désireux de se faire rejoindre par leur famille étrangère, estimant que « seules des raisons d’une exceptionnelle gravité peuvent empêcher un Français établi en France de recevoir auprès de lui ses parents étrangers ». Les couples mixtes aujourd’hui contraints de choisir entre séparation et clandestinité, les Français attendant en vain qu’on délivre un visa à leurs parents âgés apprécieront : quand on songe qu’en 1995 on engage des poursuites à l’encontre d’une Française pour aide au séjour irrégulier de son mari étranger, on mesure le chemin parcouru.
Lorsqu’on cherche à favoriser l’immigration, la tolérance est, on le voit, de mise. Mais elle s’exercera de façon différenciée en fonction des besoins nationaux : l’instruction de mars 1965 précise qu’au-delà des critères prévus pour l’admission des familles, « il convient de tenir compte des particularités démographiques locales. Ainsi, tant que le nombre et le comportement des étrangers n’y posent pas de problèmes aigus, les préfets des départements dépeuplés pourront en matière d’immigration étrangère au titre du regroupement familial, se montrer plus larges que ceux des départements où la concentration de la population pose des problèmes difficiles. » Nous ne sommes, à l’époque, pas loin de l’apparition dans le langage courant du concept de « seuil de tolérance ».
Ce souci de répartir les familles, ou de freiner l’arrivée de certaines d’entre elles sur la base de critères bien éloignés de l’intérêt des personnes regroupées, facilité par cette pratique de gestion « par circulaires » qui a de tout temps été la règle en la matière, apparaît encore plus clairement lorsque les pouvoirs publics traitent de l’immigration familiale algérienne. Il faut rappeler que l’instruction de 1965 concerne les étrangers du régime général, c’est-à-dire dont la situation n’est pas prévue par des accords bilatéraux : ce qui est le cas des ressortissants des pays d’Afrique fraîchement décolonisés dont les Algériens, à qui les accords d’Évian confèrent un statut censé être plus favorable que celui réservé aux autres immigrés [3]. Cependant l’installation durable des Algériens, ainsi que celle de leur famille, n’est pas toujours envisagée avec sérénité par les pouvoirs publics. Force est de constater que si, depuis la guerre, la France avait officiellement opté pour une politique de l’immigration dépourvue de critères ethniques, des tentatives ont été menées à plusieurs reprises pour éviter les flux trop massifs d’Algériens [4].
Deux circulaires témoignent de l’état d’esprit qui régnait peu après l’indépendance de l’Algérie.
La première, qui date du 9 juillet 1965, explique que s’il est normal de répondre au souhait légitime des travailleurs étrangers d’être rejoints par les membres de leur famille, « il ne saurait être question de faciliter une immigration familiale incontrôlée et désordonnée qui irait à l’encontre des intérêts de l’ensemble de la collectivité et serait en définitive préjudiciable aux immigrés eux-mêmes ». Ces « intérêts » sont de deux ordres : d’une part, prévenir les risques sur le plan social et sanitaire provoqués par les conditions d’habitat (bidonvilles et locaux insalubres) de nombreuses familles algériennes, d’autre part éviter « le regroupement de [ces familles] en milieu à prédominance maghrébine ».
Les choses sont encore plus clairement exprimées dans une seconde circulaire sur l’admission en France des familles des travailleurs algériens, du 27 février 1967. Les préfets y sont invités à tenir compte, préalablement à l’examen au fond (critères de ressources, de logement) des demandes de regroupement familial qui leur sont adressées, du contexte local : « il peut se trouver que l’arrivée continue de nouvelles familles algériennes présente dans certaines localités des inconvénients d’ordre général, en raison de la situation démographique et sociale. C’est ainsi qu’il peut paraître inopportun de favoriser l’accroissement d’une colonie nord-africaine déjà importante vivant en marge de la population française ». Dans un tel contexte, les préfets doivent suspendre l’examen de nouvelles demandes et saisir l’administration centrale.
Cette attitude spécifique à l’égard des Algériens est également perceptible à la lecture des consignes que contient cette circulaire de 1967 quant aux règles de fond qui permettent d’autoriser ou non l’admission des familles : si l’instruction de 1965, relative aux étrangers du régime général, évoquait les conditions de logement, elle n’y consacrait qu’un court paragraphe, rappelant qu’elles devaient être conformes aux conditions générales de vie considérées comme normales pour les travailleurs de la même catégorie dans la même région.
S’agissant des Algériens, le chapitre consacré, par la circulaire de 1967, à l’occupation du logement est beaucoup plus détaillé : il indique notamment qu’il doit être vérifié, lors de l’instruction de la demande, que le montant du loyer n’excède pas une proportion raisonnable des ressources du chef de famille, par exemple 15 %. Par ailleurs, seule la procédure d’introduction des familles algériennes est en principe autorisée, alors que, comme on l’a vu plus haut, la régularisation sur place des familles était considérée comme une procédure normale par l’instruction de – déjà indésirables – les règles qui allaient concerner tous les autres lorsque, quelques années plus tard, le pays étant sans doute considéré comme « repeuplé » et surtout son économie n’ayant plus besoin de la main-d’œuvre immigrée, c’est l’ensemble de la population étrangère qu’on allait chercher à dissuader de venir en France.
Coup d’arrêt
Le coup d’arrêt fut brutal : par circulaire du 9 juillet 1974, dans la foulée de la décision gouvernementale de suspendre l’immigration de travailleurs, le ministère du travail annonce l’arrêt provisoire de l’introduction des familles étrangères et prescrit l’interruption des procédures en cours. La mesure fera long feu : devant la virulence des réactions, le gouvernement recule, et moins d’un an (et quatre circulaires) plus tard le régime du regroupement familial est rétabli. Cette initiative aura eu le mérite d’amener le Conseil d’État à interdire pour l’avenir toute mesure générale visant à empêcher les étrangers de vivre en famille [5], et les pouvoirs publics à renoncer au régime des circulaires pour publier, en 1976, le premier décret sur le regroupement familial [6]. Mais il faudra attendre 1993 pour que le regroupement familial fasse son entrée dans l’ordonnance de 1945 [7]. On peut d’ailleurs s’interroger sur le sens de cette consécration légale, à l’occasion d’un texte dont une des caractéristiques est de limiter un peu plus l’accès au séjour en France des étrangers. N’est-elle pas contradictoire avec la volonté affirmée par le gouvernement de 1993 de conserver la maîtrise de sa politique migratoire ? « La France », disait Charles Pasqua devant l’Assemblée nationale, « entend définir par elle-même la situation, la qualité, l’origine de ceux qui sont ou seront associés à la communauté nationale, dans l’esprit des valeurs de la République (...) » [8]. Pour concilier ce souci élitiste avec le respect d’un droit fondamental, celui dont disposent en principe les étrangers vivant en France, au même titre que les nationaux, de se faire rejoindre par les membres de leur famille, le législateur a choisi d’enfermer la procédure de regroupement familial dans un cadre si strict que nombre d’entre eux en sont exclus [9]. Cette rigueur s’inscrit dans une logique, symbolisée par la détestable formule de « gestion des flux », qui ne s’est jamais démentie depuis la fin de la seconde guerre : pour l’État, l’immigration n’est pas un ensemble de personnes, mais avant tout un outil qu’on utilise ou qu’on range au gré des nécessités.
Notes
[1] Sur ce débat, voir « Le bon grain plutôt que l’ivraie », de Patrick Weil, dans ce même numéro.
[2] Voir « L’échec d’une politique de peuplement sélective », de Vincent Viet, dans ce même numéro.
[3] Voir « L’évolution des accords franco-africains », de Nadia Marot, dans ce même numéro.
[4] Voir « Coups de Jarnac contre les accords d’Évian », dans ce même numéro.
[5] Par son arrêt Gisti de 1978 aux termes duquel le droit de vivre en famille – des étrangers comme des Français – est érigé en principe général du droit.
[6] Sur cette période, lire « Les errements d’une réglementation », Plein droit n° 24.
[7] La loi du 24 août 1993, dite loi Pasqua, a ajouté à l’ordonnance du 2 novembre 1945 un chapitre VI : « Du regroupement familial ».
[8] JO, compte rendu des débats parlementaires, 15 juillet 1993, p. 1613.
[9] L’immigration familiale a diminué de 36,1 % entre 1993 et 1994.

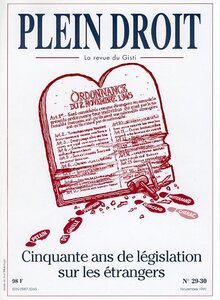
![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)










Partager cette page ?