Article extrait du Plein droit n° 95, décembre 2012
« Des familles indésirables »
Israël, l’infernale « terre promise »
David Lagarde
Géographe et volontaire pour Migreurop et Échanges et Partenariats
Si l’immigration a joué un rôle fondamental dans la construction d’Israël [1], l’immigration non juive est un phénomène récent qui n’a véritablement vu le jour qu’au début des années 1990. Au moment de l’effondrement de l’URSS, beaucoup de Juifs d’Europe de l’Est vinrent s’installer en Israël, accompagnés pour un nombre important d’entre eux de leurs conjoints non juifs. Mais ce n’est qu’après le bouclage des Territoires palestiniens occupés par le gouvernement israélien en mars 1993, que le nombre de migrants non juifs va véritablement augmenter. À partir de cette date, les Palestiniens désireux de travailler en Israël doivent obtenir un permis de circulation et de travail délivré par les autorités de l’État hébreu. Entre 1989 et 1996, le nombre de permis délivrés aux Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza est divisé par dix alors que le nombre de permis délivrés aux travailleurs non palestiniens est multiplié par trente [2]. Pour remplacer une main-d’œuvre essentielle à l’économie du pays, Israël va, pour la première fois de son histoire, faire appel à une immigration de travail. Les premiers travailleurs migrants arrivent à partir du milieu des années 1990 en provenance de l’est de l’Europe (Roumanie, Bulgarie, Turquie), d’Amérique latine (Colombie, Pérou) et d’Asie (Chine, Thaïlande, Philippines). Ils vont constituer jusqu’à 10 % de la force de travail nationale au début des années 2000 [3]. Israël instaure alors un système similaire à celui de la kafala [4] qui lie le travailleur étranger à son employeur, grâce auquel il a obtenu un visa de travail. À l’instar de ce que l’on peut observer au Liban ou en Jordanie, ce système a débouché sur une multiplication des abus de la part d’employeurs qui n’hésitent pas à confisquer les papiers d’identité de leurs employés, tout en les faisant travailler dans des conditions proches de l’esclavage. Pour mettre fin à ces conditions de vie déplorables, des travailleurs font le choix de quitter leur patron. S’ils se placent ainsi en situation irrégulière, ils sont néanmoins autorisés à résider dans le pays pour exercer un travail non déclaré, plus avantageux sur le plan économique et des conditions de vie [5]. Lorsque ces travailleurs migrants restent chez leurs employeurs, une fois leur contrat de travail terminé, leur visa prend automatiquement fin. Ils sont alors priés de quitter le territoire afin de laisser leur place à de nouveaux arrivants. Nombre d’entre eux restent toutefois en Israël et trouvent un emploi non déclaré. Au cours de la même période, beaucoup d’Africains originaires d’Afrique de l’Ouest ou du Congo sont arrivés avec des visas de tourisme, en pèlerinage ou pour un emploi dans des kibboutz, et sont restés à l’issue de leur visa pour travailler illégalement [6].
Face à l’augmentation du nombre de travailleurs « clandestins », à partir de 2002, les autorités israéliennes ont décidé de suivre une politique d’expulsion sous la houlette du ministère de l’immigration et de l’intégration. Dès cette année-là, ce sont près de 6 000 étrangers qui ont dû quitter le territoire, de gré ou de force [7]. Depuis lors, les patrouilles de la police de l’immigration – rebaptisées par la suite Oz Unit (Unité du courage) dans le but de faire oublier leur mauvaise réputation – sillonnent les rues des grandes villes du pays en quête de sans-papiers, multipliant les contrôles au faciès et les arrestations musclées. Cette politique d’expulsions massives rend compte de la volonté des autorités israéliennes de lutter contre l’installation de populations non juives.
L’appel d’un mythe
En 2004, Israël voit arriver par sa frontière sud des demandeurs d’asile venus d’Afrique subsaharienne. Les premiers sont soudanais, dans leur grande majorité originaires du Darfour. Deux ans plus tard, leur nombre augmente considérablement à la suite du massacre dont ils sont victimes en décembre 2005 sur la place Mustafa Mahmoud [8] du Caire. Cet événement tragique va en effet entraîner le départ d’une importante partie de la communauté soudanaise d’Égypte. En Israël, les Soudanais trouvent des emplois leur permettant d’améliorer leurs conditions de vie, entretenant par là même, dans l’esprit de nombreux Subsahariens en quête de protection, le mythe d’un Israël comme nouvel « Eldorado ». « [Israël] représente, pour eux, la garantie d’une protection, le rêve de la prospérité et l’assurance de vivre dans un pays "démocratique" qui prend peu à peu l’image d’une terre "d’asile", voire d’une terre "promise"… [9] »
Parallèlement, le renforcement et l’externalisation des dispositifs de contrôles aux frontières de l’Europe vont inciter d’autres demandeurs d’asile africains à prendre la direction d’Israël. Longtemps, les Érythréens – massivement poussés à l’exil par la dictature d’Issayas Afewerki [10] et un service militaire à durée indéterminée – se sont exilés en Europe en passant par la Libye. À l’instar des Soudanais, Israël devient à leurs yeux une alternative de choix face à la forteresse européenne. Il en est de même pour quelques centaines de réfugiés ivoiriens, somaliens, éthiopiens et congolais (de République démocratique du Congo). Ainsi, à la fin de l’année 2008, Israël comptait sur son territoire environ 14 000 demandeurs d’asile, dont l’écrasante majorité était entrée de manière « clandestine » par la frontière israélo-égyptienne.
En juillet 2007, face à l’afflux des arrivées depuis l’Égypte, le gouvernement israélien décide de transformer une partie de la prison de Ktziot, jusqu’alors réservée aux prisonniers palestiniens, en centre de rétention. Dans un premier temps, il est présenté par le gouvernement comme un camp de tri entre demandeurs d’asile et migrants économiques à expulser. À quelques kilomètres à peine, un autre camp de tentes est ouvert à Saharonim qui peut accueillir environ 2 000 personnes. Après quelques semaines passées dans l’un de ces deux camps du Néguev, la majorité des retenus obtient un permis de résidence à renouveler tous les trois mois. Il s’agit en effet de ressortissants de République démocratique du Congo, de Côte d’Ivoire, de Somalie et d’Érythrée, à la recherche d’une protection, ou de Soudanais, originaires d’un « État ennemi » avec lequel Israël n’entretient pas de relations diplomatiques. Pour les premiers, l’expulsion est interdite ; pour les seconds, elle est impossible.
Fin juin 2007, pour stopper ce flux en amont, une rencontre est organisée à Sharm el Sheikh entre le Premier ministre israélien de l’époque, Ehud Olmert, et l’ancien raïs égyptien, Hosni Moubarak. Le 1er juillet, Olmert annonce avoir trouvé une entente avec son homologue égyptien. Il affirme que l’Égypte « accepte de réadmettre les infiltrés qui arrivent à franchir la frontière » et qu’elle va « faire les efforts nécessaires pour empêcher de nouvelles "infiltrations"depuis son territoire » [11]. En effet, les premiers « efforts » égyptiens ne tardent pas : le 22 juillet 2007, la police ouvre le feu sur un groupe, tuant une Darfourie de 28 ans, enceinte de sept mois. La politique du « stop and shoot » menée par l’Égypte depuis « les accords de Sharm el Sheikh » tuera plus d’une centaine de Subsahariens en cinq ans.
Conséquence directe des accords passés entre Hosni Moubarak et Ehud Olmert, depuis 2007, les autorités égyptiennes n’accordent quasiment plus de visas aux Érythréens. Ces derniers sont donc contraints de recourir aux services de passeurs depuis le Soudan, s’exposant à de graves risques de kidnapping [12]. Le flux d’arrivées depuis l’Égypte n’a cependant jamais été stoppé et la chute du régime en janvier 2011 occasionne une augmentation considérable du nombre de passages « clandestins ».
Murs et camps
Au lendemain de la révolution du 25 janvier 2011, les forces de sécurité égyptiennes vont perdre tout contrôle sur le Sinaï, facilitant le travail des passeurs. Au Caire, les réfugiés subsahariens sont exposés à des conditions de vie encore plus difficile que sous la dictature de Moubarak. Les actes de violences se multiplient à leur encontre et, dans un contexte de crise économique aggravée, les opportunités d’emplois se font rarissimes. « Malgré les dangers que comporte la traversée jusqu’en Israël, beaucoup [d’Africains] ont préféré prendre le risque de mourir rapidement sur la route, plutôt que de mourir ici à petit feu », explique Ibrahim Ishag, leader communautaire des réfugiés du Darfour à Zeitoun.
Selon les autorités israéliennes, rien qu’au cours de l’année 2011, 17 000 demandeurs d’asile auraient pénétré dans le pays depuis l’Égypte, élevant ainsi le total de Subsahariens entrés par le Sinaï à près de 50 000 depuis 2005. En janvier 2010, le Premier ministre Benyamin Netanyahou annonce la construction d’une barrière sur une partie de sa frontière avec l’Égypte, afin d’« assurer le caractère juif et démocratique d’Israël ». Face à l’augmentation du nombre d’entrées « illégales » au cours de l’année 2011, le gouvernement va finalement prendre la décision de fermer l’intégralité de la frontière. Doté de caméras, de radars et de détecteurs de mouvements, ce mur d’acier est entouré d’un nouveau type de grillage coupant de 8 millimètres d’épaisseur, rendant l’ouvrage quasiment infranchissable, tout cela pour la bagatelle de 50 millions d’euros.
Parallèlement, une nouvelle « loi sur les infiltrations » est adoptée en janvier 2012 par la Knesset. Elle prévoit notamment l’agrandissement des camps de Ktziot et Saharonim, ainsi que la construction, si nécessaire, de deux autres camps dans le Néguev (Sadot et Nahal Raviv). Si l’ensemble du projet est mené à bien, Israël disposera d’un méga complexe d’enfermement situé à moins de dix kilomètres de la frontière égyptienne et pouvant accueillir jusqu’à 30 000 personnes. Cette même loi prévoit aussi l’enfermement pour une période de trois ans et sans jugement préalable de tout individu pénétrant en Israël de manière « irrégulière » depuis le Sinaï. Pour les ressortissants d’un État ennemi d’Israël, tel que les Soudanais, cette période d’enfermement peut même être illimitée. Les mêmes mesures seront également appliquées aux mineurs. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi en juin 2012, aucune personne entrée en Israël « illégalement » n’a été relâchée des camps du Néguev.
Plus que jamais déterminé dans sa guerre contre les Subsahariens, le 7 juin 2012, le gouvernement a obtenu l’autorisation par un tribunal israélien d’expulser les Ivoiriens et Sud-Soudanais présents sur le territoire, considérant qu’ils pouvaient désormais être renvoyés vers leur pays d’origine sans que leur sécurité soit menacée. Ces derniers ont eu deux semaines pour se rendre d’eux-mêmes aux autorités et bénéficier d’un vol de retour gratuit et d’une « compensation » de 1000 euros par adulte et 400 euros par enfant. Dépassé ce délai de deux semaines, la Oz Unit s’est alors mise en chasse pour arrêter les quelques centaines de récalcitrants au retour. « Pendant plusieurs semaines, ce fut la traque aux Africains dans les quartiers sud de Tel-Aviv. Plusieurs ambassadeurs africains se sont d’ailleurs fait eux aussi contrôler. Mais au final, cette mesure d’expulsion n’a concerné que 2 000 personnes sur 60 000 réfugiés vivant en Israël. Il s’agit donc surtout d’un effet d’annonce du gouvernement pour satisfaire son électorat d’extrême droite », rapporte Netta Mishly, membre de l’ONG israélienne African Refugee Development Center (ARDC).
En plus d’attiser les haines raciales et les violences au sein du pays, le jeu malsain auquel se livrent certains politiciens israéliens a eu des conséquences directes sur l’emploi des Subsahariens en Israël. Lors de l’annonce de la nouvelle « loi sur les infiltrations », le gouvernement a laissé entendre que de fortes amendes seraient infligées aux entreprises employant des réfugiés. Dans les mois qui ont suivi, la population subsaharienne d’Israël a été touchée par une terrible vague de chômage. L’association Kav LaOved tente aujourd’hui d’informer les employeurs et les réfugiés sur leurs droits afin de réparer les dégâts causés par cette rumeur. L’une de ses militants explique : « Si les réfugiés n’ont en théorie pas le droit de travailler, cela ne constitue pas non plus un délit. L’employeur ne peut donc en aucun cas être condamné. Pour qu’une telle décision soit prise, il faudrait qu’elle ait été validée par la Haute Cour de justice, ce qui n’est pas le cas. Et de toute façon, que ferait Israël avec des dizaines de milliers de réfugiés sans emploi ? Cela provoquerait une terrible crise humanitaire que le gouvernement ne souhaite pour rien au monde ! »
Il ne fait aucun doute que cette batterie de mesures et d’annonces vise à décourager les réfugiés venus d’Afrique d’élire Israël comme terre d’accueil. À l’heure actuelle, personne ne sait comment le gouvernement va appliquer sa loi sur les infiltrations, ni quelles vont être les conséquences pour les réfugiés qui continueront d’arriver depuis l’Égypte et pour ceux déjà présents sur le territoire. En juillet et en août, les autorités ont annoncé une très forte baisse du nombre de passages, mais les chiffres avancés restent difficilement vérifiables puisque l’accès aux lieux d’enfermement du Néguev est depuis lors interdit aux ONG israéliennes. Dans ces conditions, on peut, comme la chercheuse et militante Laurie Ljinders, s’inquiéter pour l’avenir : « Si les autorités appliquent vraiment cette loi, que va-t-il se passer après trois ans d’enfermement ? Que vont-ils faire si l’Érythrée est toujours sous dictature ? Et quid des Soudanais. Ils ne pourront pas être expulsés tant qu’il n’existe pas de relations diplomatiques entre les deux pays. Alors est-ce que le gouvernement va vraiment les emprisonner indéfiniment ? Aujourd’hui, la société civile et les réfugiés sont dans l’attente et personne n’est véritablement en mesure de dire quelle tournure vont prendre les choses dans les mois et les années à venir. »
150 réfugiés depuis 1948
|
Notes
[1] En 1995, les immigrants de première génération (nés en dehors d’Israël) constituaient 40 % de la population juive du pays.
[2] Caroline Rozenholc, « Les travailleurs étrangers ou l’impact d’une immigration non juive sur la citoyenneté israélienne », Bulletin du Centre de recherche français à Jérusalem, n° 21, 2010.
[4] Au Proche-Orient, la kafala est une forme de parrainage qui organise la migration de travail entre deux pays. En s’y soumettant, les travailleurs étrangers voient leur sort lié à leur contrat de travail et à leur employeur ce qui exclut tout projet migratoire à long terme.
[5] William Berthomière, « Globalisation des migrations internationales : dynamiques et modalités. Une contribution réflexive à partir du cas israélien », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, n° 119-120, 2007.
[8] À la suite du traité de paix au Sud-Soudan en juin 2004, le HCR a décidé d’arrêter les procédures de reconnaissance du statut de réfugié pour les Soudanais. Un sit-in de plusieurs semaines a été organisé par les réfugiés soudanais devant les locaux du HCR, jusqu’à ce que l’agence onusienne appelle la police afin de faire évacuer les manifestants. Le 30 décembre 2005, la police égyptienne a massacré entre 27 Soudanais (d’après les autorités) et plus de 200 (selon le Parlement européen).
[9] Lisa Anteby-Yemini, « Migrations africaines et nouveaux enjeux de la frontière israélo-égyptienne », Cultures & Conflits, n° 72, 2009.
[10] Président de l’Érythrée depuis l’indépendance du pays en mai 1993, Issayas Afewerki a instauré un régime à parti unique et impose de terribles restrictions à la liberté de la presse et de culte.
[11] Human Rights Watch, Sinai perils. Risks to Migrants, Refugees, and Asylum Seekers in Egypt and Israel, novembre 2008.
[12] Depuis 2010, des tribus de Bédouins kidnappent des réfugiés (95 % d’entre eux sont Érythréens) au Soudan et en Éthiopie. Pris dans un trafic transnational, revendus, échangés, les otages finissent généralement dans la péninsule du Sinaï où ils sont torturés jusqu’au paiement d’une rançon pouvant dans certains cas s’élever jusqu’à 50 000 dollars. À leur libération, ils sont amenés par les preneurs d’otages au niveau de la frontière afin de passer en Israël.

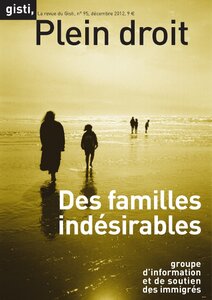
![[retour en haut de page]](images/haut-page.gif)










Partager cette page ?